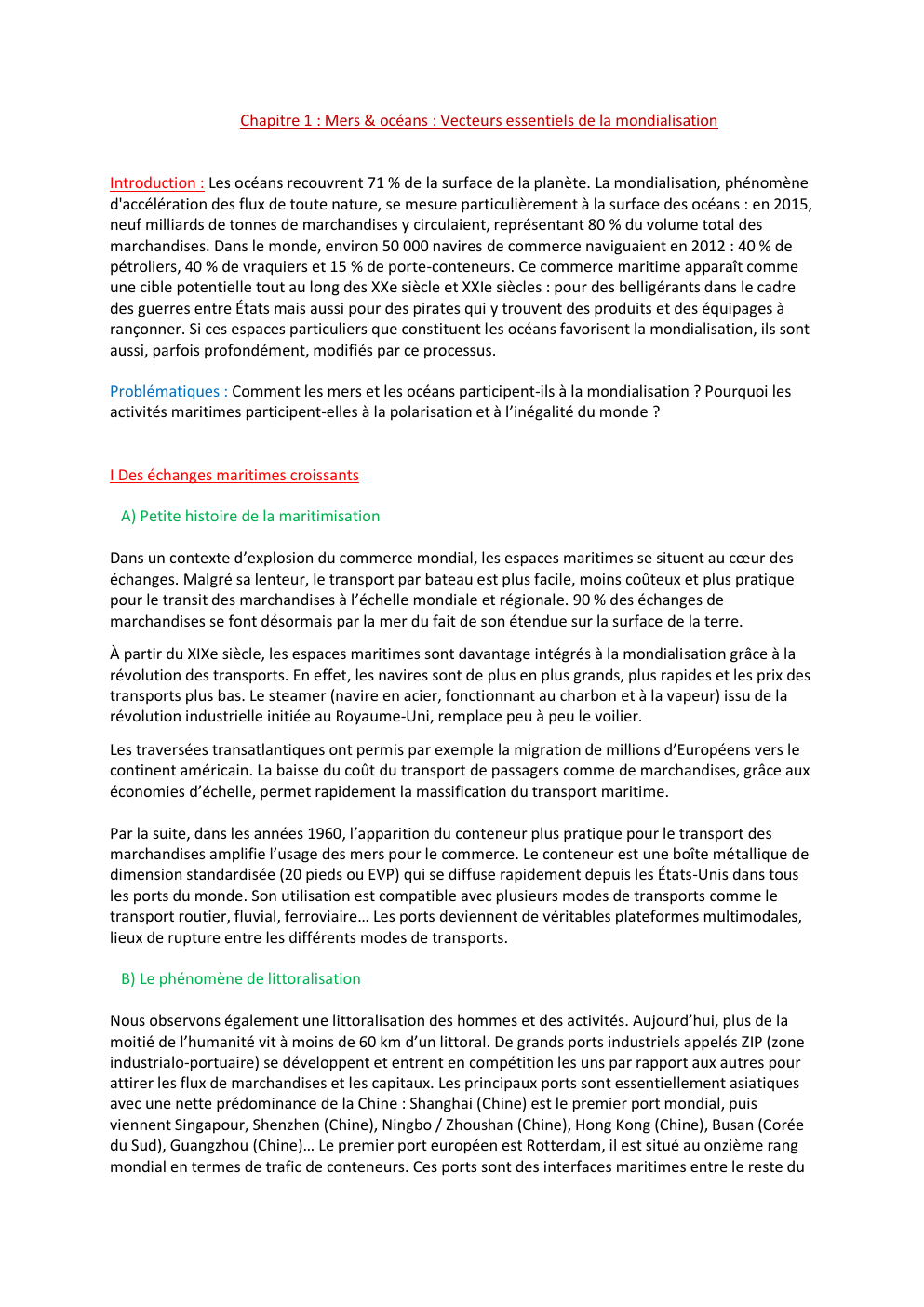Cours_T1C1 geo
Publié le 29/05/2025
Extrait du document
«
Chapitre 1 : Mers & océans : Vecteurs essentiels de la mondialisation
Introduction : Les océans recouvrent 71 % de la surface de la planète.
La mondialisation, phénomène
d'accélération des flux de toute nature, se mesure particulièrement à la surface des océans : en 2015,
neuf milliards de tonnes de marchandises y circulaient, représentant 80 % du volume total des
marchandises.
Dans le monde, environ 50 000 navires de commerce naviguaient en 2012 : 40 % de
pétroliers, 40 % de vraquiers et 15 % de porte-conteneurs.
Ce commerce maritime apparaît comme
une cible potentielle tout au long des XXe siècle et XXIe siècles : pour des belligérants dans le cadre
des guerres entre États mais aussi pour des pirates qui y trouvent des produits et des équipages à
rançonner.
Si ces espaces particuliers que constituent les océans favorisent la mondialisation, ils sont
aussi, parfois profondément, modifiés par ce processus.
Problématiques : Comment les mers et les océans participent-ils à la mondialisation ? Pourquoi les
activités maritimes participent-elles à la polarisation et à l’inégalité du monde ?
I Des échanges maritimes croissants
A) Petite histoire de la maritimisation
Dans un contexte d’explosion du commerce mondial, les espaces maritimes se situent au cœur des
échanges.
Malgré sa lenteur, le transport par bateau est plus facile, moins coûteux et plus pratique
pour le transit des marchandises à l’échelle mondiale et régionale.
90 % des échanges de
marchandises se font désormais par la mer du fait de son étendue sur la surface de la terre.
À partir du XIXe siècle, les espaces maritimes sont davantage intégrés à la mondialisation grâce à la
révolution des transports.
En effet, les navires sont de plus en plus grands, plus rapides et les prix des
transports plus bas.
Le steamer (navire en acier, fonctionnant au charbon et à la vapeur) issu de la
révolution industrielle initiée au Royaume-Uni, remplace peu à peu le voilier.
Les traversées transatlantiques ont permis par exemple la migration de millions d’Européens vers le
continent américain.
La baisse du coût du transport de passagers comme de marchandises, grâce aux
économies d’échelle, permet rapidement la massification du transport maritime.
Par la suite, dans les années 1960, l’apparition du conteneur plus pratique pour le transport des
marchandises amplifie l’usage des mers pour le commerce.
Le conteneur est une boîte métallique de
dimension standardisée (20 pieds ou EVP) qui se diffuse rapidement depuis les États-Unis dans tous
les ports du monde.
Son utilisation est compatible avec plusieurs modes de transports comme le
transport routier, fluvial, ferroviaire… Les ports deviennent de véritables plateformes multimodales,
lieux de rupture entre les différents modes de transports.
B) Le phénomène de littoralisation
Nous observons également une littoralisation des hommes et des activités.
Aujourd’hui, plus de la
moitié de l’humanité vit à moins de 60 km d’un littoral.
De grands ports industriels appelés ZIP (zone
industrialo-portuaire) se développent et entrent en compétition les uns par rapport aux autres pour
attirer les flux de marchandises et les capitaux.
Les principaux ports sont essentiellement asiatiques
avec une nette prédominance de la Chine : Shanghai (Chine) est le premier port mondial, puis
viennent Singapour, Shenzhen (Chine), Ningbo / Zhoushan (Chine), Hong Kong (Chine), Busan (Corée
du Sud), Guangzhou (Chine)… Le premier port européen est Rotterdam, il est situé au onzième rang
mondial en termes de trafic de conteneurs.
Ces ports sont des interfaces maritimes entre le reste du
monde (foreland) et leur arrière-pays (hinterland) qui fournit réseaux de transport terrestre
multiples et ressources à échanger.
II Le réseau maritime mondial
A) Les grandes routes maritimes
Les routes maritimes et les câbles sous-marin laissent apparaître un réseau qui s’organise à partir
d’axes principaux et secondaires entre différents pôles.
La grande route maritime Est-Ouest entre
l’Europe et l’Asie est la plus importante.
Elle concentre la majorité du trafic mondial.
Elle passe par
des détroits stratégiques comme le canal de Suez et le détroit de Malacca.
Les ports qui longent cette
route se sont développés comme celui de Malte, Marsaxlokk, ou Malta Freeport, véritable hub
international spécialisé dans les conteneurs au milieu de la Méditerranée.
Il constitue une zone
franche défiscalisée pour attirer le trafic.
Toutefois, certains géographes soulignent la recomposition
progressive du trafic mondial avec le déclin de l’Europe et la montée en puissance de l’Asie.
La route
maritime Pacifique entre la côte Ouest américaine et l’Asie du Sud-Est est de plus en plus importante.
La mondialisation crée des façades maritimes dynamiques qui attirent de nombreux flux de
marchandises.
Par exemple la Northern Range en mer du Nord rassemble les grands ports de
Hambourg (Allemagne) au Havre (France), en passant par Amsterdam (Pays-Bas), Rotterdam (PaysBas), Anvers (Belgique), Zeebrugge (Belgique), Dunkerque (France).
Ces ports rivalisent entre eux
pour capter le trafic, mais sont aussi parfois complémentaires en se spécialisant.
Ainsi, Rotterdam
sert de hub pour l’importation d’hydrocarbures, de charbon, de minerai de fer, accueillant des géants
pétroliers, minéraliers ou porte-conteneurs.
Les marchandises sont ensuite réexpédiées par des navires de plus petite dimension, appelés
feeders, vers les autres ports.
C’est le principe du « hub and spoke ».
B) Les lieux de passages stratégiques
L’organisation de grandes routes de commerce fait aussi apparaître des détroits stratégiques qui
facilitent le transit des marchandises.
Certains sont des détroits naturels, comme le détroit de Béring
entre le Pacifique et l’Arctique, le détroit de Gibraltar entre l’Atlantique et la Méditerranée, celui de
Malacca entre le Pacifique et l’océan Indien, ou encore le détroit de Magellan entre le Pacifique et
l’Atlantique.
D’autres sont au contraire des canaux artificiels creusés par l’homme, comme le canal de Panama
entre l’Atlantique et le Pacifique, ou le canal de Suez entre la mer Rouge et la Méditerranée.
Ces
espaces maritimes concentrent un trafic très important.
Par exemple, depuis l’achèvement de ses
travaux de doublement du canal en 2016, plus de 13 600 navires empruntent le canal de Panama,
soit plus de 404 millions de tonnes de marchandises, essentiellement des conteneurs, des
hydrocarbures et du vrac.
Il s’agit de 5 % du trafic mondial.
En mars 2021, le porte-conteneurs Ever
Given échoué durant 6 jours dans le canal de Suez....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La seconde guerre mondiale Cours terminal
- Cours de Philosophie : Le bonheur – Lettre à Ménécée
- Peut-on prédire les cours de la bourse a l'aide des mathematiques ?
- Cours: Histoire des institutions politiques
- Cours droit constitutionnel