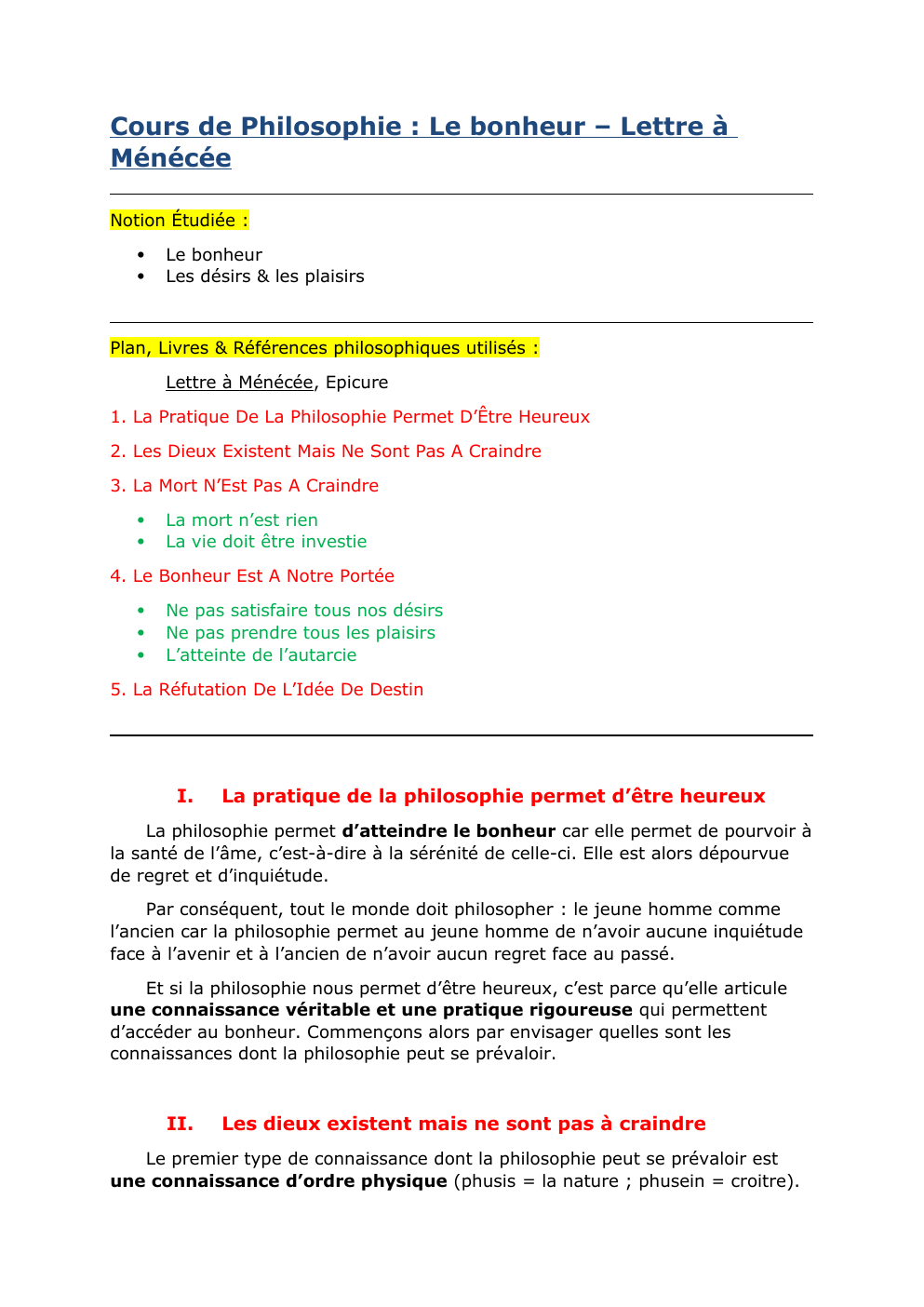Cours de Philosophie : Le bonheur – Lettre à Ménécée
Publié le 03/05/2025
Extrait du document
«
Cours de Philosophie : Le bonheur – Lettre à
Ménécée
Notion Étudiée :
Le bonheur
Les désirs & les plaisirs
Plan, Livres & Références philosophiques utilisés :
Lettre à Ménécée, Epicure
1.
La Pratique De La Philosophie Permet D’Être Heureux
2.
Les Dieux Existent Mais Ne Sont Pas A Craindre
3.
La Mort N’Est Pas A Craindre
La mort n’est rien
La vie doit être investie
4.
Le Bonheur Est A Notre Portée
Ne pas satisfaire tous nos désirs
Ne pas prendre tous les plaisirs
L’atteinte de l’autarcie
5.
La Réfutation De L’Idée De Destin
I.
La pratique de la philosophie permet d’être heureux
La philosophie permet d’atteindre le bonheur car elle permet de pourvoir à
la santé de l’âme, c’est-à-dire à la sérénité de celle-ci.
Elle est alors dépourvue
de regret et d’inquiétude.
Par conséquent, tout le monde doit philosopher : le jeune homme comme
l’ancien car la philosophie permet au jeune homme de n’avoir aucune inquiétude
face à l’avenir et à l’ancien de n’avoir aucun regret face au passé.
Et si la philosophie nous permet d’être heureux, c’est parce qu’elle articule
une connaissance véritable et une pratique rigoureuse qui permettent
d’accéder au bonheur.
Commençons alors par envisager quelles sont les
connaissances dont la philosophie peut se prévaloir.
II.
Les dieux existent mais ne sont pas à craindre
Le premier type de connaissance dont la philosophie peut se prévaloir est
une connaissance d’ordre physique (phusis = la nature ; phusein = croitre).
Les dieux, que la majorité des contemporains d’Epicure croit responsables des
manifestations naturelles, existent et sont immortels et bienheureux.
Cela
signifie qu’aucun d’entre eux ne peut être dit inquiet, en colère ou jaloux car
cela irait à l’encontre de l’immortalité ou de la béatitude qui les caractérisent.
Cette connaissance n’est pas rigoureusement justifiée par Epicure mais il
considère qu’il doit y avoir dans cette représentation quelque chose de vrai tant
les hommes la partagent.
Cette connaissance permet alors de combattre l’opinion que les hommes
se font généralement des dieux, opinion qui sème l’inquiétude et le trouble
dans l’âme.
En effet, pour la plupart des hommes, les dieux jugent les bonnes
et mauvaises actions des mortels et punissent ceux qui agissent mal.
Or les
dieux ne se mêlent pas des affaires des hommes.
La nature n’est qu’un espace
composé d’atomes dont les agencements produisent des phénomènes naturels.
Ainsi l’opinion de la foule relève-t-elle davantage de la superstition que de la
croyance et le rejet de cette représentation ne signifie pas nécessairement
impiété.
C’est donc en démystifiant la nature que l’homme atteint la sérénité.
III.
La mort n’est pas à craindre
a.
La mort n’est rien
Le deuxième type de connaissance dont la philosophie peut se prévaloir est
encore une fois d’ordre physique.
La mort, que chacun redoute comme le
pire des maux, n’est rien pour nous.
Pour justifier son propos, Epicure
propose un syllogisme : la sensation est la mesure du bien de du mal.
Or, la
mort est une absence de sensation.
Donc, la mort est une absence de bien et de
mal.
Le raisonnement est imparable : la mort n’est ainsi rien pour nous.
Deux
conséquences s’imposent alors.
Première conséquence : il n’y a aucune raison d’avoir peur de la mort
elle-même.
Or, si nous comprenons bien cette idée, elle permettra de vivre plus
pleinement la vie qui nous est donnée car nous cesserons de désespérer de sa
fin.
Deuxième conséquence : il n’y a aucune raison d’avoir peur de l’attente
de la mort car si la mort n’est rien pour nous, il est alors inutile de redouter
l’attente de ce qui n’est rien.
b.
La vie doit être investie
La mort n’est donc rien pour nous et il est inutile de la redouter.
Pourtant, la
multitude et le sage s’opposent souvent sur cette conception.
La multitude
recherche la mort pour abréger ses souffrances et le fuit pour éterniser les
plaisirs.
Le sage, lui, ne cherche ni à la rallonger ni à la raccourcir, il assume et
investit pleinement le temps qui lui est donné à vivre.
Le sage en effet ne cherche pas à rallonger sa vie car il sait que ce qui
importe ce n’est pas la longueur de l’existence mais sa qualité, son
intensité.
Mais le sage ne cherche pas non plus à la raccourcir.
Et ceux qui prétendent
qu’au seuil de la vie il ne faut se concentrer que sur le souci de bien mourir
sont dans l’erreur parce qu’ils méprisent le consentement que le vieillard,
tant qu’il est en vie, peut encore goûter.
Mais ils sont également dans
l’erreur parce qu’ils ne comprennent pas que bien vivre et bien mourir sont
exactement la même chose.
Si l’on vit bien, c’est-à-dire en prenant en
charge cette existence qui est la nôtre, nous mourrons bien au sens où
nous mourrons sans regrets ni inquiétudes.
Quant à ceux qui prétendent
qu’à l’aube de la vie il convient de mourir au plus vite, ils sont, eux aussi, dans
l’erreur car ils méprisent encore une fois le consentement que la vie peut
permettre de goûter.
En effet, l’homme est capable de créer, dans les limites d’une existence
donnée, les conditions de son bonheur.
Reste à savoir....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA CONSCIENCE (résumé de cours de philosophie)
- cours sur l'Etat (philosophie politique)
- Le Langage - Cours Complet Philosophie Terminale
- COURS SUR LE BONHEUR
- Cours Allegorie de la Caverne Philosophie