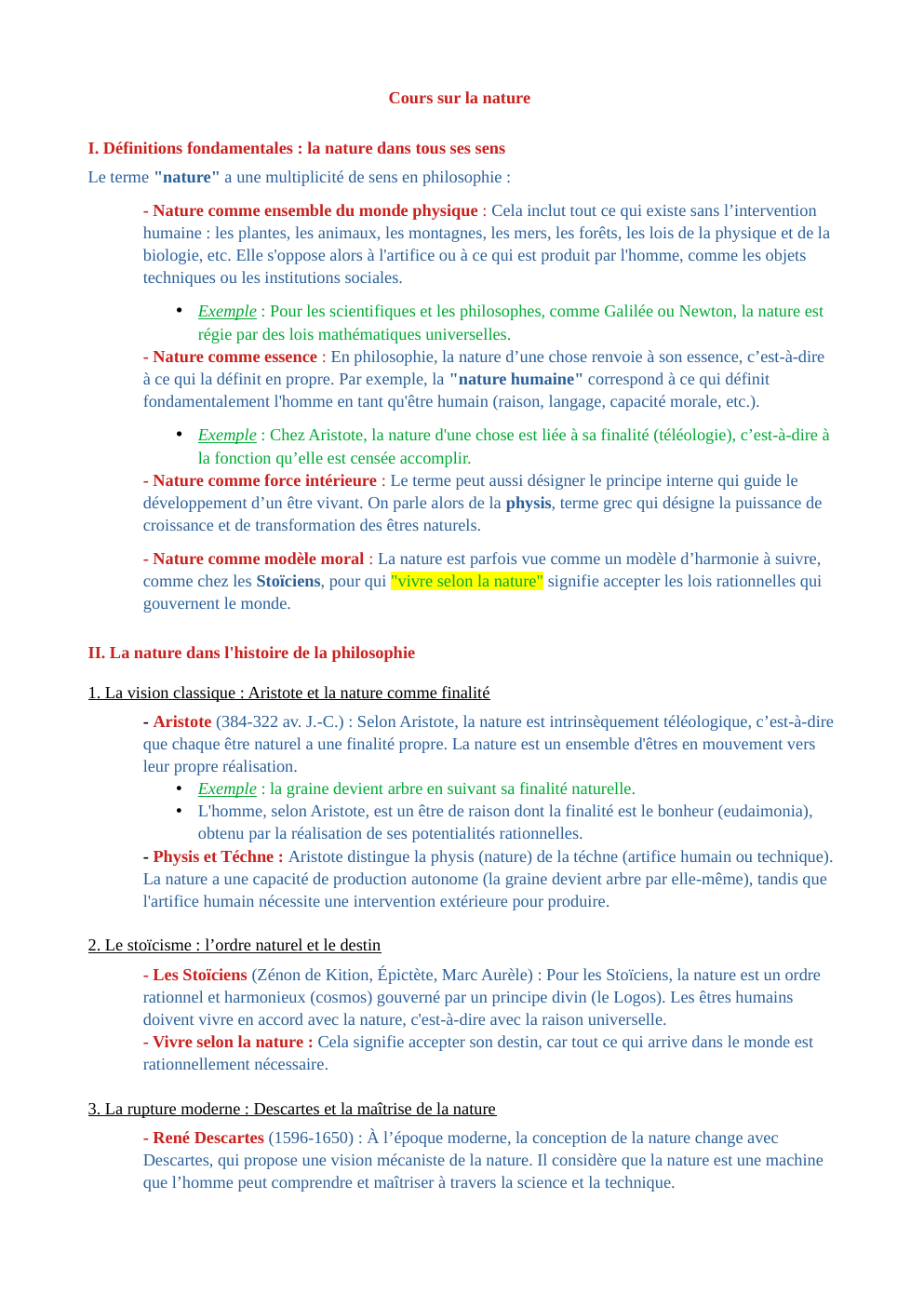Cours La nature philosophie bac
Publié le 08/03/2025
Extrait du document
«
Cours sur la nature
I.
Définitions fondamentales : la nature dans tous ses sens
Le terme "nature" a une multiplicité de sens en philosophie :
- Nature comme ensemble du monde physique : Cela inclut tout ce qui existe sans l’intervention
humaine : les plantes, les animaux, les montagnes, les mers, les forêts, les lois de la physique et de la
biologie, etc.
Elle s'oppose alors à l'artifice ou à ce qui est produit par l'homme, comme les objets
techniques ou les institutions sociales.
• Exemple : Pour les scientifiques et les philosophes, comme Galilée ou Newton, la nature est
régie par des lois mathématiques universelles.
- Nature comme essence : En philosophie, la nature d’une chose renvoie à son essence, c’est-à-dire
à ce qui la définit en propre.
Par exemple, la "nature humaine" correspond à ce qui définit
fondamentalement l'homme en tant qu'être humain (raison, langage, capacité morale, etc.).
• Exemple : Chez Aristote, la nature d'une chose est liée à sa finalité (téléologie), c’est-à-dire à
la fonction qu’elle est censée accomplir.
- Nature comme force intérieure : Le terme peut aussi désigner le principe interne qui guide le
développement d’un être vivant.
On parle alors de la physis, terme grec qui désigne la puissance de
croissance et de transformation des êtres naturels.
- Nature comme modèle moral : La nature est parfois vue comme un modèle d’harmonie à suivre,
comme chez les Stoïciens, pour qui "vivre selon la nature" signifie accepter les lois rationnelles qui
gouvernent le monde.
II.
La nature dans l'histoire de la philosophie
1.
La vision classique : Aristote et la nature comme finalité
- Aristote (384-322 av.
J.-C.) : Selon Aristote, la nature est intrinsèquement téléologique, c’est-à-dire
que chaque être naturel a une finalité propre.
La nature est un ensemble d'êtres en mouvement vers
leur propre réalisation.
• Exemple : la graine devient arbre en suivant sa finalité naturelle.
• L'homme, selon Aristote, est un être de raison dont la finalité est le bonheur (eudaimonia),
obtenu par la réalisation de ses potentialités rationnelles.
- Physis et Téchne : Aristote distingue la physis (nature) de la téchne (artifice humain ou technique).
La nature a une capacité de production autonome (la graine devient arbre par elle-même), tandis que
l'artifice humain nécessite une intervention extérieure pour produire.
2.
Le stoïcisme : l’ordre naturel et le destin
- Les Stoïciens (Zénon de Kition, Épictète, Marc Aurèle) : Pour les Stoïciens, la nature est un ordre
rationnel et harmonieux (cosmos) gouverné par un principe divin (le Logos).
Les êtres humains
doivent vivre en accord avec la nature, c'est-à-dire avec la raison universelle.
- Vivre selon la nature : Cela signifie accepter son destin, car tout ce qui arrive dans le monde est
rationnellement nécessaire.
3.
La rupture moderne : Descartes et la maîtrise de la nature
- René Descartes (1596-1650) : À l’époque moderne, la conception de la nature change avec
Descartes, qui propose une vision mécaniste de la nature.
Il considère que la nature est une machine
que l’homme peut comprendre et maîtriser à travers la science et la technique.
• Il écrit : "Nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature" (Discours de la méthode),
ce qui signifie que grâce à la science et à la technique, l'homme peut transformer et dominer
la nature.
- Nature et culture : Chez Descartes, la nature est vue comme extérieure à l'homme et sans finalité
propre, contrairement à la pensée classique.
La culture, par l’usage de la raison et de la technique, est
ce qui permet à l'homme de s'élever au-dessus de la nature.
4.
La critique romantique : Rousseau et la nature originelle de l'homme
- Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) : Rousseau critique la société moderne et prône un retour à
l’état de nature.
Selon lui, l'homme est naturellement bon, mais la société le corrompt.
• État de nature : Il s’agit d’un concept hypothétique où l’homme vivrait sans société ni
institutions.
Dans cet état, l’homme est libre et égal, mais la propriété privée et la société
génèrent des inégalités et des conflits.
• Culture et dénaturation : La culture et le progrès dénaturent l’homme, en le détournant de
sa bonté naturelle et en introduisant des vices comme l’orgueil et la jalousie.
II.
L'opposition nature/culture
L’un des grands axes du programme est la distinction et parfois la confrontation entre nature et culture.
1.
Nature et culture : deux pôles opposés ?
- La nature renvoie à tout ce qui est donné indépendamment de l’homme, de son artifice, de
sa pensée et de ses institutions.
La culture, elle, représente ce que l’homme produit, façonne
et organise pour dépasser ce qui est simplement donné.
• Cette opposition se retrouve dans l’idée que l’homme, contrairement aux animaux, est un
être de culture, capable de transformer la nature.
Par exemple, un enfant est "naturellement"
incapable de parler, mais il acquiert le langage à travers la culture.
- Claude Lévi-Strauss, anthropologue, remet en question cette opposition radicale.
Selon
lui, certains aspects de la culture (comme les interdits alimentaires ou les règles de parenté)
sont universels et semblent trouver leurs racines dans la nature humaine.
Il parle d’une
"continuum" entre nature et culture.
2.
La culture dénature-t-elle l’homme ?
- La question de savoir si la culture dénature l’homme est souvent abordée dans les débats
philosophiques.
Pour Rousseau, l’homme à l’état de nature est bon, mais c’est la société qui
le corrompt.
L’homme naturel serait pacifique et heureux, tandis que l’homme socialisé est
avide et malheureux.
- En revanche, Hegel soutient que la culture est ce qui permet à l’homme de réaliser sa
liberté.
Il considère....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- cours nature philosophie
- L'id�e de nature (cours de philosophie)
- Cours de Philosophie : Le bonheur – Lettre à Ménécée
- LA CONSCIENCE (résumé de cours de philosophie)
- cours sur l'Etat (philosophie politique)