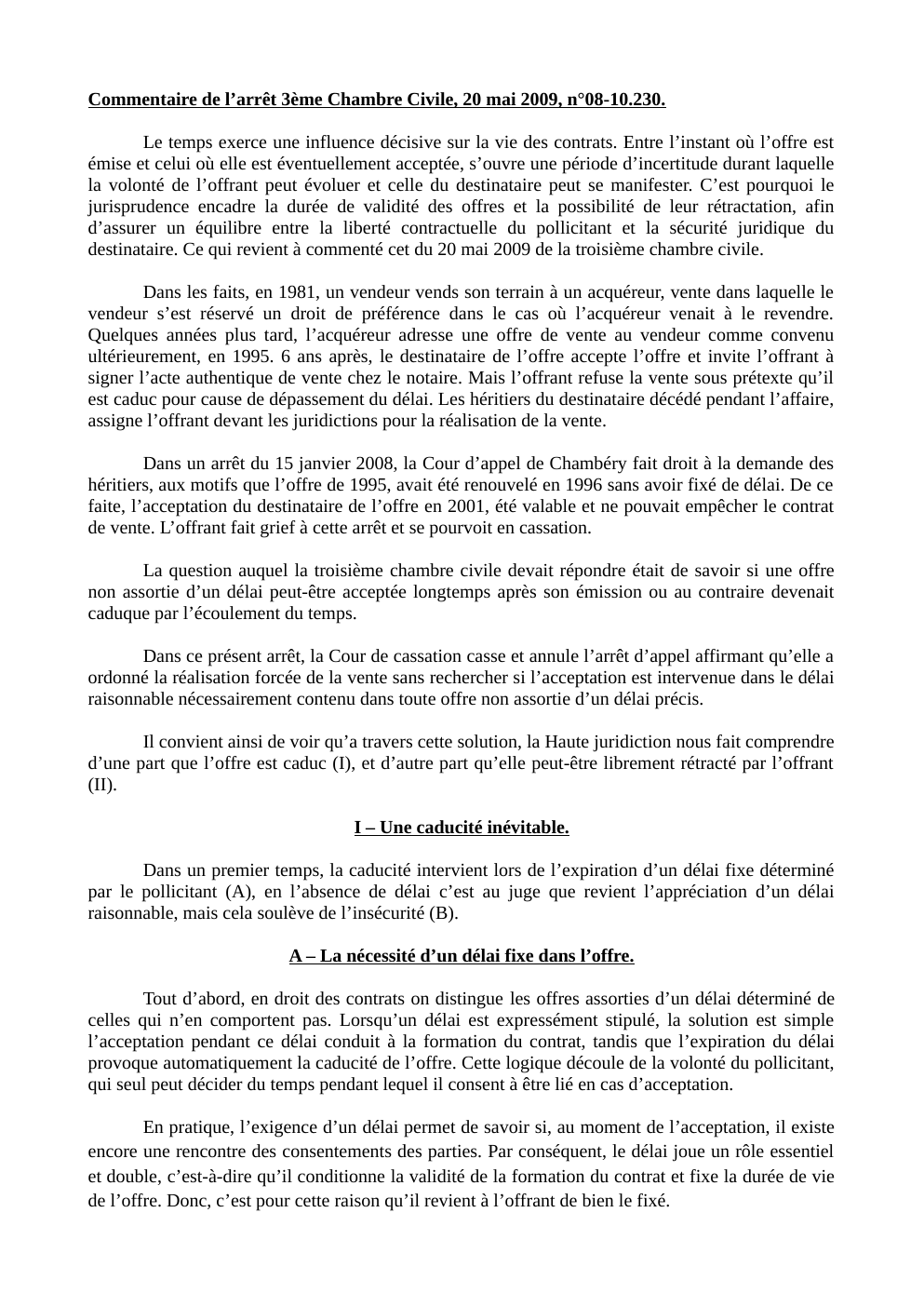Commentaire de l’arrêt 3ème Chambre Civile, 20 mai 2009, n°08-10.230.
Publié le 06/11/2025
Extrait du document
«
Commentaire de l’arrêt 3ème Chambre Civile, 20 mai 2009, n°08-10.230.
Le temps exerce une influence décisive sur la vie des contrats.
Entre l’instant où l’offre est
émise et celui où elle est éventuellement acceptée, s’ouvre une période d’incertitude durant laquelle
la volonté de l’offrant peut évoluer et celle du destinataire peut se manifester.
C’est pourquoi le
jurisprudence encadre la durée de validité des offres et la possibilité de leur rétractation, afin
d’assurer un équilibre entre la liberté contractuelle du pollicitant et la sécurité juridique du
destinataire.
Ce qui revient à commenté cet du 20 mai 2009 de la troisième chambre civile.
Dans les faits, en 1981, un vendeur vends son terrain à un acquéreur, vente dans laquelle le
vendeur s’est réservé un droit de préférence dans le cas où l’acquéreur venait à le revendre.
Quelques années plus tard, l’acquéreur adresse une offre de vente au vendeur comme convenu
ultérieurement, en 1995.
6 ans après, le destinataire de l’offre accepte l’offre et invite l’offrant à
signer l’acte authentique de vente chez le notaire.
Mais l’offrant refuse la vente sous prétexte qu’il
est caduc pour cause de dépassement du délai.
Les héritiers du destinataire décédé pendant l’affaire,
assigne l’offrant devant les juridictions pour la réalisation de la vente.
Dans un arrêt du 15 janvier 2008, la Cour d’appel de Chambéry fait droit à la demande des
héritiers, aux motifs que l’offre de 1995, avait été renouvelé en 1996 sans avoir fixé de délai.
De ce
faite, l’acceptation du destinataire de l’offre en 2001, été valable et ne pouvait empêcher le contrat
de vente.
L’offrant fait grief à cette arrêt et se pourvoit en cassation.
La question auquel la troisième chambre civile devait répondre était de savoir si une offre
non assortie d’un délai peut-être acceptée longtemps après son émission ou au contraire devenait
caduque par l’écoulement du temps.
Dans ce présent arrêt, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel affirmant qu’elle a
ordonné la réalisation forcée de la vente sans rechercher si l’acceptation est intervenue dans le délai
raisonnable nécessairement contenu dans toute offre non assortie d’un délai précis.
Il convient ainsi de voir qu’a travers cette solution, la Haute juridiction nous fait comprendre
d’une part que l’offre est caduc (I), et d’autre part qu’elle peut-être librement rétracté par l’offrant
(II).
I – Une caducité inévitable.
Dans un premier temps, la caducité intervient lors de l’expiration d’un délai fixe déterminé
par le pollicitant (A), en l’absence de délai c’est au juge que revient l’appréciation d’un délai
raisonnable, mais cela soulève de l’insécurité (B).
A – La nécessité d’un délai fixe dans l’offre.
Tout d’abord, en droit des contrats on distingue les offres assorties d’un délai déterminé de
celles qui n’en comportent pas.
Lorsqu’un délai est expressément stipulé, la solution est simple
l’acceptation pendant ce délai conduit à la formation du contrat, tandis que l’expiration du délai
provoque automatiquement la caducité de l’offre.
Cette logique découle de la volonté du pollicitant,
qui seul peut décider du temps pendant lequel il consent à être lié en cas d’acceptation.
En pratique, l’exigence d’un délai permet de savoir si, au moment de l’acceptation, il existe
encore une rencontre des consentements des parties.
Par conséquent, le délai joue un rôle essentiel
et double, c’est-à-dire qu’il conditionne la validité de la formation du contrat et fixe la durée de vie
de l’offre.
Donc, c’est pour cette raison qu’il revient à l’offrant de bien le fixé.
En revanche, lorsque l’offrant n’a pas indiqué de délai, les choses deviennent plus complexe.
La jurisprudence a d’abord considéré que l’offre devait alors être encadrée par un délai moralement
acceptable (28 février 1870), puis dans un arrêt du 10 mai 1968, n°66-13.187 il y a eu la première
apparition de cette notion de « délai raisonnable ».
Dès lors, la volonté du pollicitant ne suffit plus,
et le juge devient l’arbitre de cette durée.
Si l’acceptation intervient dans ce laps de temps, le contrat
se forme ou sinon l’offre devient caduque.
Ainsi, si il n’y a pas de délai fixe, cela laisse place à un délai raisonnable, dont le juge fixe
les limites, néanmoins cela ouvre la voie à une certaine incertitude (B)
B – l’absence de délai, source d’insécurité juridique.
Ensuite, le rôle d’appréciation confié aux juges du fond a été confirmé par la Cour de
cassation, dans un arrêt du 25 mai 2005 (Civ.
3e, n°03-19.411).
La Haute juridiction a validée une
décision d’appel qui avait souverainement retenu qu’une offre sans stipulation de terme devait
s’analyser au regard d’un délai raisonnable.
En d’autres termes, même sans délai expresse de
l’offrant, l’offre n’est pas révocable immédiatement, elle doit subsister dans un temps jugé
raisonnable.
Cette solution est constante.
La Cour de cassation l’a rappelée à plusieurs reprises,
notamment dans des arrêts du 7 mai 2008 (Civ.
3e, n°07-11.690) ou encore du 20 mai 1992 (Civ.
3e,
n°90-15.910).
Dans ces décisions, les juges soulignent que le délai raisonnable dépend des
circonstances de l’espèce et des intentions exprimées par le pollicitant.
Par exemple, un délai de
quatre mois a pu être jugé excessif (Civ.
3e, 24 janv.
2012, n°10-27.965), alors qu’une durée de trois
mois a été considérée comme acceptable pour une vente de fonds de commerce (Com., 27 avr.
2011, n°10-17.177).
Toutefois, cette exigence de « délai raisonnable » soulève un problème de sécurité juridique.
Comment prévoir, en pratique, la durée exacte pendant laquelle une offre reste valable ?
L’imprévisibilité de la décision judiciaire rend la situation incertaine pour le destinataire, qui peut
ignorer si son acceptation interviendra dans le temps utile.
Certains auteurs estiment même que le
juge n’est pas chargé de remplacer la volonté du pollicitant à travers cette exigence de délai
raisonnable, il est là uniquement pour l’interpréter.
Le présent arrêt illustre bien ce paradoxe, en
affirmant que le délai raisonnable est « nécessairement contenu » dans l’offre, la Cour semble à la
fois reconnaître la primauté de la volonté de l’offrant et transférer au juge le soin de définir ce qui
est raisonnable.
Cette ambiguïté nourrit l’idée que la caducité, bien que nécessaire au vue du temps
écoulé entre la dernière offre (1996) et l’acceptation (2001), reste une source d’instabilité.
En conclusion, la reconnaissance d’un délai raisonnable laisse subsister une part
d’incertitude pour le destinataire,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire d'arrêt : Deuxième chambre civile de la cour de cassation, 28 février 1996 : droit
- Commentaire de l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 10 décembre 1985 (droit)
- Commentaire d'arrêt : Cass. Civ. 3e, 7 mai 2008, n° 07-11.690
- Fiche d'arrêt : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mars 2013, 11-28.845
- Commentaire d’arrêt : cour de cassation chambre commerciale ,audience publique du 27 février 1996 N° de pourvoi 94-11241