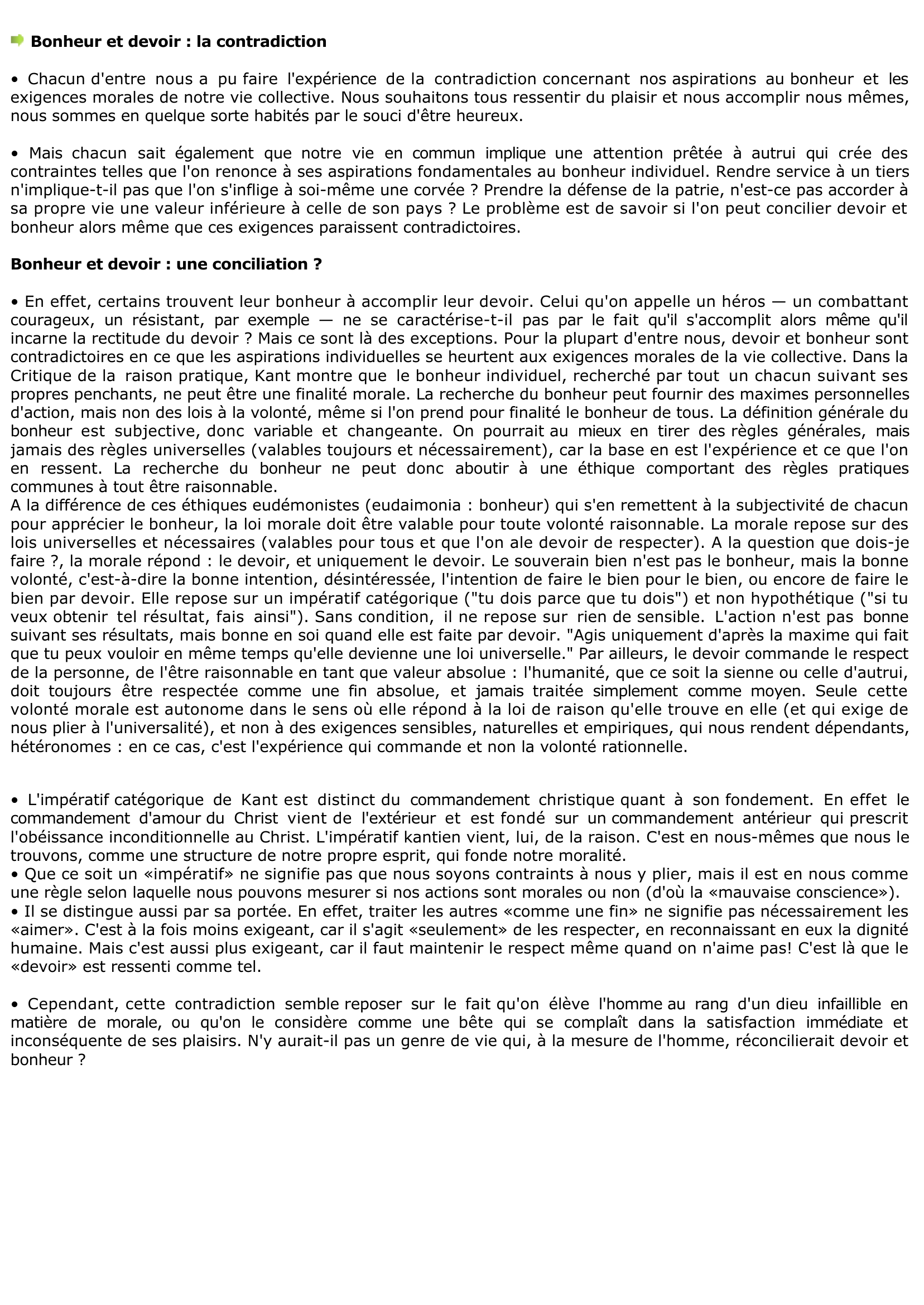Bonheur individuel et exigence morale ?
Publié le 15/05/2020

Extrait du document
«
Bonheur et devoir : la contradiction
• Chacun d'entre nous a pu faire l'expérience de la contradiction concernant nos aspirations au bonheur et lesexigences morales de notre vie collective.
Nous souhaitons tous ressentir du plaisir et nous accomplir nous mêmes,nous sommes en quelque sorte habités par le souci d'être heureux.
• Mais chacun sait également que notre vie en commun implique une attention prêtée à autrui qui crée descontraintes telles que l'on renonce à ses aspirations fondamentales au bonheur individuel.
Rendre service à un tiersn'implique-t-il pas que l'on s'inflige à soi-même une corvée ? Prendre la défense de la patrie, n'est-ce pas accorder àsa propre vie une valeur inférieure à celle de son pays ? Le problème est de savoir si l'on peut concilier devoir etbonheur alors même que ces exigences paraissent contradictoires.
Bonheur et devoir : une conciliation ?
• En effet, certains trouvent leur bonheur à accomplir leur devoir.
Celui qu'on appelle un héros — un combattantcourageux, un résistant, par exemple — ne se caractérise-t-il pas par le fait qu'il s'accomplit alors même qu'ilincarne la rectitude du devoir ? Mais ce sont là des exceptions.
Pour la plupart d'entre nous, devoir et bonheur sontcontradictoires en ce que les aspirations individuelles se heurtent aux exigences morales de la vie collective.
Dans la Critique de la raison pratique, Kant montre que le bonheur individuel, recherché par tout un chacun suivant sespropres penchants, ne peut être une finalité morale.
La recherche du bonheur peut fournir des maximes personnellesd'action, mais non des lois à la volonté, même si l'on prend pour finalité le bonheur de tous.
La définition générale dubonheur est subjective, donc variable et changeante.
On pourrait au mieux en tirer des règles générales, maisjamais des règles universelles (valables toujours et nécessairement), car la base en est l'expérience et ce que l'onen ressent.
La recherche du bonheur ne peut donc aboutir à une éthique comportant des règles pratiquescommunes à tout être raisonnable.A la différence de ces éthiques eudémonistes (eudaimonia : bonheur) qui s'en remettent à la subjectivité de chacunpour apprécier le bonheur, la loi morale doit être valable pour toute volonté raisonnable.
La morale repose sur deslois universelles et nécessaires (valables pour tous et que l'on ale devoir de respecter).
A la question que dois-jefaire ?, la morale répond : le devoir, et uniquement le devoir.
Le souverain bien n'est pas le bonheur, mais la bonnevolonté, c'est-à-dire la bonne intention, désintéressée, l'intention de faire le bien pour le bien, ou encore de faire lebien par devoir.
Elle repose sur un impératif catégorique ("tu dois parce que tu dois") et non hypothétique ("si tuveux obtenir tel résultat, fais ainsi").
Sans condition, il ne repose sur rien de sensible.
L'action n'est pas bonnesuivant ses résultats, mais bonne en soi quand elle est faite par devoir.
"Agis uniquement d'après la maxime qui faitque tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle." Par ailleurs, le devoir commande le respectde la personne, de l'être raisonnable en tant que valeur absolue : l'humanité, que ce soit la sienne ou celle d'autrui,doit toujours être respectée comme une fin absolue, et jamais traitée simplement comme moyen.
Seule cettevolonté morale est autonome dans le sens où elle répond à la loi de raison qu'elle trouve en elle (et qui exige denous plier à l'universalité), et non à des exigences sensibles, naturelles et empiriques, qui nous rendent dépendants,hétéronomes : en ce cas, c'est l'expérience qui commande et non la volonté rationnelle.
• L'impératif catégorique de Kant est distinct du commandement christique quant à son fondement.
En effet lecommandement d'amour du Christ vient de l'extérieur et est fondé sur un commandement antérieur qui prescritl'obéissance inconditionnelle au Christ.
L'impératif kantien vient, lui, de la raison.
C'est en nous-mêmes que nous letrouvons, comme une structure de notre propre esprit, qui fonde notre moralité.• Que ce soit un «impératif» ne signifie pas que nous soyons contraints à nous y plier, mais il est en nous commeune règle selon laquelle nous pouvons mesurer si nos actions sont morales ou non (d'où la «mauvaise conscience»).• Il se distingue aussi par sa portée.
En effet, traiter les autres «comme une fin» ne signifie pas nécessairement les«aimer».
C'est à la fois moins exigeant, car il s'agit «seulement» de les respecter, en reconnaissant en eux la dignitéhumaine.
Mais c'est aussi plus exigeant, car il faut maintenir le respect même quand on n'aime pas! C'est là que le«devoir» est ressenti comme tel.
• Cependant, cette contradiction semble reposer sur le fait qu'on élève l'homme au rang d'un dieu infaillible enmatière de morale, ou qu'on le considère comme une bête qui se complaît dans la satisfaction immédiate etinconséquente de ses plaisirs.
N'y aurait-il pas un genre de vie qui, à la mesure de l'homme, réconcilierait devoir etbonheur ?.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Rédigez une fable qui illustre le propos du texte (Fontenelle, Du bonheur, 1724), et dont la morale sera: chacun est envié pendant qu'il est lui même envieux...
- Les grandes conceptions de la vie morale: MORALE EMPIRISTE OU EUDÉMONISTE (MORALE DU BONHEUR) / MORALE DU SENTIMENT OU ALTRUISME
- Le souci du bonheur est-il étranger à la morale ?
- Analysez la notion de bonheur et précisez son rôle dans la vie morale. ?
- Le Bonheur peut-il être la fin de notre action morale ?