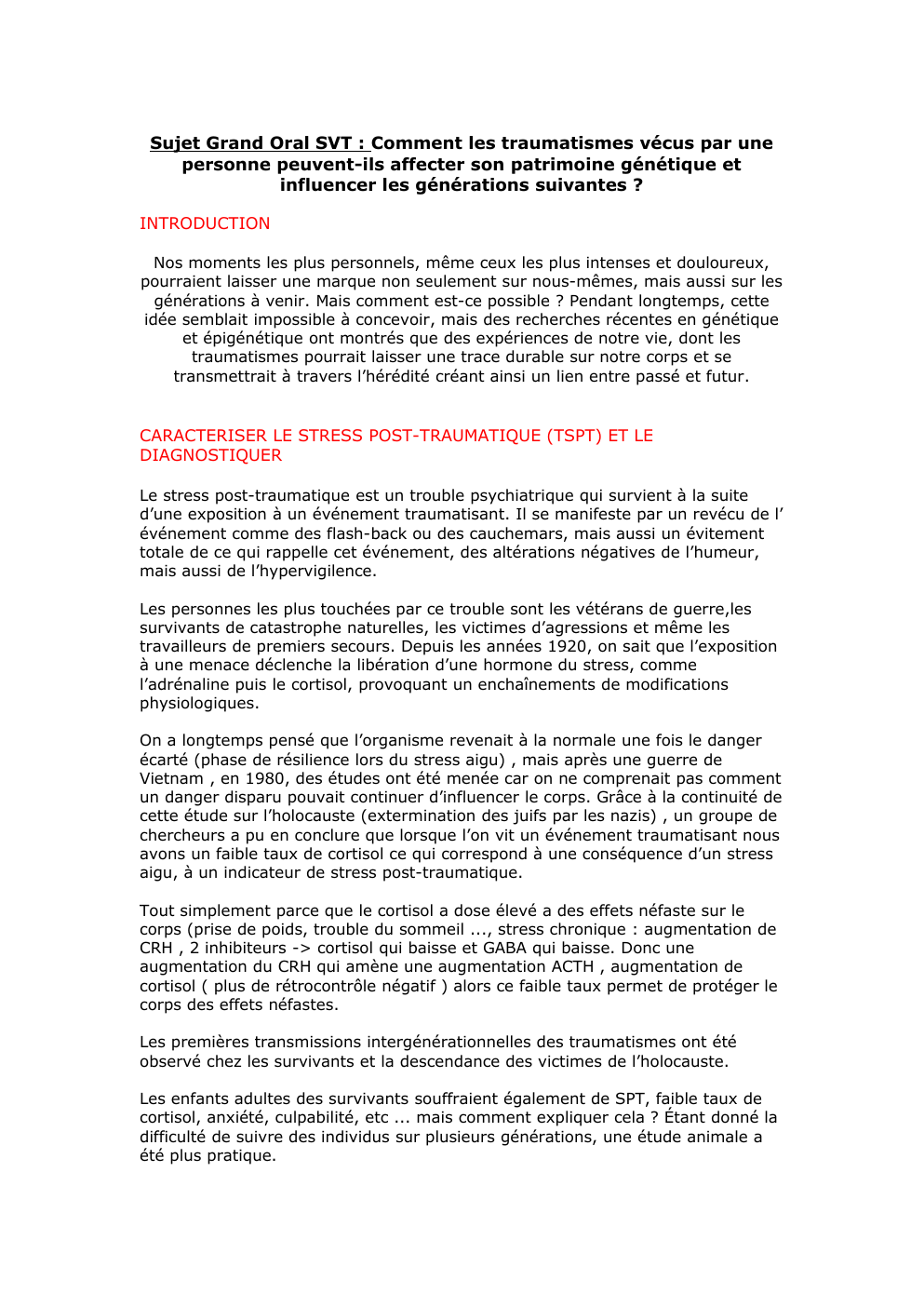Sujet Grand Oral SVT : Comment les traumatismes vécus par une personne peuvent-ils affecter son patrimoine génétique et influencer les générations suivantes ?
Publié le 28/05/2025
Extrait du document
«
Sujet Grand Oral SVT : Comment les traumatismes vécus par une
personne peuvent-ils affecter son patrimoine génétique et
influencer les générations suivantes ?
INTRODUCTION
Nos moments les plus personnels, même ceux les plus intenses et douloureux,
pourraient laisser une marque non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les
générations à venir.
Mais comment est-ce possible ? Pendant longtemps, cette
idée semblait impossible à concevoir, mais des recherches récentes en génétique
et épigénétique ont montrés que des expériences de notre vie, dont les
traumatismes pourrait laisser une trace durable sur notre corps et se
transmettrait à travers l’hérédité créant ainsi un lien entre passé et futur.
CARACTERISER LE STRESS POST-TRAUMATIQUE (TSPT) ET LE
DIAGNOSTIQUER
Le stress post-traumatique est un trouble psychiatrique qui survient à la suite
d’une exposition à un événement traumatisant.
Il se manifeste par un revécu de l’
événement comme des flash-back ou des cauchemars, mais aussi un évitement
totale de ce qui rappelle cet événement, des altérations négatives de l’humeur,
mais aussi de l’hypervigilence.
Les personnes les plus touchées par ce trouble sont les vétérans de guerre,les
survivants de catastrophe naturelles, les victimes d’agressions et même les
travailleurs de premiers secours.
Depuis les années 1920, on sait que l’exposition
à une menace déclenche la libération d’une hormone du stress, comme
l’adrénaline puis le cortisol, provoquant un enchaînements de modifications
physiologiques.
On a longtemps pensé que l’organisme revenait à la normale une fois le danger
écarté (phase de résilience lors du stress aigu) , mais après une guerre de
Vietnam , en 1980, des études ont été menée car on ne comprenait pas comment
un danger disparu pouvait continuer d’influencer le corps.
Grâce à la continuité de
cette étude sur l’holocauste (extermination des juifs par les nazis) , un groupe de
chercheurs a pu en conclure que lorsque l’on vit un événement traumatisant nous
avons un faible taux de cortisol ce qui correspond à une conséquence d’un stress
aigu, à un indicateur de stress post-traumatique.
Tout simplement parce que le cortisol a dose élevé a des effets néfaste sur le
corps (prise de poids, trouble du sommeil ..., stress chronique : augmentation de
CRH , 2 inhibiteurs -> cortisol qui baisse et GABA qui baisse.
Donc une
augmentation du CRH qui amène une augmentation ACTH , augmentation de
cortisol ( plus de rétrocontrôle négatif ) alors ce faible taux permet de protéger le
corps des effets néfastes.
Les premières transmissions intergénérationnelles des traumatismes ont été
observé chez les survivants et la descendance des victimes de l’holocauste.
Les enfants adultes des survivants souffraient également de SPT, faible taux de
cortisol, anxiété, culpabilité, etc ...
mais comment expliquer cela ? Étant donné la
difficulté de suivre des individus sur plusieurs générations, une étude animale a
été plus pratique.
Brian Dias et Kerry Ressler ont découvert une voie épigénétique
intergénérationnelle qui passe par le sperme.
Ils ont soumis des souris mâles a
une légère décharge électrique pendant qu’elles sentaient une odeur de fleur de
cerisier, ce qui leur a imprimé la peur de cette odeur.
Cette réponse s’est accompagnée de modifications épigénétiques dans leur
cerveau...
et dans leur sperme.
Or les descendantes mâles de ces souris ont
manifesté une peur similaire des fleurs de cerisier, tandis que des modifications
épigénétiques ont également été détectées dans leur cerveau et dans leur
sperme; elles n’avaient pourtant pas été elles-mêmes exposées à la décharger
électrique ! Ces effets ont perduré sur deux générations.
QU’EST CE QUE L’EPIGENETIQUE ? COMMENT CA MARCHE ?
Voyons maintenant comment la chute de cortisol et l’épigénétique sont mêlés.
L’épigénétique c’est l’étude des modifications des gènes qui ne changent pas la
séquence de l’ADN mais qui influencent l’expression génétique.
Ces modifications
peuvent être transmises lors de la division cellulaire et parfois de génération en
génération.
La chercheuse scientifique Rachel Yehuda a mené plusieurs études sur l’impact du
traumatisme chez les survivants de la shoah et leur descendant.
Ces travaux ont
permis la découverte de marqueur épigénétique qui les exposerais plus facilemetn
aux problèmes de santé mentale.
En 2015, elle a évalué 32 rescapés ainsi que leurs enfants adultes en examinant
le gène FKBP5, un gène associé à l’anxiété et à d’autres troubles mentaux.
En
étudiant de l’ADN d’échantillons sanguins, l’équipe a identifié des changements
épigénétiques dans la même région du gène chez les rescapés et chez leurs
enfants.
Ces modifications étaient absentes chez un groupe témoin de familles juives
n’ayant pas été exposées à la Shoah.
Ce résultat suggère donc une transmission
intergénérationnelle du traumatisme à travers l’épigénétique
Dans une étude ultérieure publiée en 2020, Rachel Yehuda a examiné un groupe
plus importante de sujets et s’est intéressée à des variables telles que le sexe et
l’âge du parent durant la Shoah.
Elle a alors scruté la méthylation de l’ADN, des
petites molécules qui se fixe sur l’ADN pour activer des gènes, à l’inverse la
déméthylation les inhibent.
Les enfants dont la mère avait survécu à la Shoah présentaient un taux de
déméthylation de l’ADN sur le gène FKBP5 plus faible que chez les Juifs du groupe
témoin dont les parents n’avaient pas connu la Shoah.
Cette réduction de la
méthylation de l’ADN sur le gène FKBP5 serait associé à un risque accru de
troubles tels que le syndrome de stress post-traumatique....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Grand Oral SVT – Xéroderma Pigmentosum
- Grand oral svt: comment la pression scolaire peut-elle être source de stress chronique?
- Grand Oral de Spé SVT: Le porc est-il le donneur potentiel pour une xénogreffe ?
- Grand oral SVT : Le dopage permet-il de devenir un surhomme?
- grand oral svt: En quoi la rééducation permet elle d’améliorer les séquelles d’un AVC ?