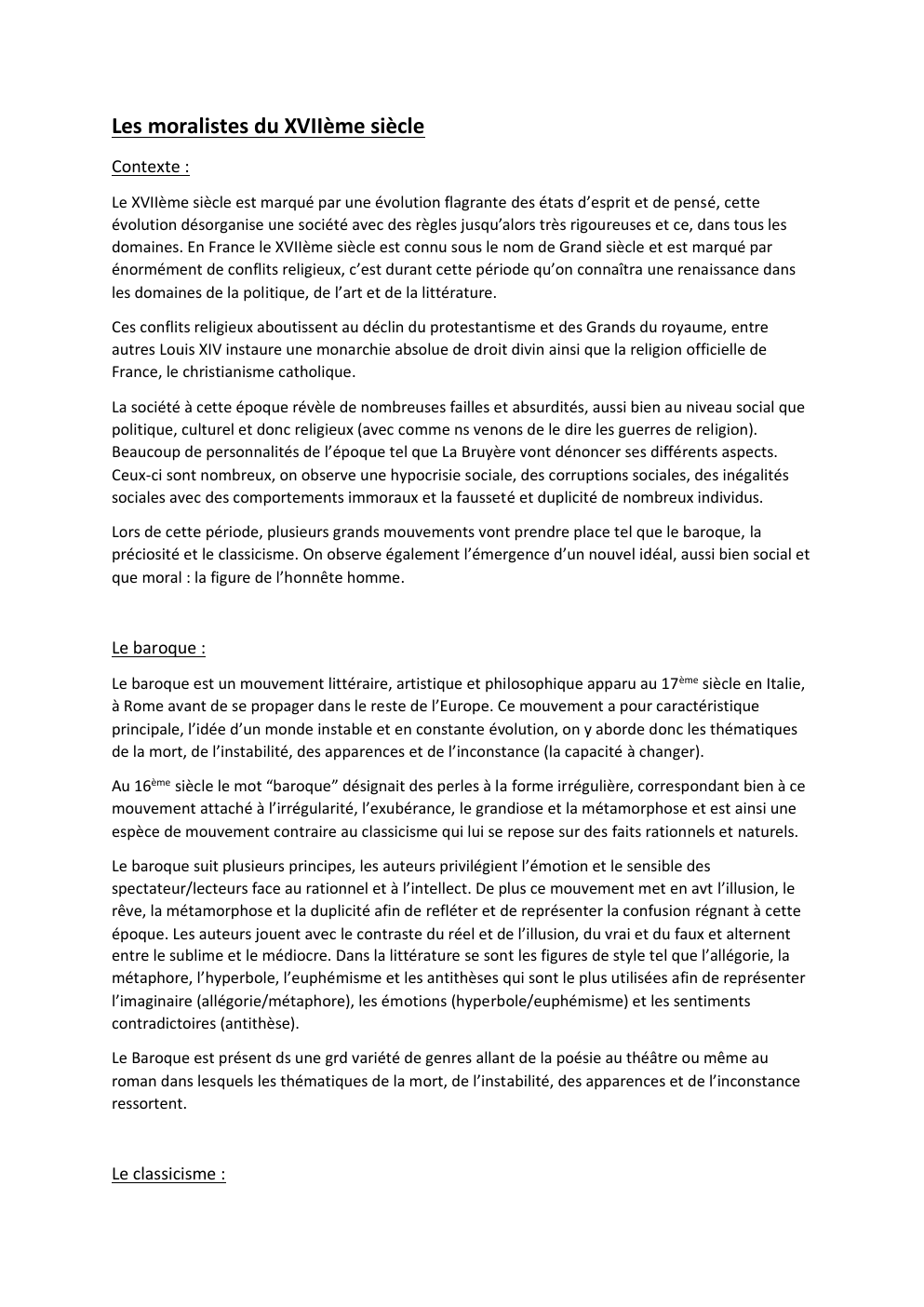Les moralistes du XVIIème siècle
Publié le 14/05/2025
Extrait du document
«
Les moralistes du XVIIème siècle
Contexte :
Le XVIIème siècle est marqué par une évolution flagrante des états d’esprit et de pensé, cette
évolution désorganise une société avec des règles jusqu’alors très rigoureuses et ce, dans tous les
domaines.
En France le XVIIème siècle est connu sous le nom de Grand siècle et est marqué par
énormément de conflits religieux, c’est durant cette période qu’on connaîtra une renaissance dans
les domaines de la politique, de l’art et de la littérature.
Ces conflits religieux aboutissent au déclin du protestantisme et des Grands du royaume, entre
autres Louis XIV instaure une monarchie absolue de droit divin ainsi que la religion officielle de
France, le christianisme catholique.
La société à cette époque révèle de nombreuses failles et absurdités, aussi bien au niveau social que
politique, culturel et donc religieux (avec comme ns venons de le dire les guerres de religion).
Beaucoup de personnalités de l’époque tel que La Bruyère vont dénoncer ses différents aspects.
Ceux-ci sont nombreux, on observe une hypocrisie sociale, des corruptions sociales, des inégalités
sociales avec des comportements immoraux et la fausseté et duplicité de nombreux individus.
Lors de cette période, plusieurs grands mouvements vont prendre place tel que le baroque, la
préciosité et le classicisme.
On observe également l’émergence d’un nouvel idéal, aussi bien social et
que moral : la figure de l’honnête homme.
Le baroque :
Le baroque est un mouvement littéraire, artistique et philosophique apparu au 17ème siècle en Italie,
à Rome avant de se propager dans le reste de l’Europe.
Ce mouvement a pour caractéristique
principale, l’idée d’un monde instable et en constante évolution, on y aborde donc les thématiques
de la mort, de l’instabilité, des apparences et de l’inconstance (la capacité à changer).
Au 16ème siècle le mot “baroque” désignait des perles à la forme irrégulière, correspondant bien à ce
mouvement attaché à l’irrégularité, l’exubérance, le grandiose et la métamorphose et est ainsi une
espèce de mouvement contraire au classicisme qui lui se repose sur des faits rationnels et naturels.
Le baroque suit plusieurs principes, les auteurs privilégient l’émotion et le sensible des
spectateur/lecteurs face au rationnel et à l’intellect.
De plus ce mouvement met en avt l’illusion, le
rêve, la métamorphose et la duplicité afin de refléter et de représenter la confusion régnant à cette
époque.
Les auteurs jouent avec le contraste du réel et de l’illusion, du vrai et du faux et alternent
entre le sublime et le médiocre.
Dans la littérature se sont les figures de style tel que l’allégorie, la
métaphore, l’hyperbole, l’euphémisme et les antithèses qui sont le plus utilisées afin de représenter
l’imaginaire (allégorie/métaphore), les émotions (hyperbole/euphémisme) et les sentiments
contradictoires (antithèse).
Le Baroque est présent ds une grd variété de genres allant de la poésie au théâtre ou même au
roman dans lesquels les thématiques de la mort, de l’instabilité, des apparences et de l’inconstance
ressortent.
Le classicisme :
Le classicisme est un mouvement littéraire, culturel et artistique apparu en Italie à la fin du 16ème
siècle avant de se propager dans le reste de l’Europe et de toucher la France au début du 17ème
siècle.
Son but est de « placere et docere » soit « plaire et instruire » par le biais, le plus souvent de
pièces de théâtre, et qui la plupart du temps sont destinés au roi Louis XIV et à sa cour (ex : Molière
favori du roi qui jouait pr la cour).
Ce mouvement est comme nous l’avons dit plus tôt complètement
opposé aux idées du mouvement Baroque et ce par une composition claire et ordonnée reposant sur
des règles esthétiques et morales tel que la clarté dans le style, l’inspiration antique et le désir
d’instruire, de délivrer un message/une morale.
On peut noter les règles des 3 unités, de la
bienséance et de la vraisemblance.
Les pièces écrites sont le plus souvent de l’ordre du comique, de
la satire ou encore (rarement) de la tragédie afin de délivrer un message profond.
La préciosité :
La préciosité est un mouvement social et littéraire apparu en France au début du 17ème siècle dans la
noblesse avant de se propager peu à peu chez la bourgeoisie.
Ce mouvement a pour but de traduire
les mœurs de l’aristocratie par un comportement social (les manières, le langage, les sentiments, les
goûts ou mêmes les idées morales) poussé à l’extrême d’une délicatesse et raffinement artificiels.
Les personnes qui suivent cette façon de penser sont majoritairement des femmes appelées les
« précieuses », ce mouvement est avant tout féminin voir même féministe.
Les Précieuses cherchent
le plus souvent à se faire remarquer par leurs manières exagérées et sont en constante recherche
d’élégance et de bon goût.
La préciosité comme nous l’avons dit plus tôt est considéré comme féministe car initié par des
femmes qui souhaitent l’égalité homme/femme et qui vont à partir de ce moment-là dicter la
conduite des hommes en matière d’amour, ce qui est une 1ère à cette époque.
Le thème principal de la préciosité est donc l’amour et sera présenté à travers des genres à la mode
à cette époque : l’épître en vers (une lettre/discours écrit sous forme de vers), le sonnet (poème
avec 2 quatrains et 2 tercets) et l’épigramme (petit poème satirique).
Genres fragmentaires :
L’écriture fragmentaire est apparue au 17ème siècle pour la première fois et a alors connu une vogue
momentanée chez le public.
Cette écriture est souvent désignée comme aphoristique (constituée de
bcp de propositions concises résumant une morale/point essentiel d’une théorie) voir épistolaire
(rapport avec la correspondance par lettre) et est présente dans ce qu’on appelle un ouvrage
fragmentaire.
Un ouvrage fragmentaire est une succession de textes courts, appelés fragments, sans
forcément de liens directs les uns entres les autres mais formant tout de même un tout.
Ces œuvres
font partis du genre moraliste.
Etymologiquement le terme fragment renvoie à la violence de la désintégration, de la dispersion et
de la perte, ce qui correspond plutôt bien au contexte violent et désordonné de l’époque.
C’est au
cours du temps qu’il sera considéré comme un genre à part entière.
Le Moralisme
Le mouvement moraliste, qui a émergé principalement au XVIIe siècle en France, se caractérise par
une attention particulière portée aux valeurs morales, à l’éthique et à la nature humaine.
Les
moralistes ont cherché à analyser et à critiquer les comportements humains, souvent à travers des
écrits tel que les portraits, les maximes, les essais et les caractères.
Les moralistes étaient souvent
préoccupés par les vices et les vertus, explorant les contradictions de la nature humaine.
Ils ont
remis en question l’idée de la vertu pure, soulignant souvent l'ambiguïté morale des actions
humaines, mais remettent également en question des fondements sociétaux.
Parmi les thèmes
récurrents, on trouve l’amour-propre, l’hypocrisie, la vanité et les faiblesses humaines.
On peut citer plusieurs grands moralistes tel que Blaise Pascal, Rochefoucauld ou encore la Bruyère
sur lesquels nous allons maintenant nous pencher.
Blaise Pascal (19 juin 1623 – 19 août 1662) :
Blaise Pascal est un mathématicien, physicien, philosophe et moraliste français.
Il est devenu connu
après sa mort et après la découverte de ses écrits personnels dans lesquels il notait ses pensées sur
plusieurs thématiques différentes mais principalement sur la religion.
Toutes ces notes seront
publiées sous le nom “ Les Pensées” en 1969 (pls années après sa mort).
Cette œuvre appartient au mouvement classique et est intimement lié au genre moraliste.
Dans ces
textes Pascal aborde des réflexions et des paradoxes sur la condition humaine.
Etant mathématicien,
il se rend compte au fur et à mesure de ses études de la disproportion des forces de l’univers par
rapport à celles humaines.
C’est ainsi qu’il rédige tout au long de sa vie cette compilation de
fragments, notes et pensées présentant des morales et réflexions profondes sur notre nature,
incitant le lecteur à une remise en question.
De plus cet ouvrage, mimant les différentes étapes de la
pensée, est présenté de façon désorganisée et floue à l’image des pensées.
Blaise Pascal va
permettre l’introduction du terme “divertissement pascalien”, terme rappelant le sens originel du
mot “divertissement” qui veut dire “se détourner de”.
Ce nouveau terme permet l’introduction
d’une réflexion sur l’Homme et de sa capacité à se détourner de lui-même et à s’échapper de la
réalité (de son caractère mortel) en tentant de combler l’angoisse de cette réalité par des
divertissements.
Blaise Pascal fait de plus le lien entre cette envie de l’homme de combler un vide existentiel et la
nécessité de la foi.
Foi dans laquelle l’homme se consolerait et trouverait une raison de vivre.
Il
introduit ainsi ce qu’on appelle le “Pari Pascalien”, d’après lui, croire ou ne pas croire en Dieu serait
une sorte de pari, le choix le plus rationnel serait de parier sur l’existence de dieu car les bénéfices
potentiels (tel que la vie éternelle et le paradis) pouvant en découler l’emporteraient largement sur
le coût de la non-croyance.
C’est avec notre regard moderne qu’on peut maintenant déceler chez Pascal ce qui ressemblerait à
la philosophie de l’absurde.
Rochefoucauld....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Objet d'étude : La poésie du XIX et du XX siècle. Parcours complémentaire : Alchimie poétique : réinventer le monde. Analyse linéaire 2/2 « Le Pain », Francis Ponge, Le Parti pris des choses, 1942
- Synthèse XIXème siècle – 2ème partie.
- DM HISTOIRE : les ouvriers au sein de la République à la fin du XIXème siècle
- De poésie du 18e au 21e siècle : Modernité poétique ?
- GRAND ORAL: LE STRESS EST-IL UNE MALADIE DU 21e SIÈCLE ?