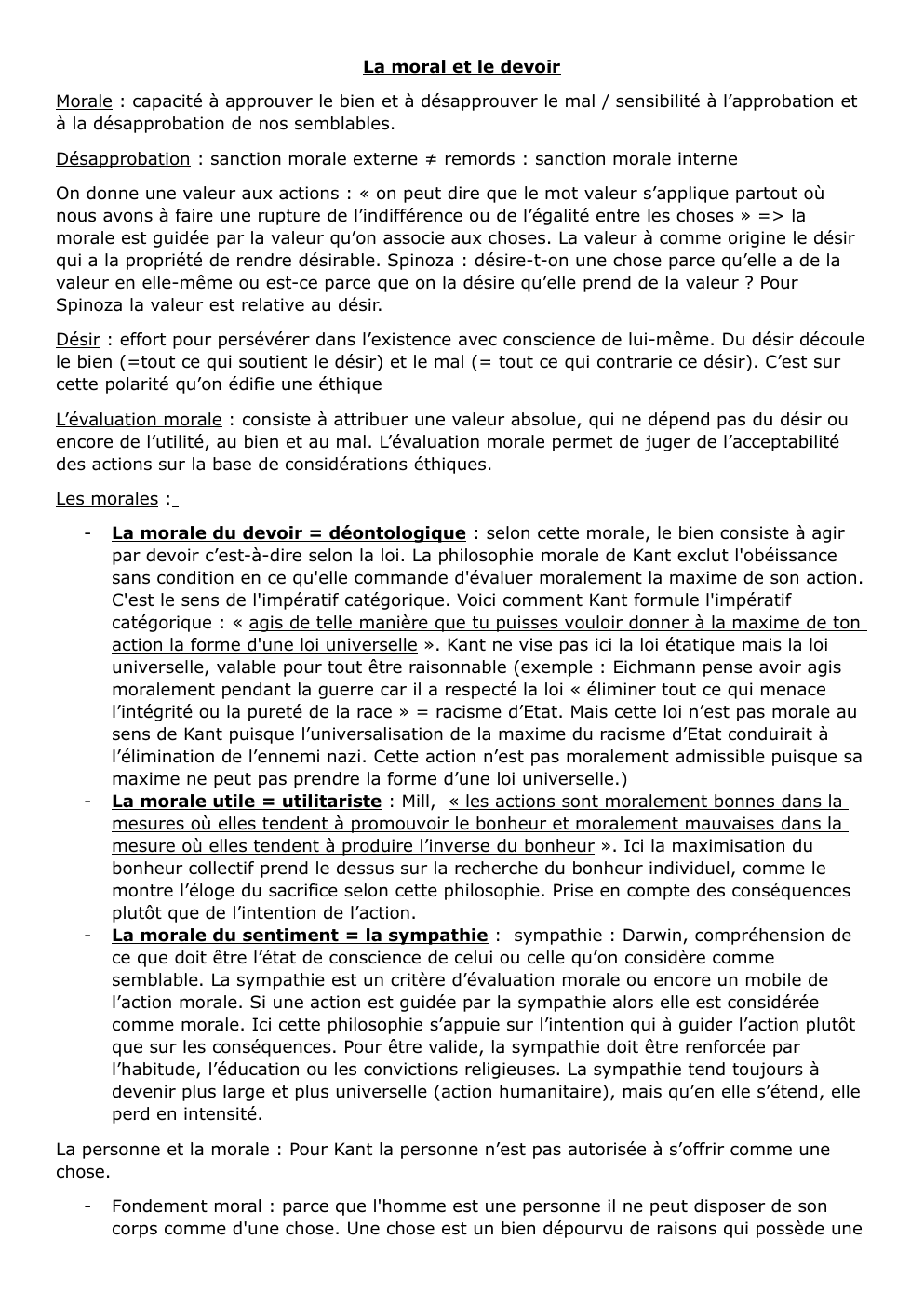La morale et le devoir
Publié le 18/05/2025
Extrait du document
«
La morale et le devoir
Morale : capacité à approuver le bien et à désapprouver le mal / sensibilité à l’approbation et
à la désapprobation de nos semblables.
Désapprobation : sanction morale externe ≠ remords : sanction morale interne
On donne une valeur aux actions : « on peut dire que le mot valeur s’applique partout où
nous avons à faire une rupture de l’indifférence ou de l’égalité entre les choses » => la
morale est guidée par la valeur qu’on associe aux choses.
La valeur à comme origine le désir
qui a la propriété de rendre désirable.
Spinoza : désire-t-on une chose parce qu’elle a de la
valeur en elle-même ou est-ce parce que on la désire qu’elle prend de la valeur ? Pour
Spinoza la valeur est relative au désir.
Désir : effort pour persévérer dans l’existence avec conscience de lui-même.
Du désir découle
le bien (=tout ce qui soutient le désir) et le mal (= tout ce qui contrarie ce désir).
C’est sur
cette polarité qu’on édifie une éthique
L’évaluation morale : consiste à attribuer une valeur absolue, qui ne dépend pas du désir ou
encore de l’utilité, au bien et au mal.
L’évaluation morale permet de juger de l’acceptabilité
des actions sur la base de considérations éthiques.
Les morales :
-
-
-
La morale du devoir = déontologique : selon cette morale, le bien consiste à agir
par devoir c’est-à-dire selon la loi.
La philosophie morale de Kant exclut l'obéissance
sans condition en ce qu'elle commande d'évaluer moralement la maxime de son action.
C'est le sens de l'impératif catégorique.
Voici comment Kant formule l'impératif
catégorique : « agis de telle manière que tu puisses vouloir donner à la maxime de ton
action la forme d'une loi universelle ».
Kant ne vise pas ici la loi étatique mais la loi
universelle, valable pour tout être raisonnable (exemple : Eichmann pense avoir agis
moralement pendant la guerre car il a respecté la loi « éliminer tout ce qui menace
l’intégrité ou la pureté de la race » = racisme d’Etat.
Mais cette loi n’est pas morale au
sens de Kant puisque l’universalisation de la maxime du racisme d’Etat conduirait à
l’élimination de l’ennemi nazi.
Cette action n’est pas moralement admissible puisque sa
maxime ne peut pas prendre la forme d’une loi universelle.)
La morale utile = utilitariste : Mill, « les actions sont moralement bonnes dans la
mesures où elles tendent à promouvoir le bonheur et moralement mauvaises dans la
mesure où elles tendent à produire l’inverse du bonheur ».
Ici la maximisation du
bonheur collectif prend le dessus sur la recherche du bonheur individuel, comme le
montre l’éloge du sacrifice selon cette philosophie.
Prise en compte des conséquences
plutôt que de l’intention de l’action.
La morale du sentiment = la sympathie : sympathie : Darwin, compréhension de
ce que doit être l’état de conscience de celui ou celle qu’on considère comme
semblable.
La sympathie est un critère d’évaluation morale ou encore un mobile de
l’action morale.
Si une action est guidée par la sympathie alors elle est considérée
comme morale.
Ici cette philosophie s’appuie sur l’intention qui à guider l’action plutôt
que sur les conséquences.
Pour être valide, la sympathie doit être renforcée par
l’habitude, l’éducation ou les convictions religieuses.
La sympathie tend toujours à
devenir plus large et plus universelle (action humanitaire), mais qu’en elle s’étend, elle
perd en intensité.
La personne et la morale : Pour Kant la personne n’est pas autorisée à s’offrir comme une
chose.
-
Fondement moral : parce que l'homme est une personne il ne peut disposer de son
corps comme d'une chose.
Une chose est un bien dépourvu de raisons qui possède une
-
valeur relative à son utilité.
Une personne est un être doué de raison qu'on ne peut pas
employer simplement comme un moyen ce qui implique que la personne possède une
dignité c'est-à-dire une valeur indépendante de son utilité c'est à dire sans prix.
Fondement logique : ce fondement repose sur une contradiction prise dans un
raisonnement.
La propriété est un droit s'exerçant sur les choses Or l'homme n'est pas
une chose mais une personne qui peut être propriétaire des choses donc l'homme ne
serait pas disposé de son corps comme d'une chose dont il serait le propriétaire =
indisponibilité du corps à la vente.
Cependant si la vente du corps et encadré par un contrat, qui est l'expression de la volonté
de la personne qui contracte, alors (Rothbard) :« chaque homme a un droit absolu de
contrôler et de posséder son propre corps » « tout droit de propriété légitime et déduit de la
propriété de chaque homme sur sa propre personne ».
Exemple : l’avortement.
Morale minimaliste : nous avons des devoirs qu’envers les autres (devoir négatif = nous
interdisent de faire quelque chose de moralement mauvais)
Morale maximaliste : nous avons des devoirs envers les autres et envers nous-même (devoir
positif : nous obligent à faire du bien à autrui)
Le bonheur et la justice
Le bonheur : tout le reste pour ainsi dire et rechercher en vue d'une autre chose tout sauf le
bonheur qui est par lui-même une fin.
Une fin est désirée pour elle-même et non désirée en
vue d'autre chose.
Quels moyens subordonnés à cette fin qui est le bonheur ? Comment vivre pour se le
procurer ? Le bonheur réside-il dans la démesure l'excès le dérèglement ou dans la mesure la
prudence le calcul des plaisirs et des peines ?
I/ La démesure
Hubris : démesure qui est celle du désir « quand déraisonnablement un désir nous entraîne
vers les plaisirs et nous gouverne ce gouvernement reçoit le nom d’Hubris » Platon
Le désir à la particularité de s'augmenter de ce qu'il obtient.
Le désir engendre la démesure
c'est-à-dire le dépassement des limites imposées par la tempérance la tempérance consiste à
commander en soi au désir et au plaisir en cherchant par exemple à rabattre le désir sur le
besoin c'est-à-dire à ne désirer que ce dont on a besoin.
Selon Calliclès à tempérance est
incompatible avec le bonheur car contre nature.
Ce que veut la nature selon lui c'est qu'on
laisse prendre à ses passions tout l'accroissement possible au lieu de les réprimer.
Cependant l'intempérance conduit à l'injustice car on désire s'approprier plus que ce qui nous
est dû.
Donc incompatibilité du bonheur et de la justice.
On peut alors se demander si l'homme injuste peut être heureux.
On prend l'exemple du
tyran qui est un homme injuste qui se procure des plaisirs au préjudice des autres c'est-àdire en commettant l'injustice, il mène une existence incompatible avec la justice instituée
celle que le droit exprime et codifie, puisqu'il vit dans la contradiction car il a conscience que
par nature il est bon de commettre l'injustice et mauvais de la subir, alors que par convention
il est mauvais de la commettre car on s'expose à un châtiment c'est-à-dire un mal voulu par
la loi.
Dans le Criton de Platon, Socrate énonce le principe de justice auquel il se soumet de
manière autonome : ne commettre l'injustice en aucune circonstance
L'éloge hypocrite de la justice : chacun pense qu'il est individuellement profitable de
commettre l'injustice mais comme nul n'a l'assurance de la commettre sans la subir, on
convient de ne plus la commettre pour ne pas avoir à la subir, c'est pour Platon l'origine des
lois de la cité.
On comprend alors que le désir de justice nait en la plupart des
hommes en la crainte de subir l'injustice.
II/ le calcul des plaisirs et des peines
la morale en général est restée l'art de diriger les actions des hommes de manière à produire
la plus grande somme possible de bonheur Bentham.
La morale est conçue comme un calcul
des plaisirs et des peines reposant sur les éléments du calcul moral : intensité durée
proximité certitude fécondité pureté et l'étendue.
L'étendue est le critère par lequel l'égoïsme du bonheur personnel est surmonté l'étendue a
comme origine la sympathie (= la disposition qui nous fait trouver du plaisir dans le bonheur
des autres êtres sensibles et compatir à leurs peines).
Avec ce critère de l'étendue on aboutit
au principe de maximisation du bonheur.
Cependant bonheur ne peut pas se mesurer, or en
procédant à un calcul utilitaire on donne une mesure à nos espoirs et nos craintes alors il est
incompatible avec le bonheur.
Ce calcul peut nous permettre de nous procurer du plaisir mais
le bonheur est une notion bien plus compliquée qui ne s’atteint pas par un simple calcul des
plaisirs et des peines.
D'autre part si on croit que le bonheur réside dans la multiplication des
plaisirs intenses mais impurs alors il y a de fortes chances que l'espoir soit déçu.
Ni des
actions pures ni des actions impures peuvent nous mener au bonheur.
Le bonheur découle
d'un dédoublement de la raison avec d'un côté le rationnel et de l'autre le raisonnable.
III/ un concept au contenu indéterminé
Le bonheur est un....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Devoir Maison sur la morale: peut-on juger moralement autrui ?
- Devoir philo Deux sources de la Morale et de la Religion, Bergson : l'obéissance des individus au devoir moral
- Kant (1724-1804): « QUE DOIS-JE FAIRE ? », LE DEVOIR, LA MORALE ET LA RAISON
- Fiches philo: Le travail, la justice, la morale et la politique, le devoir, la conscience (morale), la science, la technique
- "L'obéissance au devoir est une résistance à soi- même." Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion. Commentez cette citation.