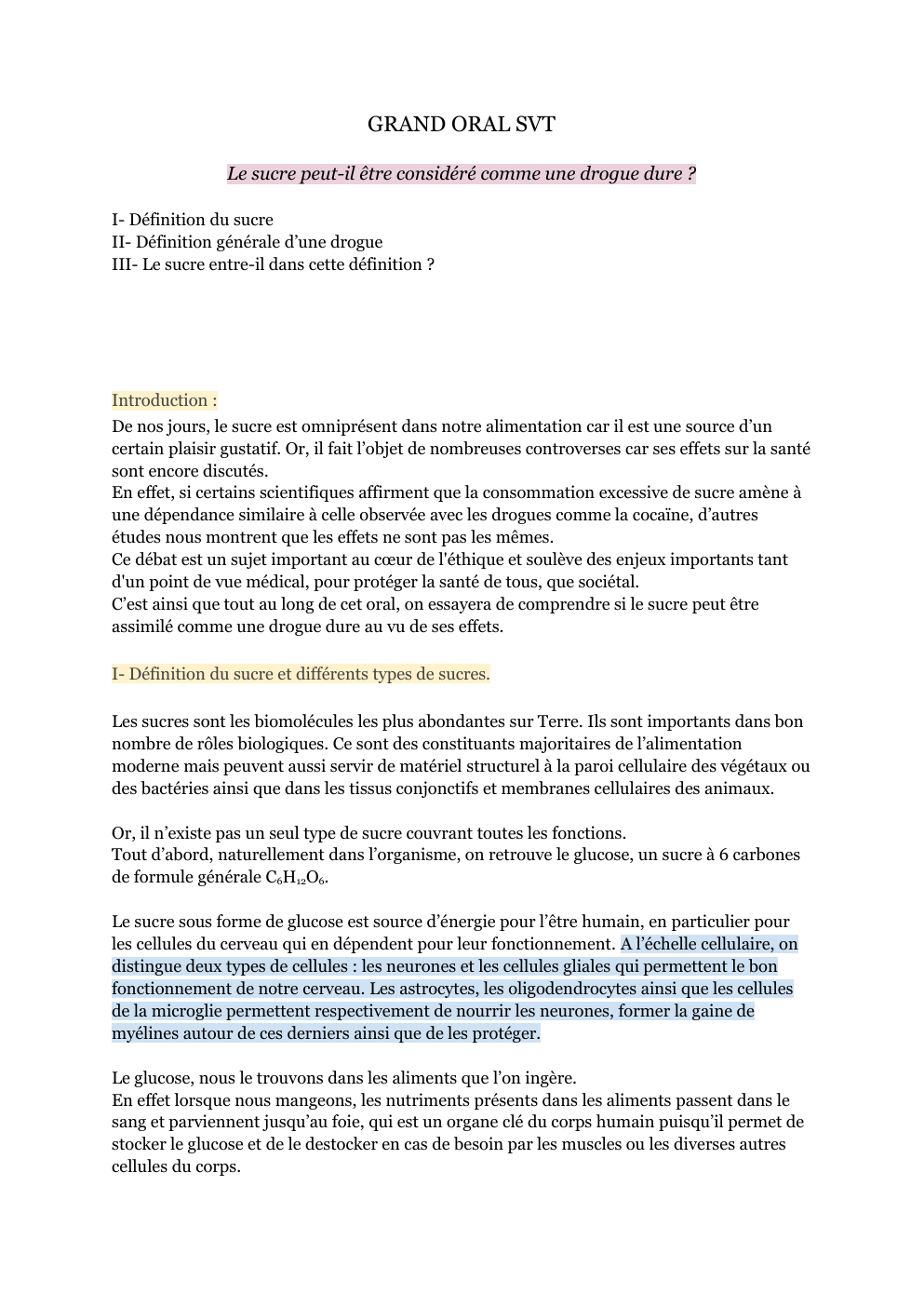GRAND ORAL SVT Le sucre peut-il être considéré comme une drogue dure ?
Publié le 26/06/2025
Extrait du document
«
GRAND ORAL SVT
Le sucre peut-il être considéré comme une drogue dure ?
I- Définition du sucre
II- Définition générale d’une drogue
III- Le sucre entre-il dans cette définition ?
Introduction :
De nos jours, le sucre est omniprésent dans notre alimentation car il est une source d’un
certain plaisir gustatif.
Or, il fait l’objet de nombreuses controverses car ses effets sur la santé
sont encore discutés.
En effet, si certains scientifiques affirment que la consommation excessive de sucre amène à
une dépendance similaire à celle observée avec les drogues comme la cocaïne, d’autres
études nous montrent que les effets ne sont pas les mêmes.
Ce débat est un sujet important au cœur de l'éthique et soulève des enjeux importants tant
d'un point de vue médical, pour protéger la santé de tous, que sociétal.
C’est ainsi que tout au long de cet oral, on essayera de comprendre si le sucre peut être
assimilé comme une drogue dure au vu de ses effets.
I- Définition du sucre et différents types de sucres.
Les sucres sont les biomolécules les plus abondantes sur Terre.
Ils sont importants dans bon
nombre de rôles biologiques.
Ce sont des constituants majoritaires de l’alimentation
moderne mais peuvent aussi servir de matériel structurel à la paroi cellulaire des végétaux ou
des bactéries ainsi que dans les tissus conjonctifs et membranes cellulaires des animaux.
Or, il n’existe pas un seul type de sucre couvrant toutes les fonctions.
Tout d’abord, naturellement dans l’organisme, on retrouve le glucose, un sucre à 6 carbones
de formule générale C6H12O6.
Le sucre sous forme de glucose est source d’énergie pour l’être humain, en particulier pour
les cellules du cerveau qui en dépendent pour leur fonctionnement.
A l’échelle cellulaire, on
distingue deux types de cellules : les neurones et les cellules gliales qui permettent le bon
fonctionnement de notre cerveau.
Les astrocytes, les oligodendrocytes ainsi que les cellules
de la microglie permettent respectivement de nourrir les neurones, former la gaine de
myélines autour de ces derniers ainsi que de les protéger.
Le glucose, nous le trouvons dans les aliments que l’on ingère.
En effet lorsque nous mangeons, les nutriments présents dans les aliments passent dans le
sang et parviennent jusqu’au foie, qui est un organe clé du corps humain puisqu’il permet de
stocker le glucose et de le destocker en cas de besoin par les muscles ou les diverses autres
cellules du corps.
“Le goût pour le sucre” ne correspond donc pas à un appétit pour le glucose, puisque
l’organisme sait tirer les ressources dont il a besoin, dans les aliments qu’il mange.
Le goût sucré le plus répandu est celui d’une molécule que l’on appelle le saccharose.
Le saccharose est formé de l’association de deux molécules cycliques : une molécule de
glucose ( C6H12O6 ) et une molécule de fructose, qui présente la même formule brute que ses
isomères, en particulier le glucose.
Il fait partie de la famille des polysaccharides.
Sa formule
générale est C12H22O11
C’est le sucre le plus utilisé dans l’industrie agroalimentaire, en particulier pour la
confection des confiseries, pâtisseries… Il constitue ainsi le sucre blanc de table, après avoir
subit une étape de raffinage qui lui retire des vitamines et des minéraux afin d’obtenir un
sucre dit raffiné.
Le goût du sucre est donc généralement rapporté aux sucres rapides, qui sont très
rapidement absorbés par l’organisme, dans le sang puis, dans le foie, contrairement aux
sucres lents comme l’amidon.
II- Définition générale d’une drogue
Par définition, une drogue est une substance psychotrope ou psychoactive qui perturbe le
fonctionnement du système nerveux central ou qui modifie les états de conscience.
Cette
substance entraîne une dépendance physique ou psychique, à l’origine d’une addiction
motivant un comportement de recherche continuelle et de manque d’un produit en
particulier.
La notion de drogue, en plus d'être caractérisée par des éléments biochimiques,
est également caractérisée par la législation internationale sur les stupéfiants.
La première
convention internationale sur le sujet s'est tenue en 1909 à Shanghai et concernait surtout
l'opium et ses dérivés.
Notre cerveau est constitué de nombreuses aires qui communiquent entre elles par le biais
de neurones .
Un neurone est formé d’un corps cellulaire qui renferme le noyau, de petits
prolongements cytoplasmiques appelés dendrites et d’un long et fin prolongement
cytoplasmique appelé axone qui se termine par plusieurs boutons synaptiques.
Un message
nerveux de type électrique circule le long de l’axone.
Le système de récompense est une de ces voies neuronales.
Ce système est à l’origine de la
sensation de plaisir.
Il fait intervenir un neurotransmetteur clé : la dopamine.
Entre deux neurones, on trouve un espace de vide : une synapse.
Au sein de cette synapse
voyagent des neurotransmetteurs qui permettent au message nerveux de circuler entre
différents neurones sans être bloqué par le vide.
Le message nerveux sous forme de potentiel
d’action ( électrique ), arrive au niveau de l'élément pré synaptique et déclenche la libération
des neurotransmetteurs contenus dans les vésicules synaptiques.
L’absence de neurotransmetteurs couperait toute communication des aires corticales entre
elles puisque les signaux électriques ne franchissent pas la synapse.
Les molécules exogènes ( les drogues ) peuvent empêcher la circulation des
neurotransmetteurs au sein de la synpase en se fixant aux récepteurs spécifiques à ces
molécules ou encore mimer ou amplifier l’effet de ces neurotransmetteurs grâce à leur
structure moléculaire très proche.
Les drogues perturbent ainsi le fonctionnement du système nerveux notamment en agissant
Il est important de noter qu’une légère augmentation ou diminution de la sécrétion de
dopamine à des conséquences déjà majeures sur les effets ressentis par une personne.
La prise prolongée de drogue peut résulter des modifications du comportement et des
diminutions des capacités cognitives.
La consommation de ces substances peut parfois être responsable des comportements
addictifs.
L’addiction est une dépendance à une substance motivant un comportement
compulsif de recherche et de consommation de ce produit.
En effet, les substances
psychoactives ou psychotropes augmentent la libération de dopamine et le consommateur
ressent le besoin de renouveler le comportement pour retrouver la sensation agréable qu’il a
connu.
De nombreux symptômes laissent présager qu’un individu est atteint d’addiction : un besoin
incompressible de consommer, une perte de contrôle qualitative et temporelle, un temps
consacré à la drogue très important…
Une personne est diagnostiquée accro lorsqu’elle présente au moins deux de tous les
symptômes.
L’addiction est une pathologie reconnue.
III- Le sucre entre-il dans cette définition ?
En 2009, des chercheurs de l’université Yale, aux USA, se sont demandé si l’on peut
appliquer aux nourritures hautement palatables, qui ont bon goût, les critères utilisés pour
rendre compte de l’addiction aux drogues, et si l’on peut identifier....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Grand Oral SVT – Xéroderma Pigmentosum
- Grand oral svt: comment la pression scolaire peut-elle être source de stress chronique?
- Grand Oral de Spé SVT: Le porc est-il le donneur potentiel pour une xénogreffe ?
- Grand oral SVT : Le dopage permet-il de devenir un surhomme?
- grand oral svt: En quoi la rééducation permet elle d’améliorer les séquelles d’un AVC ?