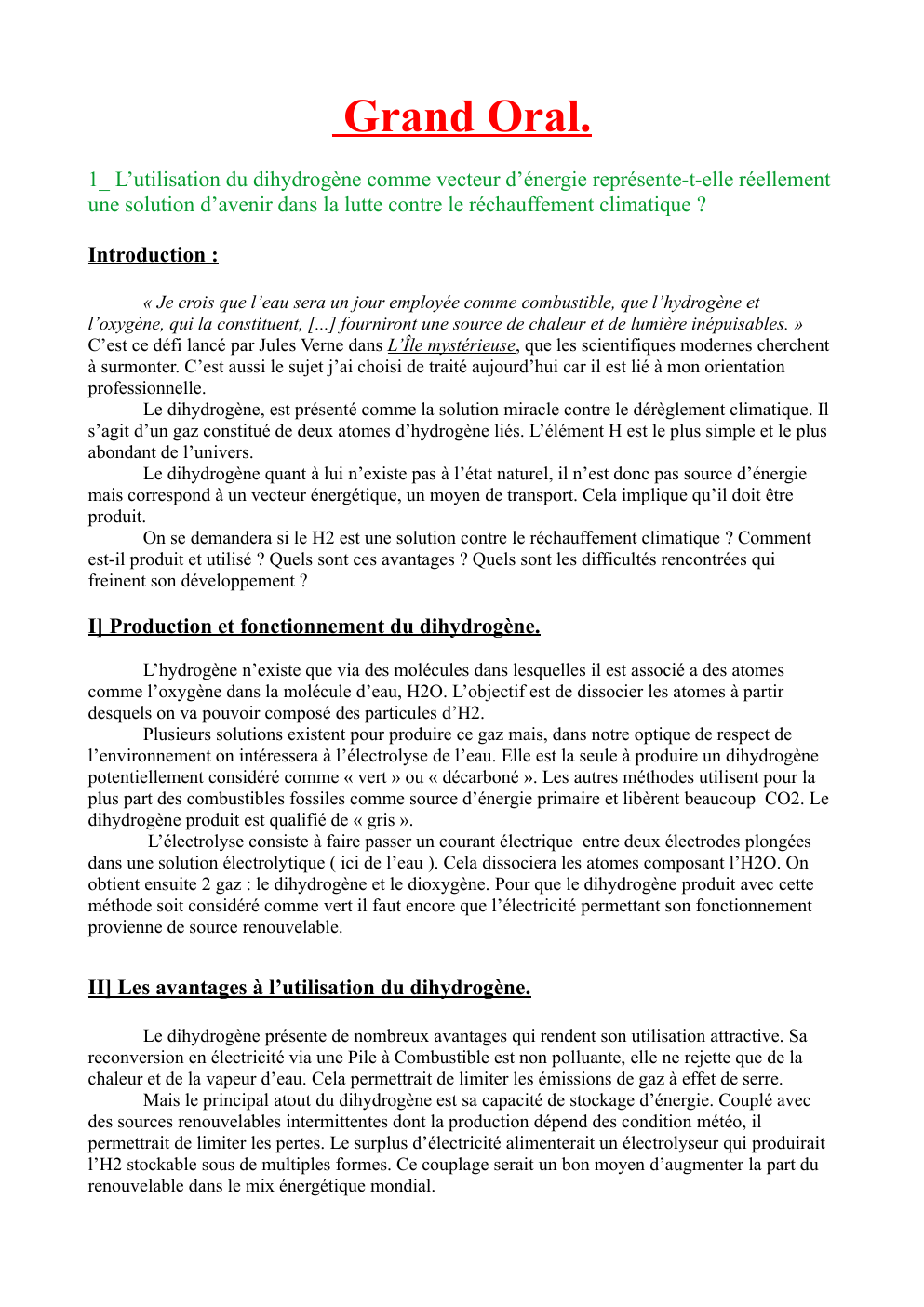Grand Oral: L’utilisation du dihydrogène comme vecteur d’énergie représente-t-elle réellement une solution d’avenir dans la lutte contre le réchauffement climatique ?
Publié le 04/05/2025
Extrait du document
«
Grand Oral.
1_ L’utilisation du dihydrogène comme vecteur d’énergie représente-t-elle réellement
une solution d’avenir dans la lutte contre le réchauffement climatique ?
Introduction :
« Je crois que l’eau sera un jour employée comme combustible, que l’hydrogène et
l’oxygène, qui la constituent, [...] fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisables.
»
C’est ce défi lancé par Jules Verne dans L’Île mystérieuse, que les scientifiques modernes cherchent
à surmonter.
C’est aussi le sujet j’ai choisi de traité aujourd’hui car il est lié à mon orientation
professionnelle.
Le dihydrogène, est présenté comme la solution miracle contre le dérèglement climatique.
Il
s’agit d’un gaz constitué de deux atomes d’hydrogène liés.
L’élément H est le plus simple et le plus
abondant de l’univers.
Le dihydrogène quant à lui n’existe pas à l’état naturel, il n’est donc pas source d’énergie
mais correspond à un vecteur énergétique, un moyen de transport.
Cela implique qu’il doit être
produit.
On se demandera si le H2 est une solution contre le réchauffement climatique ? Comment
est-il produit et utilisé ? Quels sont ces avantages ? Quels sont les difficultés rencontrées qui
freinent son développement ?
I] Production et fonctionnement du dihydrogène.
L’hydrogène n’existe que via des molécules dans lesquelles il est associé a des atomes
comme l’oxygène dans la molécule d’eau, H2O.
L’objectif est de dissocier les atomes à partir
desquels on va pouvoir composé des particules d’H2.
Plusieurs solutions existent pour produire ce gaz mais, dans notre optique de respect de
l’environnement on intéressera à l’électrolyse de l’eau.
Elle est la seule à produire un dihydrogène
potentiellement considéré comme « vert » ou « décarboné ».
Les autres méthodes utilisent pour la
plus part des combustibles fossiles comme source d’énergie primaire et libèrent beaucoup CO2.
Le
dihydrogène produit est qualifié de « gris ».
L’électrolyse consiste à faire passer un courant électrique entre deux électrodes plongées
dans une solution électrolytique ( ici de l’eau ).
Cela dissociera les atomes composant l’H2O.
On
obtient ensuite 2 gaz : le dihydrogène et le dioxygène.
Pour que le dihydrogène produit avec cette
méthode soit considéré comme vert il faut encore que l’électricité permettant son fonctionnement
provienne de source renouvelable.
II] Les avantages à l’utilisation du dihydrogène.
Le dihydrogène présente de nombreux avantages qui rendent son utilisation attractive.
Sa
reconversion en électricité via une Pile à Combustible est non polluante, elle ne rejette que de la
chaleur et de la vapeur d’eau.
Cela permettrait de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Mais le principal atout du dihydrogène est sa capacité de stockage d’énergie.
Couplé avec
des sources renouvelables intermittentes dont la production dépend des condition météo, il
permettrait de limiter les pertes.
Le surplus d’électricité alimenterait un électrolyseur qui produirait
l’H2 stockable sous de multiples formes.
Ce couplage serait un bon moyen d’augmenter la part du
renouvelable dans le mix énergétique mondial.
Un autre de ces atouts est sa densité énergétique.
La combustion d’1 kg de dihydrogène
libère 3 fois plus d’énergie qu’1 kg d’essence.
Cette caractéristique physique exploitée dans les
transports à grande échelle permettrait d’effectuer un bond dans la transition écologique.
Cela
augmenterait l’autonomie des véhicules tout en facilitant leurs recharge.
III] Freins au développement.
La question que l’on peut désormais se poser est : Pourquoi n’est-il pas déjà largement
utilisé dans le secteur de l’énergie?
La principale raison est financière.
Les coûts du dihydrogène vert ne sont pas encore assez
compétitifs pour espérer un déploiement à grande échelle.
De plus le rendements des dispositifs
liant électrolyse et PAC n’est pas satisfaisant.
Il n’est que de 30à 40 %.
Ce qui le rend d’autant
moins attractifs.
Un autre frein est la difficulté qu’on a à le stocker et le transporter.
Étant très peu dense,
pour une masse égale, l’hydrogène occupe un volume beaucoup grand que d’autres gaz.
De plus, ce
gaz est très fortement inflammable et explose au contact de l’air.
Le comprimé représente une
source de danger et nécessite des réservoirs hermétiques et sécurisés.
Le stocker dans des volumes
abordables pour toutes utilisations représente un défi technique pour les scientifiques modernes.
Il faudra également mettre en place un vaste réseau de transport et de distribution pour
faciliter son déploiement.
Le rendre accessible aux consommateurs sera un enjeux clef.
Conclusion
L’utilisation du dihydrogène est donc un vecteur important de la transition écologique et
représente un espoir pour l’avenir.
Mais sa production se fait principalement à partir d’énergies
fossiles.
Il faudrait donc se concentrer sur l’augmentation de la production de dihydrogène vert.
Par
ailleurs, le dihydrogène et la pile à combustible coûtent encore très chère.
Cela rend le massification
du dihydrogène compliquée, il reste peut accessible au grand public.
Si nous voulons un développement durable pour les générations futures, il devient nécessaire
de diversifier nos modes de production et de stockage d’énergie.
Il faudra s’intéresser de près aux
programmes comme ITER ou aux start-up qui mettent en place des systèmes de stockage d’énergie,
par exemple sous forme potentielle.
Ils auront, dans un futur proche, un impact fort sur nos modes
de consommation énergétique.
La biomasse est constituée de tous les végétaux (bois, paille, etc.) qui se renouvellent à la surface de la
Terre.
Elle constitue une source potentielle importante de dihydrogène : on obtient, par gazéification, un mélange
(CO + H2) que l’on purifie ensuite.
équivalente à celle provenant de la photosynthèse ; l’écobilan est donc nul.
On
cherche actuellement à faire produire du dihydrogène par des microalgues ou des bactéries qui utilisent la
lumière et des enzymes spécifiques : les hydrogénases.
Avec cette technique, 10 kg de CO2 sont émis pour 1 kg d’hydrogène produit Rien qu’en France, la production
d’hydrogène est responsable de l’émission de 9 Mt de CO2, soit environ 2 % des émissions nationales5 ! Les usages de
cet hydrogène ne sont pas moins émetteurs puisqu’il sert en priorité au raffinage pétrolier (60%), à la production
d’ammoniac et d’engrais (25%) et à la chimie (10%).
Jancovici
sous forme liquide à basse pression
– 253 °C sous 10 bars.
12 kg de H2 pour les petits réservoirs des voitures.
Le principal inconvénient de ce procédé est
l’impossibilité d’éviter les fuites : même très bien isolés, les réservoirs absorbent de la chaleur qui vaporise
lentement le liquide.
Stockage gazeux sous basse pression
Lorsqu’il n’est pas nécessaire de réduire le volume de stockage (comme dans une maison disposant d’un vaste sous-sol),
on peut envisager celui-ci sous forme gazeuse à une pression relativement basse (75 bars).
Dans ce cas, la réserve de
dihydrogène est régulièrement reconstituée par un dispositif de production in situ (électrolyse) alimenté par une source
d’énergie renouvelable.
Ce moyen de stockage est peu coûteux et parfaitement maîtrisé.
Stockage gazeux sous haute pression 700 bar
A ce niveau de compression, 4,6 litres de dihydrogène comprimé sont encore nécessaires pour produire autant d’énergie
qu’avec 1 litre d’essence.
Stockage sous forme d’hydrures à basse pression
affinité chimique pour de nombreux corps et peut soit s’adsorber sur un support organique ou composé de nanotubes de
carbone, soit former des composés chimiques nommés hydrures
le projet éolien-dihydrogène d’Utsira en Norvège ou le projet solaire-dihydrogène Myrte, en Corse (cf encadré
sur la Plate-forme Myrte).
Transport : 1kg permet de faire 100km l’H2 embarqué est transformé par PAC intégrée (autonomie de 600km)
camion, avion, train à hydrogène
électrolyseur qui fonctionne + de 4 000heures par ans : 2€kg d’H or pour H vert les nrj intermittentes ne
fonction pas autant d’heures ( environ1500 à 2000 )Produire de l’hydrogène uniquement à partir d’électricité issue
d’énergies renouvelables irait donc à l’encontre du bon sens économique et augmenterait le coût de l’hydrogène, ce qui
risquerait de compromettre son déploiement à grande échelle.
Il apparaît donc primordial d’inclure toutes les énergies
bas-carbone, dont le nucléaire, pour la production d’électricité qui servira à produire l’hydrogène.
La batterie
Elle se base sur une réaction chimique dite « réversible » puisqu’elle peut se faire dans un sens et
dans l’autre.
• Dans un sens, la réaction permet de convertir l’électricité en énergie chimique afin de la
stocker.
• Dans l’autre, elle permet de générer un courant électrique.
Afin d’augmenter les performances et diminuer l’impact sur l’environnement, de
nouvelles batteries (à eau salée, à liquides redox ou encore à sodium-soufre) sont en cours de
développement.
Les batteries Lithium-Ion sont actuellement les plus performantes.
Le condensateur
Un condensateur emmagasine de l’énergie électrique sur deux armatures métalliques séparées par
un semi-conducteur et la restitue au moment de la décharge.
Les condensateurs peuvent :
• se charger et se décharger très rapidement
• fournir des courants élevés (bien que limités dans le temps)
• recharger très rapidement un véhicule électrique.
1L pour 100g de H2
Comment newton a-t-il réussi à établir la loi de l’attraction gravitationnelle ?
La légende raconte qu’un jour, le physicien anglais Isaac Newton était assis....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Grand oral SES: La décroissance n’est pas une réponse au défi climatique
- GRAND ORAL: SVT En quoi la morphine est-elle dangereuse et quelles sont ses limites d’utilisation médicale?
- Grand oral NSI: les femmes, l'avenir de l'informatique?
- Grand Oral Nsi: Le web 3.0, l'avenir de l'informatique ?
- Grand oral utilisation de pigments dans l'art (physique chimie + art plastique)