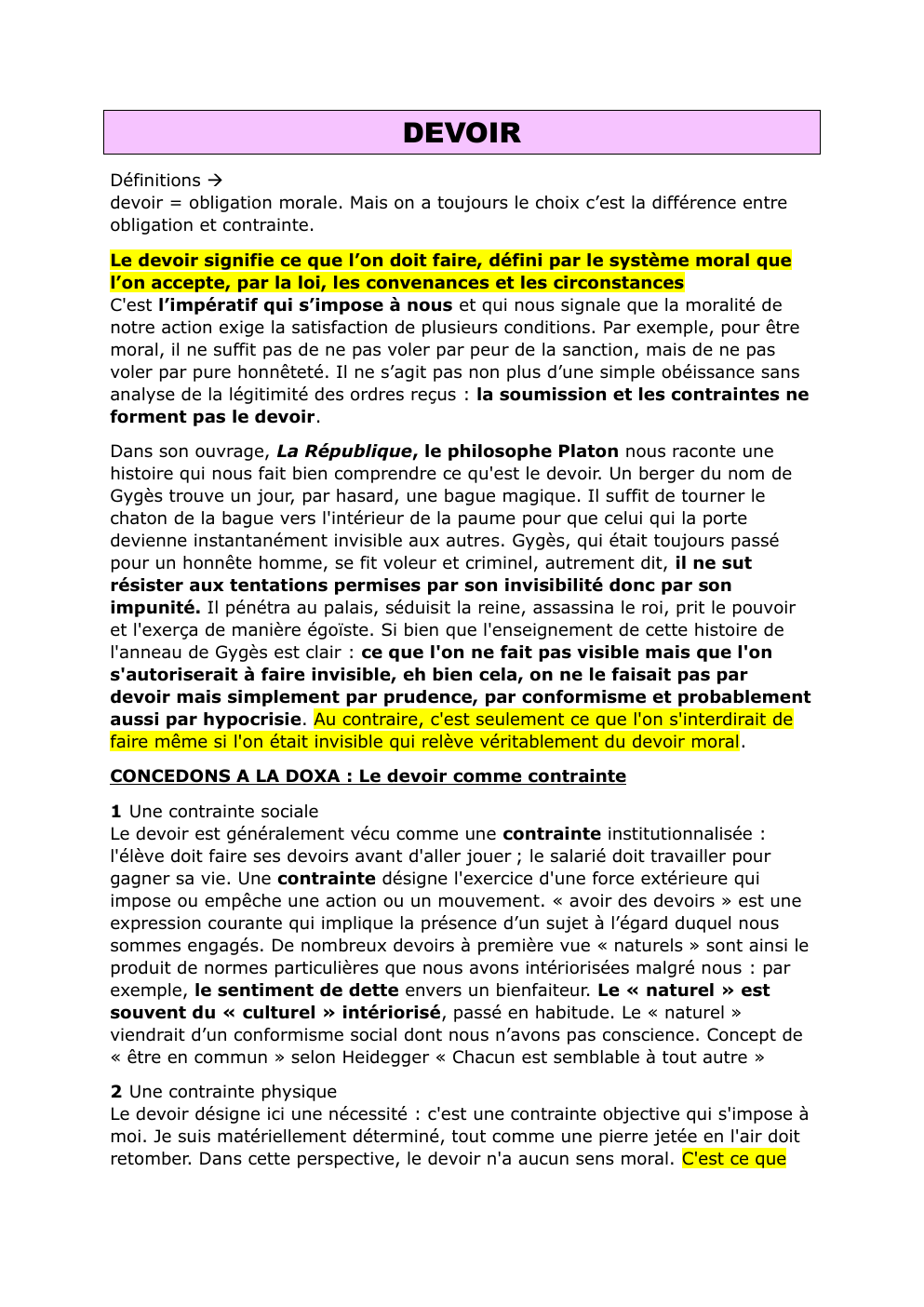fiche de révision philosophie devoir
Publié le 10/05/2025
Extrait du document
«
DEVOIR
Définitions
devoir = obligation morale.
Mais on a toujours le choix c’est la différence entre
obligation et contrainte.
Le devoir signifie ce que l’on doit faire, défini par le système moral que
l’on accepte, par la loi, les convenances et les circonstances
C'est l’impératif qui s’impose à nous et qui nous signale que la moralité de
notre action exige la satisfaction de plusieurs conditions.
Par exemple, pour être
moral, il ne suffit pas de ne pas voler par peur de la sanction, mais de ne pas
voler par pure honnêteté.
Il ne s’agit pas non plus d’une simple obéissance sans
analyse de la légitimité des ordres reçus : la soumission et les contraintes ne
forment pas le devoir.
Dans son ouvrage, La République, le philosophe Platon nous raconte une
histoire qui nous fait bien comprendre ce qu'est le devoir.
Un berger du nom de
Gygès trouve un jour, par hasard, une bague magique.
Il suffit de tourner le
chaton de la bague vers l'intérieur de la paume pour que celui qui la porte
devienne instantanément invisible aux autres.
Gygès, qui était toujours passé
pour un honnête homme, se fit voleur et criminel, autrement dit, il ne sut
résister aux tentations permises par son invisibilité donc par son
impunité.
Il pénétra au palais, séduisit la reine, assassina le roi, prit le pouvoir
et l'exerça de manière égoïste.
Si bien que l'enseignement de cette histoire de
l'anneau de Gygès est clair : ce que l'on ne fait pas visible mais que l'on
s'autoriserait à faire invisible, eh bien cela, on ne le faisait pas par
devoir mais simplement par prudence, par conformisme et probablement
aussi par hypocrisie.
Au contraire, c'est seulement ce que l'on s'interdirait de
faire même si l'on était invisible qui relève véritablement du devoir moral.
CONCEDONS A LA DOXA : Le devoir comme contrainte
1 Une contrainte sociale
Le devoir est généralement vécu comme une contrainte institutionnalisée :
l'élève doit faire ses devoirs avant d'aller jouer ; le salarié doit travailler pour
gagner sa vie.
Une contrainte désigne l'exercice d'une force extérieure qui
impose ou empêche une action ou un mouvement.
« avoir des devoirs » est une
expression courante qui implique la présence d’un sujet à l’égard duquel nous
sommes engagés.
De nombreux devoirs à première vue « naturels » sont ainsi le
produit de normes particulières que nous avons intériorisées malgré nous : par
exemple, le sentiment de dette envers un bienfaiteur.
Le « naturel » est
souvent du « culturel » intériorisé, passé en habitude.
Le « naturel »
viendrait d’un conformisme social dont nous n’avons pas conscience.
Concept de
« être en commun » selon Heidegger « Chacun est semblable à tout autre »
2 Une contrainte physique
Le devoir désigne ici une nécessité : c'est une contrainte objective qui s'impose à
moi.
Je suis matériellement déterminé, tout comme une pierre jetée en l'air doit
retomber.
Dans cette perspective, le devoir n'a aucun sens moral.
C'est ce que
Kant nomme l'hétéronomie, c'est-à-dire le fait d'obéir à une loi extérieure à sa
volonté.
Toute l’éducation est le devoir être par le devoir faire.
Le devoir garantie notre
humanité.
Se conformer au devoir est un laisser-aller, un abandon.
C’est aller à
l’encontre qui demande un effort de conscience
L'obéissance à une nécessité n'est pas un devoir, selon Rousseau dans le Contrat
social.
Liberté différent d’obéissance
liberté = implique que l’on agisse par soi même
obéissance = suppose qu’on se soumette à l’autre
donc absurdité de penser qu’on peut obéir librement
Rousseau dira pourtant « L’obéissance aux lois est liberté »
Philosphie de Kant :
que dois-je faire ? La réponse se trouve dans ce qu’il appelle la loi morale, une
loi commandée par la raison et non par la sensibilité, qui nous permet de
dominer nos penchants égoïstes.
« agis toujours de tel façon que la maxime qui dirige ton action puisse
être érigé en loi universelle » Impératifs catégoriques La morale kantienne
interroge particulièrement les fondements de l’action bonne en se demandant se
qu’il faut pour que l’action soit réellement bonne.
Agir moralement, c’est prendre des décisions qui paraissent universalisables.
Cet
impératif est catégorique : il est sans condition, c'est-à-dire inconditionné, et
aucune excuse ne doit m'empêcher d'y obéir.
C’est pourquoi mentir pour Kant
sera toujours immoral, il n’y a pas d’exceptions même quand l’intention est juste
parce que sinon ça signifierait qu’on admet le mensonge comme loi universelle.
Nietzche
Hegel
Bergson
Philosophie de Sartre :
Le devoir ne peut être justifié par une autorité extérieure, il est une
responsabilité personnelle.
Sartre indique que le devoir ne peut pas toujours être une
détermination certaine, car la règle d’universalité de la maxime de nos
actions est parfois en défaut.
Ex : La période de l’occupation allemande de
la France a été l’occasion de tels conflits.
Le devoir était-il de prendre soin
de sa famille ou de s’engager pour la patrie ? Le conflit moral montre que
le devoir est défini par l’individu lui-même qui choisit librement sa
vie et conséquemment son devoir.
Tout au plus peut-on souhaiter....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche de révision Les cahiers de Douai
- fiche révision bac philo art
- Fiche de révision philo : la liberté
- Fiche de révision - Les régimes totalitaires
- fiche méthode philosophie