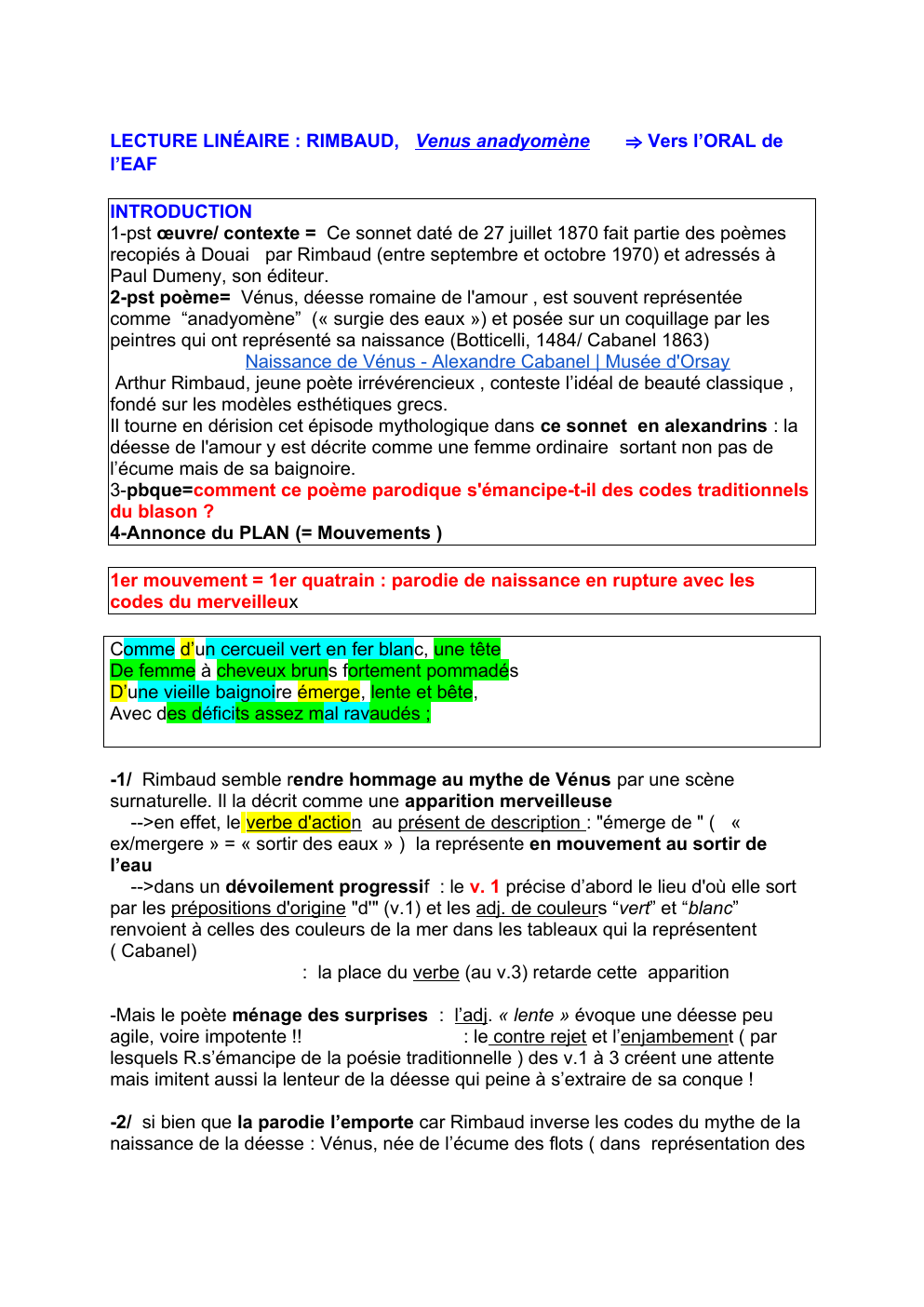Explication linéaire Vénus Anadyomène
Publié le 11/05/2025
Extrait du document
«
LECTURE LINÉAIRE : RIMBAUD, Venus anadyomène
l’EAF
⇒ Vers l’ORAL de
INTRODUCTION
1-pst œuvre/ contexte = Ce sonnet daté de 27 juillet 1870 fait partie des poèmes
recopiés à Douai par Rimbaud (entre septembre et octobre 1970) et adressés à
Paul Dumeny, son éditeur.
2-pst poème= Vénus, déesse romaine de l'amour , est souvent représentée
comme “anadyomène” (« surgie des eaux ») et posée sur un coquillage par les
peintres qui ont représenté sa naissance (Botticelli, 1484/ Cabanel 1863)
Naissance de Vénus - Alexandre Cabanel | Musée d'Orsay
Arthur Rimbaud, jeune poète irrévérencieux , conteste l’idéal de beauté classique ,
fondé sur les modèles esthétiques grecs.
Il tourne en dérision cet épisode mythologique dans ce sonnet en alexandrins : la
déesse de l'amour y est décrite comme une femme ordinaire sortant non pas de
l’écume mais de sa baignoire.
3-pbque=comment ce poème parodique s'émancipe-t-il des codes traditionnels
du blason ?
4-Annonce du PLAN (= Mouvements )
1er mouvement = 1er quatrain : parodie de naissance en rupture avec les
codes du merveilleux
Comme d’un cercueil vert en fer blanc, une tête
De femme à cheveux bruns fortement pommadés
D’une vieille baignoire émerge, lente et bête,
Avec des déficits assez mal ravaudés ;
-1/ Rimbaud semble rendre hommage au mythe de Vénus par une scène
surnaturelle.
Il la décrit comme une apparition merveilleuse
-->en effet, le verbe d'action au présent de description : "émerge de " ( «
ex/mergere » = « sortir des eaux » ) la représente en mouvement au sortir de
l’eau
-->dans un dévoilement progressif : le v.
1 précise d’abord le lieu d'où elle sort
par les prépositions d'origine "d'" (v.1) et les adj.
de couleurs “vert” et “blanc”
renvoient à celles des couleurs de la mer dans les tableaux qui la représentent
( Cabanel)
: la place du verbe (au v.3) retarde cette apparition
-Mais le poète ménage des surprises : l’adj.
« lente » évoque une déesse peu
agile, voire impotente !!
: le contre rejet et l’enjambement ( par
lesquels R.s’émancipe de la poésie traditionnelle ) des v.1 à 3 créent une attente
mais imitent aussi la lenteur de la déesse qui peine à s’extraire de sa conque !
-2/ si bien que la parodie l’emporte car Rimbaud inverse les codes du mythe de la
naissance de la déesse : Vénus, née de l’écume des flots ( dans représentation des
artistes ),perd sa divinité et sa grandeur en s'extrayant d’une " baignoire" dans sa
salle de bain !
a/ -elle surgit d'une baignoire, objet -->ordinaire 🡪au métal ordinaire/non précieux
: “ baignoire” en « fer blanc » (=/coquillage tapissé de nacre )
-->usagé : adj.
”vieille baignoire » ; l'hypallage "ravaudés"
(v.4) décrit Vénus mais aussi la baignoire fissurée ; la comparaison “ comme d’un
cercueil vert en fer blanc” renvoie à un objet morbide .
L’adjectif « vert » connote la
moisissure .
b/ Rimbaud brosse le contre blason non pas d'une déesse mais d’un femme
ordinaire par
son humanité :
→ v.1 : sa « tête », élément anatomique (sans jugement esthétique).
-🡪v.2 : « de femme » : complément du nom mis en valeur par le contre rejet
ménage une surprise : celui d'une mortelle ordinaire !
sa vieillesse d’après —->elle ressemble à un fantôme surgie de la baignoire
qui est comparée à « un cercueil » .
--> 🡪l’hypallage, « vieille baignoire »(= transfert de sens :
l'adjectif qualifie la baignoire mais aussi la femme ) raille la femme bien
davantage que la baignoire
--> ses défauts “déficits” (défauts causés par l’usure” ) qu’elle
cache par des artifices dont on relève le lexique : “assez mal ravaudés” (:
hypallage renvoyant aux rides à masquer mais aussi aux fissures de la baignoire” )
rimant avec “fortement pommadés” ( “pommade” pour colorer ses cheveux/
connotations de maquillage )
--> ses efforts pour camoufler sa vieillesse sont soulignés par les
adverbes hyperboliques (v2) (v.4) ( l'adverbe “fortement” insiste sur la nécessité de
maquiller ses cheveux blancs ).
Vénus est davantage une comédienne de théâtre
que la déesse de la beauté; l’excès de maquillage la rabaisse à une prostituée
aguicheuse…
son apparence : “cheveux bruns” loin du cliché de la blondeur.
sa stupidité d’après l’adjectif animalisant “bête” (qui rime avec”tête”!) ,
l’éloigne des stéréotypes liés à Vénus (représentée avec une expression de
douceur ) (le beau symbolise le Bien et la perfection divine -selon Platon )
⇒Rimbaud s'émancipe d'une tradition en transformant le visage de la déesse
de la beauté, en celui d’ une vieille femme/prostituée abîmée par la vie ; il la
raille en la décrivant comme un spectre fantastique s'extrayant d'un
tombeau.
2ème mouvement = 2ème quatrain = contre blason du corps accompagné d’
un gros plan sur le dos.
Puis le col gras et gris, les larges omoplates
Qui saillent ; le dos court qui rentre et qui ressort ;
Puis les rondeurs des reins semblent prendre l’essor ;
La graisse sous la peau paraît en feuilles plates ;
–après le portrait de la tête , la description du corps s'effectue de haut en bas :
les connecteurs “puis” et la juxtaposition de propositions dévoilent les parties du
corps triviales qui émergent progressivement : “col”, “omoplates”, “dos” “reins”,
“peau” .
Ce lexique relève plus de l’anatomie animale que de l’idéal de beauté des blasons
poétiques ..(cf / Ronsard, Marie , vous avez ….)
https://www.bonjourpoesie.fr/lesgrandsclassiques/poemes/
pierre_de_ronsard/marie_vous_avez_la_joue_aussi_vermeille
–effectivement, ce corps est caractérisé par sa laideur en rupture avec l’image
idéalisée de Vénus.
Rimbaud insiste sur
→ L’embonpoint : les adj “gras”, “larges”, “les rondeurs” au pluriel / v.8.
: “la paronomase” “gras et gris” accentue le rejet du poète ( la couleur
sale de la peau contraste avec la blancheur des statues taillées dans le marbre de
Paros !)
: le rejet du v.5-6 “larges omoplates /qui saille” évoque un
embonpoint qui déborde du vers et un aspect disgracieux (serait-elle bossue?).
: “ressort” rime avec “essor” pour décrire des formes généreuses (le v.
7
est un euphémisme)…
→l'apparence virile par Les dimensions “larges”
→une femme difforme par → les adjectifs / les subordonnées relatives
antithétiques : omoplates “large”, dos ”court” ; “omoplates qui saillent” (le rejet
évoque un corps disgracieux ) , “dos court qui rentre et qui ressort” décrivent un
physique difforme qui barbote dans l’eau , sans parvenir à s'extraire, par les verbes
d’action.
→les allitérations en ( k ) (g) laissent entendre la voix
satirique et moqueuse du poète envers les défauts physiques
⇒le contre blason de Vénus est en antithèse avec les critères de perfection
classique.
Même ses mouvements manquent de grâce : allitérations en ( r ) et verbes d’action
au présent de description soulignent des mouvement pesants tandis qu'elle s'extrait
de sa baignoire ( “rentre”, “ressort”, “prendre l’essor”, “paraît” )
3ème mouvement = 1er tercet = suite du contre blason : description
repoussante de l’ ensemble du corps
L’échine est un peu rouge, et le tout sent un goût
Horrible étrangement ; on remarque surtout
Des singularités qu’il faut voir à la loupe…
v.
9 : étape supplémentaire du contre-blason par la déshumanisation de la
femme : le mot “échine” l’animalise et le pronom indéfini ‘le tout” la réifie ( =lui ôte
son humanité)
-Rimbaud poursuit un portrait déjà fondé sur les sensations visuelles par :
→ les couleurs : le “rouge” de la peau connotant le sang/ maladie ( en
antithèse à la blancheur classique)
→ le mélange de sensations olfactives et gustatives inspirées de Baudelaire et
appelées “synesthésies” aboutit à un portrait bizarre et repoussant : “le tout sent un
goût horrible étrangement”
→ l’hyperbole en tête du v.
10 et en rejet renforcent un portrait qui dégoûte les
sens.
(loin de dégager des odeurs agréables au sortir du bain, Vénus dégage une
odeur nauséabonde)
-v.10/ v11 = le verbe de vue “on....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- lecture linéaire vénus anadyomène
- analyse linéaire de Vénus anadyomène
- Vénus Anadyomène
- Analyse linéaire Venus Anadyomène
- Explication linéaire Ma bohême Rimbaud