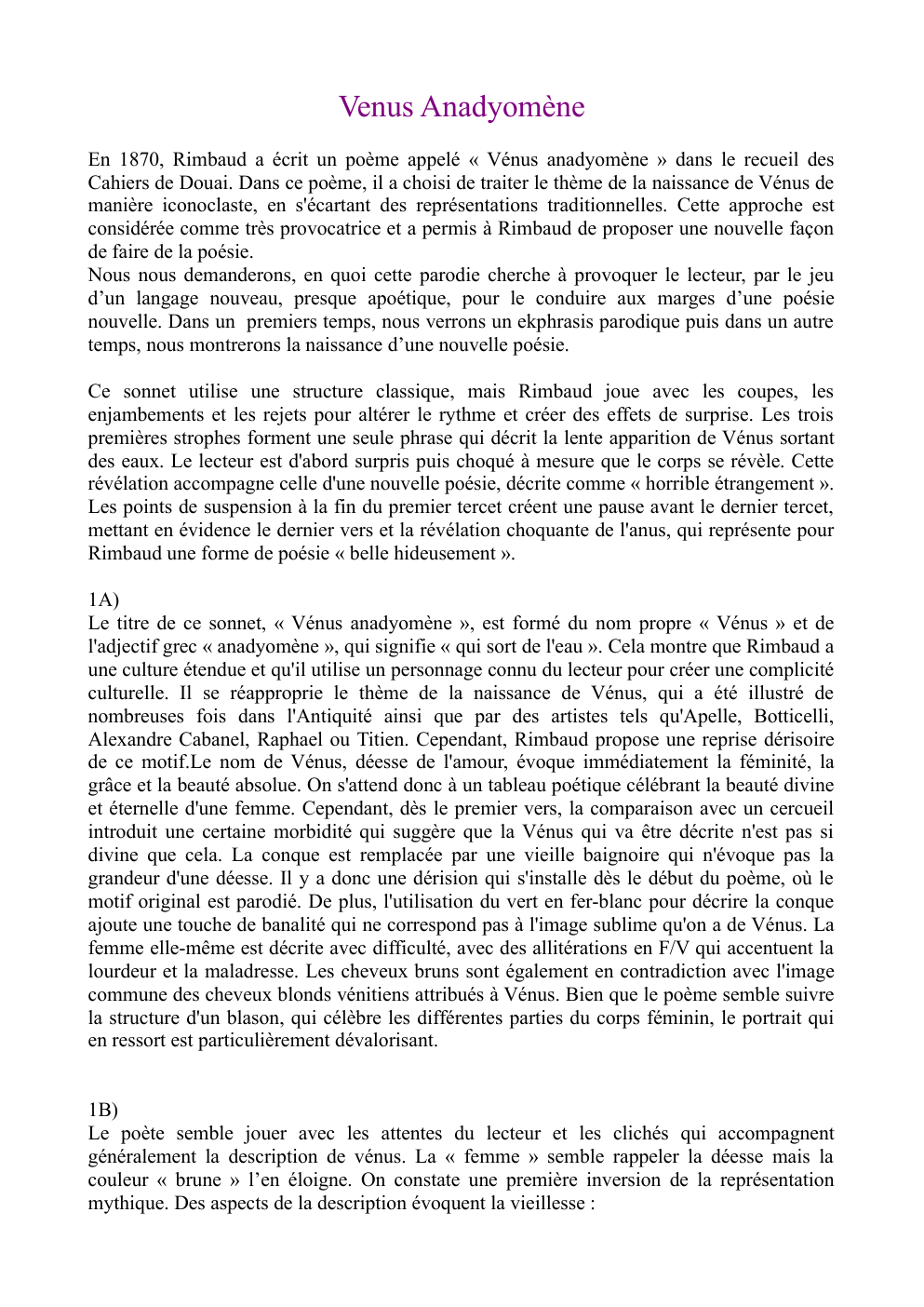Analyse linéaire Venus Anadyomène
Publié le 01/03/2024
Extrait du document
«
Venus Anadyomène
En 1870, Rimbaud a écrit un poème appelé « Vénus anadyomène » dans le recueil des
Cahiers de Douai.
Dans ce poème, il a choisi de traiter le thème de la naissance de Vénus de
manière iconoclaste, en s'écartant des représentations traditionnelles.
Cette approche est
considérée comme très provocatrice et a permis à Rimbaud de proposer une nouvelle façon
de faire de la poésie.
Nous nous demanderons, en quoi cette parodie cherche à provoquer le lecteur, par le jeu
d’un langage nouveau, presque apoétique, pour le conduire aux marges d’une poésie
nouvelle.
Dans un premiers temps, nous verrons un ekphrasis parodique puis dans un autre
temps, nous montrerons la naissance d’une nouvelle poésie.
Ce sonnet utilise une structure classique, mais Rimbaud joue avec les coupes, les
enjambements et les rejets pour altérer le rythme et créer des effets de surprise.
Les trois
premières strophes forment une seule phrase qui décrit la lente apparition de Vénus sortant
des eaux.
Le lecteur est d'abord surpris puis choqué à mesure que le corps se révèle.
Cette
révélation accompagne celle d'une nouvelle poésie, décrite comme « horrible étrangement ».
Les points de suspension à la fin du premier tercet créent une pause avant le dernier tercet,
mettant en évidence le dernier vers et la révélation choquante de l'anus, qui représente pour
Rimbaud une forme de poésie « belle hideusement ».
1A)
Le titre de ce sonnet, « Vénus anadyomène », est formé du nom propre « Vénus » et de
l'adjectif grec « anadyomène », qui signifie « qui sort de l'eau ».
Cela montre que Rimbaud a
une culture étendue et qu'il utilise un personnage connu du lecteur pour créer une complicité
culturelle.
Il se réapproprie le thème de la naissance de Vénus, qui a été illustré de
nombreuses fois dans l'Antiquité ainsi que par des artistes tels qu'Apelle, Botticelli,
Alexandre Cabanel, Raphael ou Titien.
Cependant, Rimbaud propose une reprise dérisoire
de ce motif.Le nom de Vénus, déesse de l'amour, évoque immédiatement la féminité, la
grâce et la beauté absolue.
On s'attend donc à un tableau poétique célébrant la beauté divine
et éternelle d'une femme.
Cependant, dès le premier vers, la comparaison avec un cercueil
introduit une certaine morbidité qui suggère que la Vénus qui va être décrite n'est pas si
divine que cela.
La conque est remplacée par une vieille baignoire qui n'évoque pas la
grandeur d'une déesse.
Il y a donc une dérision qui s'installe dès le début du poème, où le
motif original est parodié.
De plus, l'utilisation du vert en fer-blanc pour décrire la conque
ajoute une touche de banalité qui ne correspond pas à l'image sublime qu'on a de Vénus.
La
femme elle-même est décrite avec difficulté, avec des allitérations en F/V qui accentuent la
lourdeur et la maladresse.
Les cheveux bruns sont également en contradiction avec l'image
commune des cheveux blonds vénitiens attribués à Vénus.
Bien que le poème semble suivre
la structure d'un blason, qui célèbre les différentes parties du corps féminin, le portrait qui
en ressort est particulièrement dévalorisant.
1B)
Le poète semble jouer avec les attentes du lecteur et les clichés qui accompagnent
généralement la description de vénus.
La « femme » semble rappeler la déesse mais la
couleur « brune » l’en éloigne.
On constate une première inversion de la représentation
mythique.
Des aspects de la description évoquent la vieillesse :
- «vieille baignoire » « cercueil ».
- Le participe « ravaudés » au vers 4
- la rencontre à la rime de « tête » et « bête » qui désacralise le personnage.
- Jeu sur le double sens du mot « bête » : peut désigner un geste maladroit, une femme sotte
mais le terme peut aussi donner une dimension animale à la femme.
- le terme « déficits » : désigne des défauts, des imperfections physiques ; « ravaudés »,
renchéri par le groupe adverbial « assez mal » ruinent toute vision élogieuse et font de cette
Vénus une prostituée vieillissante et décatie dont le maquillage ne suffit plus à gommer la
laideur.
Le verbe « ravauder » désigne aussi le raccommodage des vêtements usés.
- L’expression « fortement pommadés » v 2 suggère des soins de beauté maladroits,
incapables de lutter contre la laideur due à l’âge.
De plus ce terme oppose le fard et l’artifice
à la beauté naturelle, attribut de la déesse.
- La « rondeur des seins », symbole de féminité est immédiatement mise en doute ou
atténuée par le verbe modalisateur « sembler » ce que la comparaison avec « les feuilles
plates » vient confirmer.
- La rime « omoplates »/ « plates » ruine toute dimension callipyge de la femme.
- Les adjectifs « gras et gris » dont l’allitération en [Gr] souligne le caractère dépréciatif
évoquent la dimension disgracieuse de la femme.
- Animalisation, notamment avec le terme « échine », puis « croupe » v 13
- Importance également de l’isotopie de la maladie avec le terme « rouge »
- Le motif du tatouage renvoie à l’époque au monde de la prostitution.
Cette intrusion du laid est signe d'une poésie nouvelle, moderne
2A)
Le prosaïsme de certains termes, notamment « baignoire » qui remplace les flots
mythologiques, invite le lecteur à s’interroger sur la nature poétique de ce texte.
Bien des
éléments surprennent, sont dissonants mais aussi provocateurs.
La laideur paraît l’emporter
sur le moindre indice de beauté.
Le verbe « émerge » ôte tout caractère exceptionnel à
l’apparition de cette femme ; le geste semble banal et pénible Suivant un regard descendant,
Rimbaud se livre à un portrait cru de cette femme vue de dos.
Il insiste sur une description
quasi clinique de ce corps qui ne peut que susciter la répulsion.
Le laid domine le 1er tercet :
tous les sens y semblent convoqués pour dire la monstruosité et la répulsion : vue, goût et
odorat se conjuguent :....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- analyse linéaire de Vénus anadyomène
- Analyse linéaire Théodote, La Bruyère
- Préparation à l’oral du baccalauréat de français Analyse linéaire n°4 - Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, 1990 (épilogue)
- Objet d'étude : La poésie du XIX et du XX siècle. Parcours complémentaire : Alchimie poétique : réinventer le monde. Analyse linéaire 2/2 « Le Pain », Francis Ponge, Le Parti pris des choses, 1942
- venus d'anadyomène Rimbaud