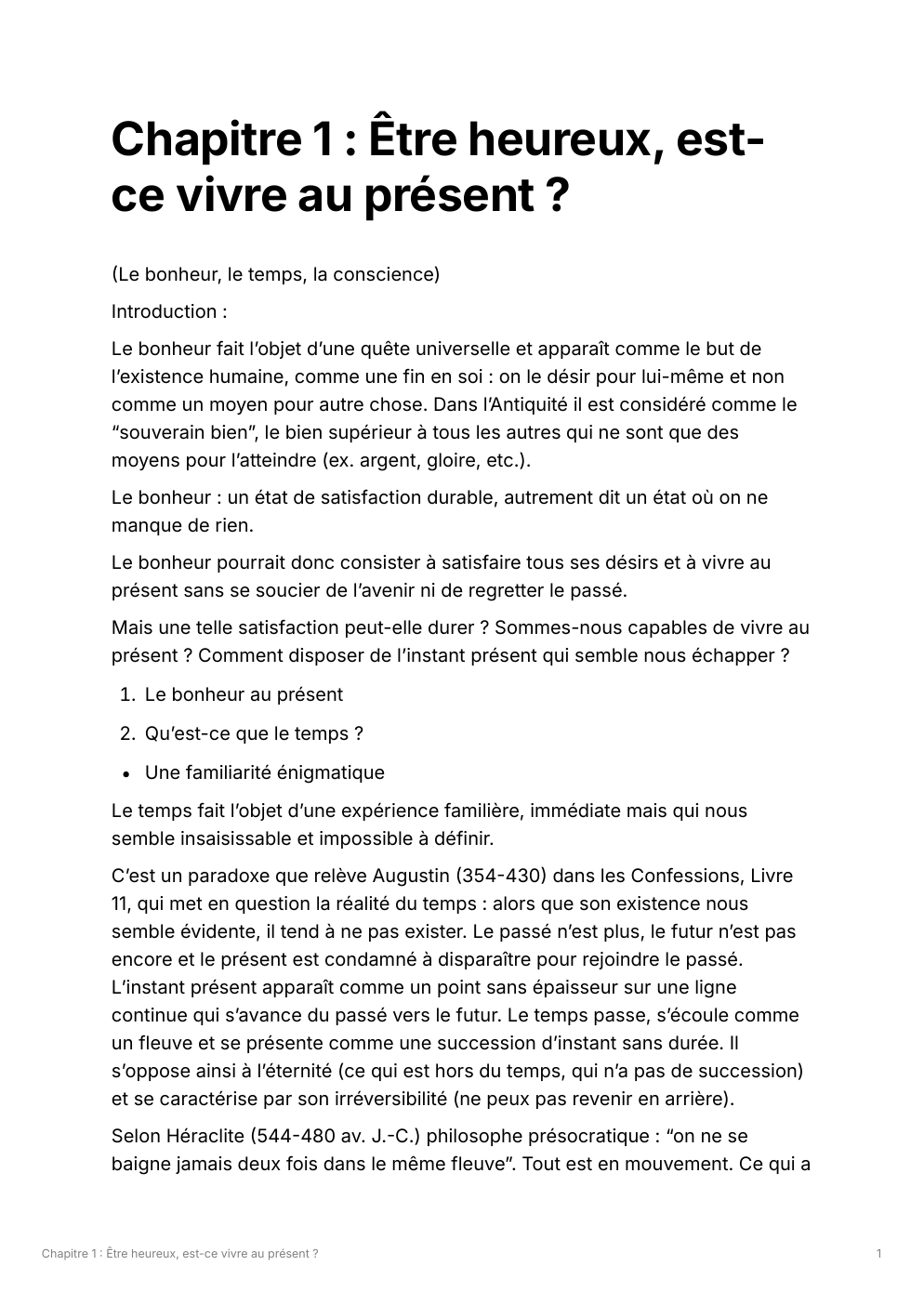Être heureux, est-ce vivre au présent ?
Publié le 19/04/2025
Extrait du document
«
Chapitre 1 : Être heureux, estce vivre au présent ?
(Le bonheur, le temps, la conscience)
Introduction :
Le bonheur fait l’objet d’une quête universelle et apparaît comme le but de
l’existence humaine, comme une fin en soi : on le désir pour lui-même et non
comme un moyen pour autre chose.
Dans l’Antiquité il est considéré comme le
“souverain bien”, le bien supérieur à tous les autres qui ne sont que des
moyens pour l’atteindre (ex.
argent, gloire, etc.).
Le bonheur : un état de satisfaction durable, autrement dit un état où on ne
manque de rien.
Le bonheur pourrait donc consister à satisfaire tous ses désirs et à vivre au
présent sans se soucier de l’avenir ni de regretter le passé.
Mais une telle satisfaction peut-elle durer ? Sommes-nous capables de vivre au
présent ? Comment disposer de l’instant présent qui semble nous échapper ?
1.
Le bonheur au présent
2.
Qu’est-ce que le temps ?
Une familiarité énigmatique
Le temps fait l’objet d’une expérience familière, immédiate mais qui nous
semble insaisissable et impossible à définir.
C’est un paradoxe que relève Augustin (354-430) dans les Confessions, Livre
11, qui met en question la réalité du temps : alors que son existence nous
semble évidente, il tend à ne pas exister.
Le passé n’est plus, le futur n’est pas
encore et le présent est condamné à disparaître pour rejoindre le passé.
L’instant présent apparaît comme un point sans épaisseur sur une ligne
continue qui s’avance du passé vers le futur.
Le temps passe, s’écoule comme
un fleuve et se présente comme une succession d’instant sans durée.
Il
s’oppose ainsi à l’éternité (ce qui est hors du temps, qui n’a pas de succession)
et se caractérise par son irréversibilité (ne peux pas revenir en arrière).
Selon Héraclite (544-480 av.
J.-C.) philosophe présocratique : “on ne se
baigne jamais deux fois dans le même fleuve”.
Tout est en mouvement.
Ce qui a
Chapitre 1 : Être heureux, est-ce vivre au présent ?
1
été n’est plus et ne reviendra pas.
Passé, présent, futur : un triple présent
Passé, présent et futur existent dans notre esprit.
C’est notre conscience qui
fait exister le passé par le souvenir, la mémoire, le futur par l’attente et le
présent par l’attention.
Il n’y a donc pas trois temps mais un triple présent : “le
présent du passé, le présent du présent et le présent du futur” qui renvoient à
l’activité de la conscience.
Selon Augustin, le temps est ainsi “distension de l’esprit”.
Temps scientifique et temps vécu
Il existe 2 conceptions du temps :
→ La manière objective.
Le temps comme l’espace est envisagé comme un
milieu dans lequel se passe une réalité objective qui peut être évaluée de
manière quantitative selon plusieurs unités de mesure.
Le temps est comme
une grandeur physique qui rentre dans la formulation de nombreuses lois
physiques (le facteur T).
Bergson (1859-1941) montre dans Essai sur les données immédiates de la
conscience (1889) que ce temps mesurable est spécialisé.
On croit mesurer le
temps mais on mesure l’espace (ex.
déplacement des aiguilles, écoulement du
sable dans le sablier.
→ Le temps vécu par une conscience individuelle subjective qui passe plus ou
moins vite est ce que Bergson nomme “durée”.
La durée est caractérisée par sa
continuité et son indivisibilité.
Elle n’est pas mesurable ni qualifiable et on peut
la fractionner en instant superposée.
TEXTE AUGUSTIN
1.
Conscience et temporalité
La conscience apparaît comme la manière humaine d’exister qui fait de l’être
humain un sujet, un être doué d’une subjectivité (une intériorité → pensées,
sentiments, désirs…), un être conscient de lui-même, capable de dire “je” (=le
soi).
Le mot “conscience” est composé de “science” (savoir) et “cum” (avec),
c’est une forme de savoir qui accompagne la vie les actes du sujet.
→ La conscience est un état (”être conscient”).
C’est ce qui disparaît quand on
s’évanouit.
La conscience revoit ici à l’expérience que nous faisons de la
présence des choses (perception) et de soi-même.
Chapitre 1 : Être heureux, est-ce vivre au présent ?
2
→ La conscience désigne aussi un acte de pensée (”prendre conscience”).
Le
sujet est capable de faire retour vers ses pensées, ses actes pour les analyser,
les juger (ex.
prendre conscience d’avoir bien/mal agis, conscience morale =
juge intérieur du bien et du mal).
Il accède ainsi à une connaissance de soi, une
introspection.
La conscience peut donc se définir comme un pouvoir de représentation qui
instaure une distance entre le sujet et les objets ou le sujet et les pensées.
→ Conscience du temps ? La conscience semble être à la fois notre dignité de
personne (grandeur), de sujet mais aussi un fardeau (faiblesse) ou un obstacle
au bonheur.
Nous avons conscience de l’écoulement du temps, de son
irréversibilité comme un temps destructeur, ce qui illustre la figure du Dieu Grec
Kronos (saturne chez les Romains) qui personnifie le temps et dévore ses
enfants au fur et à mesure qu’ils naissent.
1.
Vivre l’instant présent : l’hédonisme radical du Calliclès
Seul le présent existe.
Le bonheur pourrait alors consister à jouir de l’instant
présent.
Cela revient à assimiler le bonheur au plaisir et à considérer qu’il faut
satisfaire tous ses désirs pour être heureux.
Cette position qui fait du plaisir le
“souverain bien” se nomme l’hédonisme du grec Hedonê (plaisir en grec) et est
défendu par Calliclès, sophiste imaginaire, adversaire de Socrate dans le
Gorgias (dialogue de Platon).
Selon Calliclès, il faut laisser libre cours à ses
passions, ne pas modérer (se raisonner) et assouvir ses désirs au fur et à
mesure qu’ils apparaissent pour atteindre le bonheur.
Ce bonheur est réservé à
un petit nombre d’individus gâtés, favorisés par la nature.
C’est le bonheur du
tyran qui dispose d’une toute puissance lui permettant d’imposer ses désirs à
ceux qu’il domine.
Le bonheur est une liberté absolue (au sens d’absence de
contraintes).
Cependant, il faut distinguer le bonheur (état de satisfaction durable) et le
plaisir (sensation qui reste une satisfaction éphémère).
Socrate condamne le
mode de vie de Calliclès en le comparant au fait de vouloir remplir nuit et jour
des tonneaux percés (allusion aux tonneaux des Danaïdes).
La vie de
l’hédoniste où les plaisirs se succèdent sans cesse est traversée par un
manque impossible à combler et est marquée par l’insatisfaction.
De plus, sa
liberté est illusoire car il est esclave de ses délires, de ses passions qu’il ne
contrôle pas.
Socrate lui oppose le bonheur du sage vivant une vie réglée par la
raison, comparé à un homme prévoyant dont les tonneaux sont bien remplis de
denrées précieuses.
Pour Calliclès, le bonheur ne consiste....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Du « souvenir immortel » d'un baiser au présent de l'écriture marqué par la douleur (« je ne puis plus vivre dans l'état où je suis »): la plainte d'un être divisé - Julie ou La Nouvelle Héloïse. Commentaire
- °703 Philosophie : Faut-il s’efforcer de vivre au présent ?
- GorgiasPlatonFragment 494 a-cSocrate : (...) Ces deux manières de vivre sont exactement celles de l'intempérant et del'homme sage : lequel des deux te paraît le plus heureux ?
- « NOUS NE VIVONS JAMAIS, MAIS NOUS ESPÉRONS DE VIVRE; ET( NOUS DISPOSANT TOUJOURS A ÊTRE HEUREUX, IL EST INÉVITABLE QUE NOUS NE LE SOYONS JAMAIS. »
- Peut-on vivre heureux dans la solitude ?