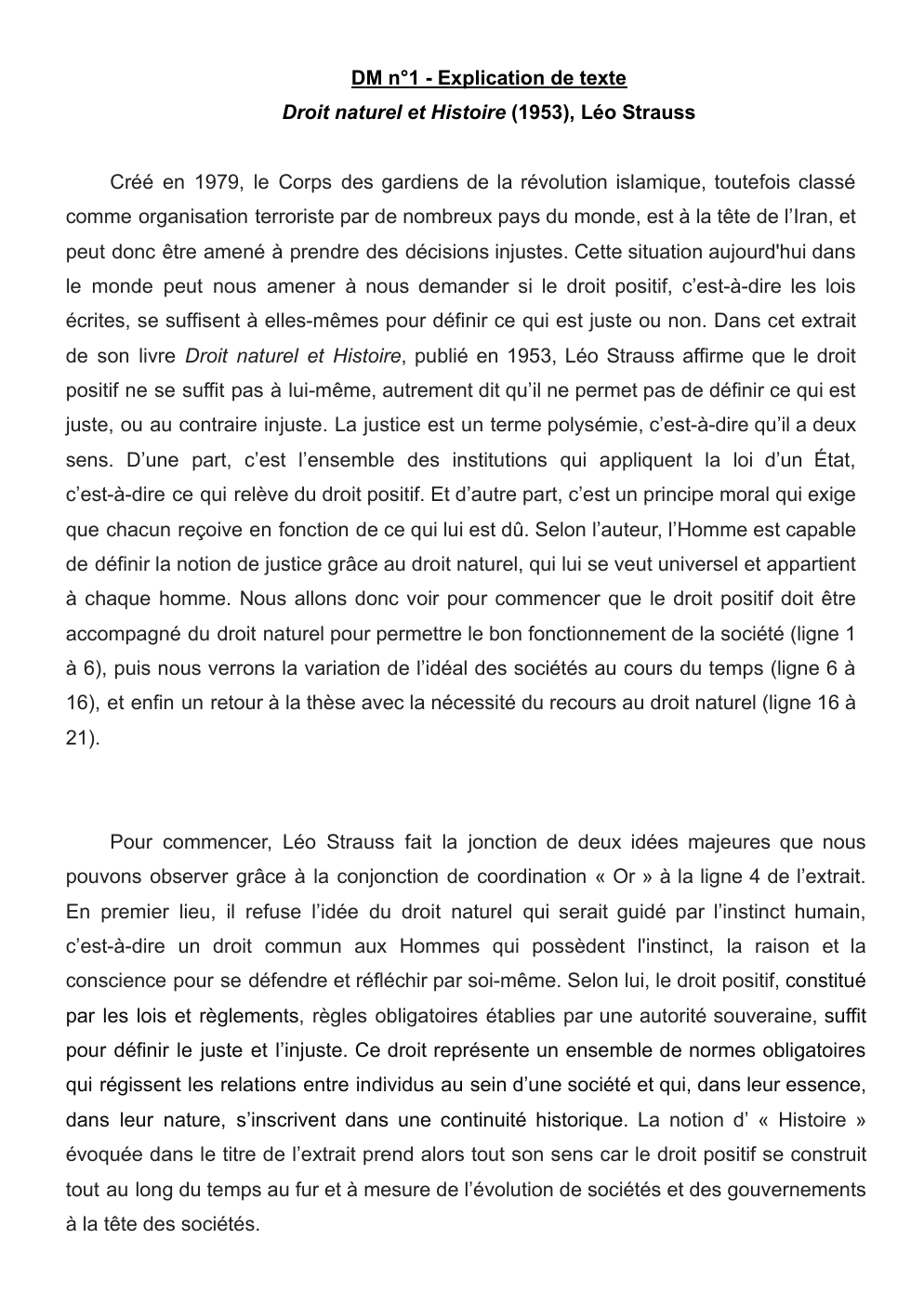DM n°1 - Explication de texte Droit naturel et Histoire (1953), Léo Strauss
Publié le 13/03/2025
Extrait du document
«
DM n°1 - Explication de texte
Droit naturel et Histoire (1953), Léo Strauss
Créé en 1979, le Corps des gardiens de la révolution islamique, toutefois classé
comme organisation terroriste par de nombreux pays du monde, est à la tête de l’Iran, et
peut donc être amené à prendre des décisions injustes.
Cette situation aujourd'hui dans
le monde peut nous amener à nous demander si le droit positif, c’est-à-dire les lois
écrites, se suffisent à elles-mêmes pour définir ce qui est juste ou non.
Dans cet extrait
de son livre Droit naturel et Histoire, publié en 1953, Léo Strauss affirme que le droit
positif ne se suffit pas à lui-même, autrement dit qu’il ne permet pas de définir ce qui est
juste, ou au contraire injuste.
La justice est un terme polysémie, c’est-à-dire qu’il a deux
sens.
D’une part, c’est l’ensemble des institutions qui appliquent la loi d’un État,
c’est-à-dire ce qui relève du droit positif.
Et d’autre part, c’est un principe moral qui exige
que chacun reçoive en fonction de ce qui lui est dû.
Selon l’auteur, l’Homme est capable
de définir la notion de justice grâce au droit naturel, qui lui se veut universel et appartient
à chaque homme.
Nous allons donc voir pour commencer que le droit positif doit être
accompagné du droit naturel pour permettre le bon fonctionnement de la société (ligne 1
à 6), puis nous verrons la variation de l’idéal des sociétés au cours du temps (ligne 6 à
16), et enfin un retour à la thèse avec la nécessité du recours au droit naturel (ligne 16 à
21).
Pour commencer, Léo Strauss fait la jonction de deux idées majeures que nous
pouvons observer grâce à la conjonction de coordination « Or » à la ligne 4 de l’extrait.
En premier lieu, il refuse l’idée du droit naturel qui serait guidé par l’instinct humain,
c’est-à-dire un droit commun aux Hommes qui possèdent l'instinct, la raison et la
conscience pour se défendre et réfléchir par soi-même.
Selon lui, le droit positif, constitué
par les lois et règlements, règles obligatoires établies par une autorité souveraine, suffit
pour définir le juste et l’injuste.
Ce droit représente un ensemble de normes obligatoires
qui régissent les relations entre individus au sein d’une société et qui, dans leur essence,
dans leur nature, s’inscrivent dans une continuité historique.
La notion d’ « Histoire »
évoquée dans le titre de l’extrait prend alors tout son sens car le droit positif se construit
tout au long du temps au fur et à mesure de l’évolution de sociétés et des gouvernements
à la tête des sociétés.
Guidées par des lois et des principes moraux, les sociétés considèrent la justice
comme une légalité, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de principe supérieur qui guide le droit.
Pour le dire autrement, ce qui est juste ou injuste est déterminé uniquement par les lois et
par ce que nous appelons aujourd’hui, le cadre juridique : les lois ont été écrites comme
cela par les législateurs et nous devons nous y conformer.
Par exemple, la « Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen » écrit en 1789, un des textes fondateurs de la
justice en France, incarne cette idée de cadre, de règlement, que toute la population doit
respecter au sein d’une même nation.
Toutefois, le droit positif peut varier selon les
sociétés, mais chaque individu est censé connaître les règles et principes qu’il doit
respecter pour ne pas être sanctionné.
Cependant, cette idée pose problème à Léo Strauss.
Il affirme à la ligne 5 que, « En
passant de tels jugements, nous impliquons qu’il y a un étalon du juste et de l’injuste qui
est indépendant du droit positif ».
Par cette affirmation, l’auteur sous-entend qu’il y a un
modèle de référence supérieur au droit positif qu’il identifie comme le droit naturel.
Selon
lui, celui-ci est commun à l’Homme, indépendamment de leurs origines, religions ou
cultures, et c’est lui qui nous permet de savoir si le droit positif, si les lois de notre société
sont justes ou non.
Une loi peut être légale mais perçue comme injuste si elle contrevient
à des principes fondamentaux de moralité ou d'équité.
Par exemple, dans l'histoire, des
lois ont légalisé l'esclavage ou la ségrégation, or elles sont aujourd'hui considérées
comme injustes.
Nous pouvons dire que chaque société à son idéal, et c’est ce que nous
allons voir par la suite.
En effet, Léo Strauss critique ici l’opinion commune, c’est-à-dire ce que peut penser
la population de cette vision du droit positif et droit naturel, en montrant ses
contradictions.
L’opinion à tendance à confondre le réel, ce qui existe effectivement, de
l’idéal, norme qui correspond à la perception que l’on pourrait penser comme possible, ce
dont la réalisation correspondrait à une satisfaction de l’Homme.
L’opinion a tendance à
penser que « aujourd’hui [...] l’étalon en question n’est tout au plus que l’idéal adopté par
notre société ou notre “civilisation” tel qu’il a pris corps dans ses façons de vivre ou ses
institutions », c’est-à-dire que tout droit positif est en fait un idéal pour chaque société.
Toutefois, nous ne pouvons pas affirmer que ce qui est actuellement en place dans notre
société est l’idéal puisque c’est quelque chose dont nous avons pris goût et que nous
sommes habitués désormais à suivre.
Nous nous sommes conformés à ces normes qui
sont maintenant devenues une habitude tout au plus.
Il y a une certaine logique à pouvoir
affirmer cela car les gens vivant dans une société ne sont pas objectifs sur ce qui pourrait
améliorer ce qu’ils considèrent comme....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Léo Strauss Le besoin du droit naturel
- EXPLICATION DE TEXTE Lévi-Strauss - Tristes Tropiques
- Explication de texte Kant: Comment pouvons-nous instituer un ordre politique juste, administrant le droit de façon universelle?
- histoire du droit des affaires
- Explication de texte philosophique extrait tiré de La psychanalyse du feu, Bachelard