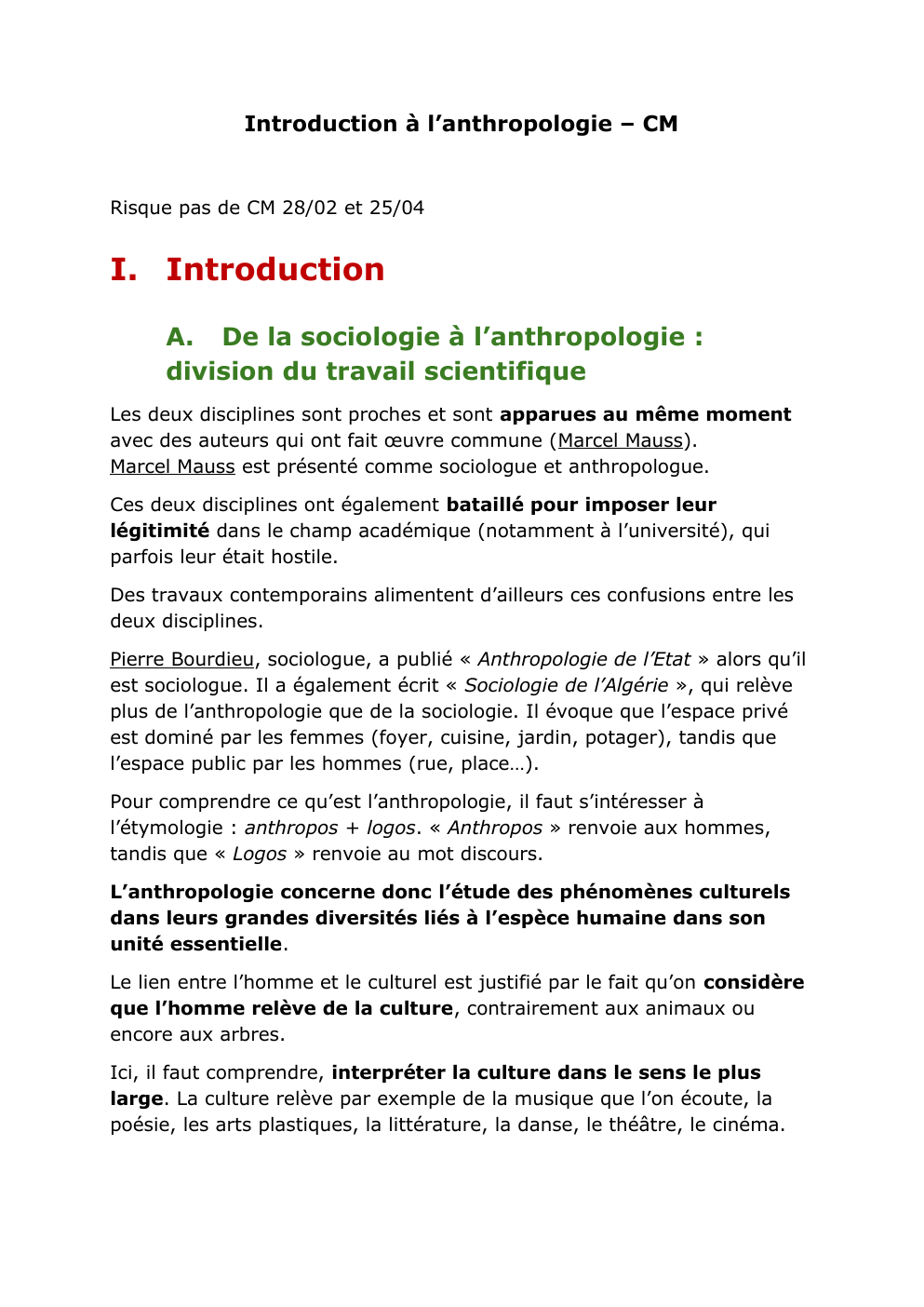Cours anthropologie
Publié le 28/04/2025
Extrait du document
«
Introduction à l’anthropologie – CM
Risque pas de CM 28/02 et 25/04
I.
Introduction
A.
De la sociologie à l’anthropologie :
division du travail scientifique
Les deux disciplines sont proches et sont apparues au même moment
avec des auteurs qui ont fait œuvre commune (Marcel Mauss).
Marcel Mauss est présenté comme sociologue et anthropologue.
Ces deux disciplines ont également bataillé pour imposer leur
légitimité dans le champ académique (notamment à l’université), qui
parfois leur était hostile.
Des travaux contemporains alimentent d’ailleurs ces confusions entre les
deux disciplines.
Pierre Bourdieu, sociologue, a publié « Anthropologie de l’Etat » alors qu’il
est sociologue.
Il a également écrit « Sociologie de l’Algérie », qui relève
plus de l’anthropologie que de la sociologie.
Il évoque que l’espace privé
est dominé par les femmes (foyer, cuisine, jardin, potager), tandis que
l’espace public par les hommes (rue, place…).
Pour comprendre ce qu’est l’anthropologie, il faut s’intéresser à
l’étymologie : anthropos + logos.
« Anthropos » renvoie aux hommes,
tandis que « Logos » renvoie au mot discours.
L’anthropologie concerne donc l’étude des phénomènes culturels
dans leurs grandes diversités liés à l’espèce humaine dans son
unité essentielle.
Le lien entre l’homme et le culturel est justifié par le fait qu’on considère
que l’homme relève de la culture, contrairement aux animaux ou
encore aux arbres.
Ici, il faut comprendre, interpréter la culture dans le sens le plus
large.
La culture relève par exemple de la musique que l’on écoute, la
poésie, les arts plastiques, la littérature, la danse, le théâtre, le cinéma.
Cependant, pour les anthropologues, la culture est beaucoup plus
large que la création artistique.
On note par exemple l’alimentation, la
façon de se vêtir, la science, le droit, le religieux, l’éducation, les mœurs
(par exemple les Allemands s’embrassent beaucoup moins que les
Français).
Pour Edward B.
Taylor, la culture est un ensemble complexe incluant
les savoirs : les croyances, l’art, les mœurs, le droit, les coutumes ainsi
que toute disposition ou usage acquis par l’homme vivant en société.
L’UNESCO définit la culture comme l’ensemble des traits distinctifs,
spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société.
La sociologie est elle, centrée sur l’étude des individus et des
groupes comme socialement déterminés.
En même temps, la
sociologie s’intéresse également à la dimension culturelle, pour elle
c’est un élément macro social qui unit les membres d’une société, qui se
transmet de génération en génération (par exemple, la transmission de la
bise, ou de la baguette de pain.)
Les sociologues voient également la culture comme un ensemble de façon
de penser et de faire conforme (sa braguette descend et ça le fait chier
ptdrrr).
On a souvent tendance à proposer un découpage de ce type : la
sociologie s’intéresse aux sociétés occidentales (considérées comme
sociétés modernes, ou encore « civilisées » (très limite)), alors que
l’anthropologie s’intéresse aux sociétés non-occidentales (sociétés
africaines, asiatiques, océaniques, américaines, ou encore « primitives »
(très limite aussi)).
Cette distinction repose sur une dichotomie caricaturale, autrement dit
sur une vision occidentalo-centrée : nous avons une vision de la réalité
dominée par les normes de référence qui sont les nôtres.
Les sociétés dites « primitives » sont intériorisées au regard des sociétés
dites « civilisées ».
Toutes les sociétés de tous les continents
connaissent en réalité des formes de civilisation qui sont simplement
différentes.
Elles ont également toutes une mémoire, un passé, même
lorsqu’elles reposent sur des cultures orales.
En clair, il n’y a pas de
sociétés mieux civilisées que d’autres.
Par ailleurs, les anthropologues s’intéressent aussi aux sociétés
contemporaines, notamment dans leurs aspects les plus actuels.
Par exemple, Christian Bromberger, un anthropologue Français travaillait
sur l’anthropologie du football, notamment sur des championnats actuels
(travaux portant sur l’OM, la Juv, et Naples).
Il y a une autre proposition fausse qui est de dire, que les
anthropologues ont tendance à travailler sur des sociétés plus restreintes
que le font les sociologues (par exemple, une communauté villageoise ou
tribale).
C’est faux, ils n’ont jamais renoncé à s’interroger sur des
grandes questions impliquant une société dans son vaste ensemble (par
exemple sur son rapport général à la nature).
Il y a plusieurs différences essentielles entre les deux disciplines :
▪
La sociologie n’ignore pas les cultures globales, il y a des travaux de
sociologie qui portent sur la France contemporaine, mais insiste
souvent sur des sous-cultures liées aux groupes sociaux.
Par exemple, la sociologie de l’alimentation se concentre sur des
rapports différents que les individus socialement différenciés
entretiennent avec l’alimentation : il y a des différences d’alimentation
entre les générations, les hommes et les femmes, mais également
entre les zones urbaines et rurales.
▪
L’anthropologie se concentre sur les cultures liées à un peuple
dans son ensemble.
Elle cherche donc à dévoiler ce qui fait la
spécificité des phénomènes humains.
Au sein de l’anthropologie, il
y a un mouvement que s’appelle le folklorisme qui compte des
anthropologues spécialisés dans les cultures régionales.
▪
Les sociologues sont donc davantage porter à insister sur les
inégalités et à les dévoiler, notamment en les quantifiant (méthode
quantitative).
▪
Les anthropologues insistent moins sur les inégalités, mais
davantage sur ce qui est commun à une population avec des
méthodes qualitatives.
Pour Claude Levis Strauss, l’anthropologie est à voir comme un mode
original de connaissance, plutôt qu’une source de connaissance
particulière.
Cela signifie que l’anthropologie se distingue par sa
particularité méthodologique.
Les anthropologues sont très attachés à l’observation participante :
c’est une immersion prolongée dans la communauté étudiée, avec
participation à ses activités associées.
Même si elle peut avoir les mêmes
objets d’études que l’anthropologie a une façon bien à elle de les aborder.
L’anthropologie a en effet une façon plus intime ou plus sensible de
traiter les rapports qui se trament entre individus et l’espace.
Cette insuffisance d’intimité au sein de la sociologie est dû au fait qu’elle
s’est imposée l’extériorité par rapport à l’objet d’étude (Pour
Durkheim, il faut être extérieur à la société pour la comprendre, tandis
que les anthropologues pensent qu’il faut être bien plus profond.).
B.
Le rapport entre nature et culture
L’anthropologie a fondé une réflexion originale et très riche du rapport
entre la nature et la culture.
Au départ, quand on s’intéresse à la façon dont la philosophie a pensé le
rapport entre nature et culture, on observe qu’elle les a brutalement
séparées.
Pour la philosophie, la nature est associée à l’animalité avec un
côté non humain, tandis que la culture renvoie au côté humain.
La nature est considérée comme vierge, incréée, donnée alors que la
culture comme pleine, créée.
Les philosophes valorisent la culture et dévalorisent la nature.
L’anthropologie permet de fausser cette opposition.
Philippe Descola, un anthropologue militant dénonce la tendance des
hommes, notamment en Occident, de se mettre en position du
surplomb par rapport à la nature et au non-humain.
Finalement pour
l’humanité moderne et pour les philosophes, la nature serait malléable et
exploitable à l’infini selon nos propres désirs.
Philippe Descola s’est beaucoup intéressé aux indiens d’Amazonie, la
société des Achuars.
Cela ferait 12 000 ans que les Achuars ont
sélectionné les arbres a exploité et à replanter : la forêt apparait donc
comme plantation et non pas comme espace vierge.
La nature s’est faite anthropiser (travailler, modeler par l’activité
humaine), autrement dit, la nature est socialisée.
Il faut donc renoncer à
l’idée que le « civilisé » serait un autre homme que le « primitif ».
Le
« primitif » est aussi culturel, mais d’une autre manière que le
« civilisé ».
On peut aussi penser que les êtres les plus « civilisés » sont aussi animés
par des forces surnaturelles, ce qu’on appelle les instincts.
Les instincts
sont en nous et sont domestiques.
Chez les Achuars, le mot « nature » n’existe pas.
Descola considère que
les Achuars nous encouragent à fournir un effort d’animisme, pour
penser les rapports entre les humains et les non-humains.
Descola
ne dit pas qu’il faut devenir animiste et de voir un dieu dans tout ce qui
nous entoure, mais seulement nous décentrer de notre culture
occidentale où l’on considère qu’une pierre, un arbre ou un animal est
simplement à notre service.
Cours 2
1.
Le passage de la nature à la culture chez Claude Lévi-Strauss
Selon Claude Lévi-Strauss, le passage de la nature à la culture repose sur une
règle universelle : l’interdiction de l’inceste.
Cette interdiction signifie qu’un
père ne peut pas épouser sa fille, ce qui, d’un point de vue culturel, renvoie à
une régulation des relations sexuelles et sociales.
Cependant, l’animal n’est pas aussi vierge ou éloigné de la culture que l’on
pourrait le croire.
Certains animaux sont fortement "culturalisés", c’est-à-dire
représentés sur des objets, des produits ou dans l’imaginaire collectif humain.
2.
Contexte socio-historique d’émergence de l’anthropologie
L’anthropologie a produit un décentrement essentiel face aux préjugés de
l’anthropocentrisme, c’est-à-dire la croyance que l’espèce humaine est au centre
de l’univers et que tout doit être évalué par rapport à elle.
Pourtant, sur quels
critères les humains placent-ils les animaux en-dessous d’eux ?
Une version locale de l’anthropocentrisme est l’occidentalo-centrisme ou
l’europocentrisme.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Cours anthropologie
- La seconde guerre mondiale Cours terminal
- Cours de Philosophie : Le bonheur – Lettre à Ménécée
- Peut-on prédire les cours de la bourse a l'aide des mathematiques ?
- Cours: Histoire des institutions politiques