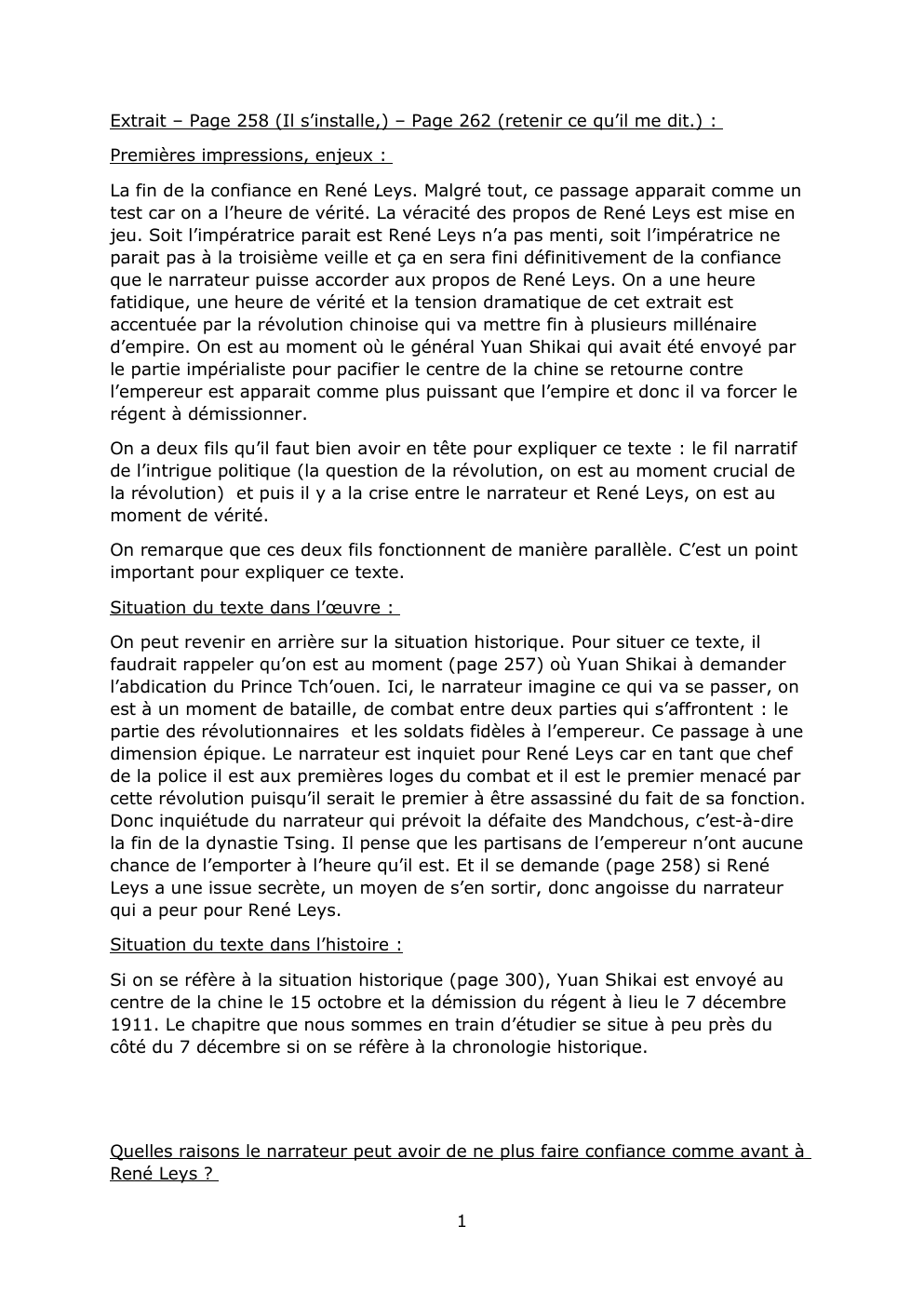commentaire texte: René Leys - Roman de Victor Segalen
Publié le 18/09/2022

Extrait du document
«
Extrait – Page 258 (Il s’installe,) – Page 262 (retenir ce qu’il me dit.) :
Premières impressions, enjeux :
La fin de la confiance en René Leys.
Malgré tout, ce passage apparait comme un
test car on a l’heure de vérité.
La véracité des propos de René Leys est mise en
jeu.
Soit l’impératrice parait est René Leys n’a pas menti, soit l’impératrice ne
parait pas à la troisième veille et ça en sera fini définitivement de la confiance
que le narrateur puisse accorder aux propos de René Leys.
On a une heure
fatidique, une heure de vérité et la tension dramatique de cet extrait est
accentuée par la révolution chinoise qui va mettre fin à plusieurs millénaire
d’empire.
On est au moment où le général Yuan Shikai qui avait été envoyé par
le partie impérialiste pour pacifier le centre de la chine se retourne contre
l’empereur est apparait comme plus puissant que l’empire et donc il va forcer le
régent à démissionner.
On a deux fils qu’il faut bien avoir en tête pour expliquer ce texte : le fil narratif
de l’intrigue politique (la question de la révolution, on est au moment crucial de
la révolution) et puis il y a la crise entre le narrateur et René Leys, on est au
moment de vérité.
On remarque que ces deux fils fonctionnent de manière parallèle.
C’est un point
important pour expliquer ce texte.
Situation du texte dans l’œuvre :
On peut revenir en arrière sur la situation historique.
Pour situer ce texte, il
faudrait rappeler qu’on est au moment (page 257) où Yuan Shikai à demander
l’abdication du Prince Tch’ouen.
Ici, le narrateur imagine ce qui va se passer, on
est à un moment de bataille, de combat entre deux parties qui s’affrontent : le
partie des révolutionnaires et les soldats fidèles à l’empereur.
Ce passage à une
dimension épique.
Le narrateur est inquiet pour René Leys car en tant que chef
de la police il est aux premières loges du combat et il est le premier menacé par
cette révolution puisqu’il serait le premier à être assassiné du fait de sa fonction.
Donc inquiétude du narrateur qui prévoit la défaite des Mandchous, c’est-à-dire
la fin de la dynastie Tsing.
Il pense que les partisans de l’empereur n’ont aucune
chance de l’emporter à l’heure qu’il est.
Et il se demande (page 258) si René
Leys a une issue secrète, un moyen de s’en sortir, donc angoisse du narrateur
qui a peur pour René Leys.
Situation du texte dans l’histoire :
Si on se réfère à la situation historique (page 300), Yuan Shikai est envoyé au
centre de la chine le 15 octobre et la démission du régent à lieu le 7 décembre
1911.
Le chapitre que nous sommes en train d’étudier se situe à peu près du
côté du 7 décembre si on se réfère à la chronologie historique.
Quelles raisons le narrateur peut avoir de ne plus faire confiance comme avant à
René Leys ?
1
1er raison :
Le général Yuan Shikai était parti pacifier les provinces du centre et finalement il
revient à Pékin.
Il arrive en train avec ces troupes militaires, c’est lui l’homme
fort du moment, il est plus puissant que l’empereur et le Régent et il se prépare
à faire abdiquer le régent.
Le train, c’est celui qui ramène Yuan Shikai du centre
de la Chine vers Pékin.
Le narrateur assiste à cette arrivée, il voit le personnage
sortir du train, il est parmi la foule, il est en haut de remparts, il voit toute la
scène.
Et lorsqu’il le dit à René Leys, René Leys ne semble pas être au courant.
C’est l’épisode qui le fait douter le plus.
Les doutes sont de plus en plus sérieux car depuis le début, René Leys minimise
l’importance ce qui se joue dans le centre de la Chine, il minimise l’importance
des soubresauts révolutionnaires.
Il est davantage concentré sur ses nuits avec
l’impératrice et tout ce qu’il raconte au narrateur que sur la protection du régent.
Page 230, le narrateur dit qu’il joue dans son jeu, c’est-à-dire dans le jeu de
René Leys, il prend parti du côté de l’empire et il observe les règles du jeu, la
marche de chacun des pions.
Les pions représentent ici d’un côté les armées
impériales, de l’autre côté les révolutionnaires, les noirs et les blancs, la marche
des pions, la marche des deux armées.
La métaphore du jeu d’échecs est
structurante dans ce récit.
Le narrateur commence à s’ouvrir à René Leys de ses inquiétudes concernant la
révolution qui est en marche et René Leys semble minimiser l’importance de ses
faits puisque ce qui l’intéresse d’avantage c’est le mouvement réformiste, les
deux mille étudiants qui seraient en marche pour battre la campagne autour du
Pékin.
Et le narrateur est indigné (fin de page 231), sous-entendu que René Leys
ne comprend ce qui est en jeu, la révolution se joue au centre de la Chine et lui il
s’attarde sur cette révolte d’étudiants qui ne parait pas du tout dangereux aux
yeux du narrateur, ce n’est pas là qu’il y a le véritable danger.
René Leys prétend que le Régent n’est pas au courant de la révolution et il
prétend que la menace est exagérée par les européens.
C’est sa position, il dit
que tout ça, ce sont des inventions des européens que le narrateur à tort
d’écouter.
Page 234, les partisans de l’empereur sont comparés à des fous, et
donc toujours dans ces pièces du jeu d’échecs « les impériaux et ses amis sont
des fous à honorer comme tels ».
À ce moment-là, l’école des nobles est fermée,
le narrateur commence à chercher partout René Leys dans la ville et page 235 on
apprend que Yuan Shikai est nommé Vice-Roi des provinces révoltées du Centre.
Pour le narrateur, c’est une grave erreur de la part du Régent d’avoir donné tous
ces pouvoirs à Yuan Shikai car il qualifie Yuan Shikai de vieux renard, il anticipe
le fait que Yuan Shikai va se retourner contre le pouvoir et être la cause de la
défaite du Régent.
À ce moment-là, René Leys lui dit que c’est lui qui a provoqué
la nomination de Yuan Shikai (page 236), et il dit que cette une façon de l’écarter
de Pékin, René Leys prétend que c’est lui qui a demandé que Yuan Shikai soit
nommé Vice-Roi des provinces révoltées du Centre pour l’écarter de Pékin et le
rendre moins dangereux.
Il y a ensuite une montée progressive de la tension
révolutionnaire avec une montée des doutes du narrateur et la crise qui finit par
éclater comme un orage.
2
2éme raison :
Page 237-238, tout ça, c’est inspiré directement des faits historiques vécus par
Segalen au moment où il était à Pékin, il s’inspire de tout ce qu’il a pu suivre.
L’idée de René Leys vient de la rencontre de Segalen avec un certain Maurice
Roy et que c’est au moment de la révolution où il a commencé à avoir des doutes
sur ce Maurice Roy et il s’est aperçu que Maurice Roy le mystifiait depuis le
début.
C’est un peu ce qui se passe dans ce roman.
René Leys vient lui annoncer
que les banques ont fait faillites et il lui demande de garder tout ce qu’il reste de
sa fortune, or d’après tout ce qu’il avait raconté au narrateur, le narrateur le
pensait très riche, il pensait qu’il avait pu accumuler une certaine fortune et il ne
lui reste plus que 400 francs qu’il demande au narrateur de garder et le
narrateur ne comprend pas pourquoi René Leys n’a pas retiré son argent de la
banque surtout que René Leys lui dit qu’il était au courant de cette faillait avec
qu’elle n’ait lieu (page 238).
René Leys prétend qu’il n’a pas eu le temps de
retirer son argent de la banque parce qu’il était occupé à arrêter les banquiers au
risque de prendre des mauvais coups.
3éme raison :
René Leys considère que tous ces racontars à propos de la révolution sont des
histoires de naturalisé (page 241).
Or, (page 245) on a l’arrivé de Yuan Shikai à
Pékin, moment historique.
Il court vers René Leys pour lui apprendre cela, René
Leys se relève en ayant mal au ventre du coup reçu la veille, et le narrateur dit
avec humour « me prend-il pour un médecin ? » au moment où René Leys lui
parle de son ventre, on sait que Segalen était lui-même médecin donc il y a tout
un jeu humoristique avec la biographie de l’auteur.
Page 248, le narrateur vexé
ne dit rien à René Leys, et René Leys lui affirme que Yuan Shikai est à 1000 km
de Pékin.
Le narrateur sait que cela est faux puisqu’il l’a vu arrivé dans la gare
(page 248) et c’est à ce moment-là que la confiance en René Leys s’effondre,
« Pour la première fois, chercherait-il ce qu’il a l’intention de m’apprendre ? ».
La
dernière carte abattue par René Leys c’est d’affirmer que ce n’est pas Yuan
Shikai que le narrateur aurait vu débarquer mais son sosie.
Le narrateur est
consterné par cette affirmation qui se termine par une nouvelle crise de René
Leys qui s’évanouie (page 250) et le narrateur se demande s’il s’évanouie du fait
de sa peur des circonstances politiques ou bien s’il s’évanouie par débit de n’être
pas cru dans sa version incroyable.
À partir de ce moment-là, le narrateur commence à douter de tout (page 254255).
Le narrateur qui est à la fois incrédule devant les révélations de René Leys
mais qui reste admiratif de la figure du compteur, et puis admiratif devant la
façon qu’il a de faire entrer le mythe dans la vie quotidienne, en particulier le
mythe impérial auquel le narrateur accorde une grande place, donc il confie son
admiration pour le compteur malgré tout.
Restitution du texte :
L’extrait étudié est à resituer par rapport à cette affirmation des doutes du
narrateur, en particulier lorsque René Leys lui affirme qu’il est à 1000km de
Pékin alors que le narrateur vient de le voir débarquer et que l’hypothèse du
sosie parait tout de même un peu farfelue.
3
Page 257-258.
On est maintenant au moment de la grande nuit, le narrateur
s’attend à voir René Leys sortir pour aller venir en aide à l’empereur (le Régent)
pour le sauver de la menace de mort que constitue la révolution.
Or, de manière
étonnante, René Leys n’a pas du tout l’intention de sortir, il commence par
prendre un bon repas avec le narrateur.
Le narrateur insiste sur l’appétit de René
Leys (de grand appétit) qui mange très bien, et au moment où le narrateur croit
qu’il va sortir pour accomplir sa mission de chef de la police sécrète René Leys
déclare : je ne sors pas.
Et c’est là que début notre texte.
Analyse linéaire :
« Il s’installe […] d’hiver.
» Le narrateur s’attend à ce que René Leys se conduise
en homme d’action mais il se conduit de manière nonchalante.
On a une
alternance entre du dialogue et du récit.
Ici, on est dans un récit.
(Vous
rappellerez pour une explication toujours qu’il s’agit d’un narrateur-personnage,
ce qu’on appelle un narrateur homodiégétique.)
Le narrateur insiste sur le fait que René Leys s’installe allongé sur la chaise.
On
peut souligner dans ce début de texte qu’il y a une opposition entre les attentes
du narrateur et la conduite de René Leys, c’est-à-dire qu’il fait l’inverse de ce que
le narrateur attend, le narrateur attend une action de guerrier qui va prendre
part à un combat, or René Leys s’allonge.
Il y a une opposition entre la verticalité
et l’horizontalité de l’allongé.
Allongé c’est la position dans laquelle ils ont discuté
pendant tout le livre, ce début de texte fait qu’on a un bilan de leur relation,
notamment avec l’expression « huit mois de confidences » on a l’impression
qu’on arrive aux termes et qu’il y a une sorte de bilan.
On a une tournure qui est
inhabituel « l’enfermé de la maison d’hiver », c’est une tournure surprenante
parce qu’elle n’est pas commune.
L’ « enfermé », on a un participe passé
substantivé, on peut y voir une insistance sur le révolu, sur le fait que beaucoup
de choses sont rejetées dans le passé du fait de cette révolution qui marque un
tournant historique et dans leur relation.
On a aussi une isotopie du Dedans (la
cité interdite) qui s’oppose au verbe sortir, l’intérieur s’oppose à l’extérieur,
l’intérieur est protecteur il est synonyme de « droit d’asile » puisque le narrateur
est européen et donc sa maison n’est pas menacé par la révolution, il est protégé
par son statut d’étranger, protéger également du froid car on est en plein hiver.
Donc on retrouve cette opposition entre le Dedans et le dehors mais de manière
inversée puisque cette fois c’est la maison du narrateur qui est considérée
comme le Dedans.
« Il ne sort pas.
Il ne va pas au Palais ».
On a deux phrases courtes qui reposent
sur la même construction, on peut parler de parallélisme de construction avec
l’anaphore de « il » suivit de la négation, deux phrases qui se répètent.
Il y a ici,
4
un effet d’insistance sur le fait que le personnage reste alors que le narrateur
s’attendait à le voir partir.
Ici, il faut commenter la situation, on a un narrateur
qui est particulièrement excité par la situation historique qui est en train de se
jouer, qui est au comble de la tension nerveuse opposé à un René Leys
nonchalant, les deux attitudes vont dans l’outrance, on pourrait presque parler
de comique de situation comme au théâtre.
Il y a une situation qui est comique
par le décalage complet entre les attentes du narrateur et l’attitude de René
Leys.
Les premières lignes du texte peuvent apparaitre comme des didascalies
(« il s’installe, allongé »), on a un aspect assez théâtrale de ce texte.
Une suite d’antithèses à souligner : « Je lui laisse entendre que sa présence ici,
près de moi, me rassure sur lui.
», l’opposition entre « ici » et « palais » et
l’opposition entre « rassure » et « craindre » dans la phrase suivante.
Le
narrateur poursuit l’analogie du Dedans avec la traduction de l’expression
chinoise « sous les plis du drapeau étranger », on retrouve cet effet d’exotisme.
Le mot « porte » est un terme qui nous est familier, qui est beaucoup employé
pour parler des portes des murailles de la ville, or la porte, cette fois, c’est la
porte de la maison du narrateur.
« Laquelle ainsi que du sang de l’agneau protégeant du massacre, est marquée
d’un vieux lampion tricolore ! », on a une référence à l’apocalypse dans la Bible,
au moment de l’apocalypse, ceux qui ont leur porte marqué du sang de l’agneau
seront épargnés.
Ici, il y a un jeu de confrontation entre la mythologie liée à la
figure de l’empereur de Chine et puis des images qui viennent de la tradition
chrétienne, en particulier de la Bible.
Le « lampion tricolore....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire de texte sur un extrait du chapitre 3 du livre III des Misérables, de Victor Hugo : Le jardin de la rue Plumet. Il s'agira de voir quelle signification revêt ce jardin dans l'économie du roman et dans l'esthétique romanesque hugolienne.
- Commentaire lineal CONTEMPLATIONS, VICTOR HUGO (1856), LIVRES I à IV TEXTE 1: "Vieille chanson du jeune temps", I, 19
- Commentaire de texte : Victor Hugo, Les contemplations, Livre premier, VII (1856) - Réponse à un acte d'accusation
- Commentaire sur le texte de Roger Vitrac, Victor ou les enfants au pouvoir
- Victor Hugo, Notre-Dame de Paris: Vous ferez de ce texte un commentaire composé, que vous organiserez à votre gré. Vous pourrez montrer, par exemple, comment, dans un portrait fondé sur l'esthétique de la laideur, le narrateur fait de Quasimodo un monstre sublime.