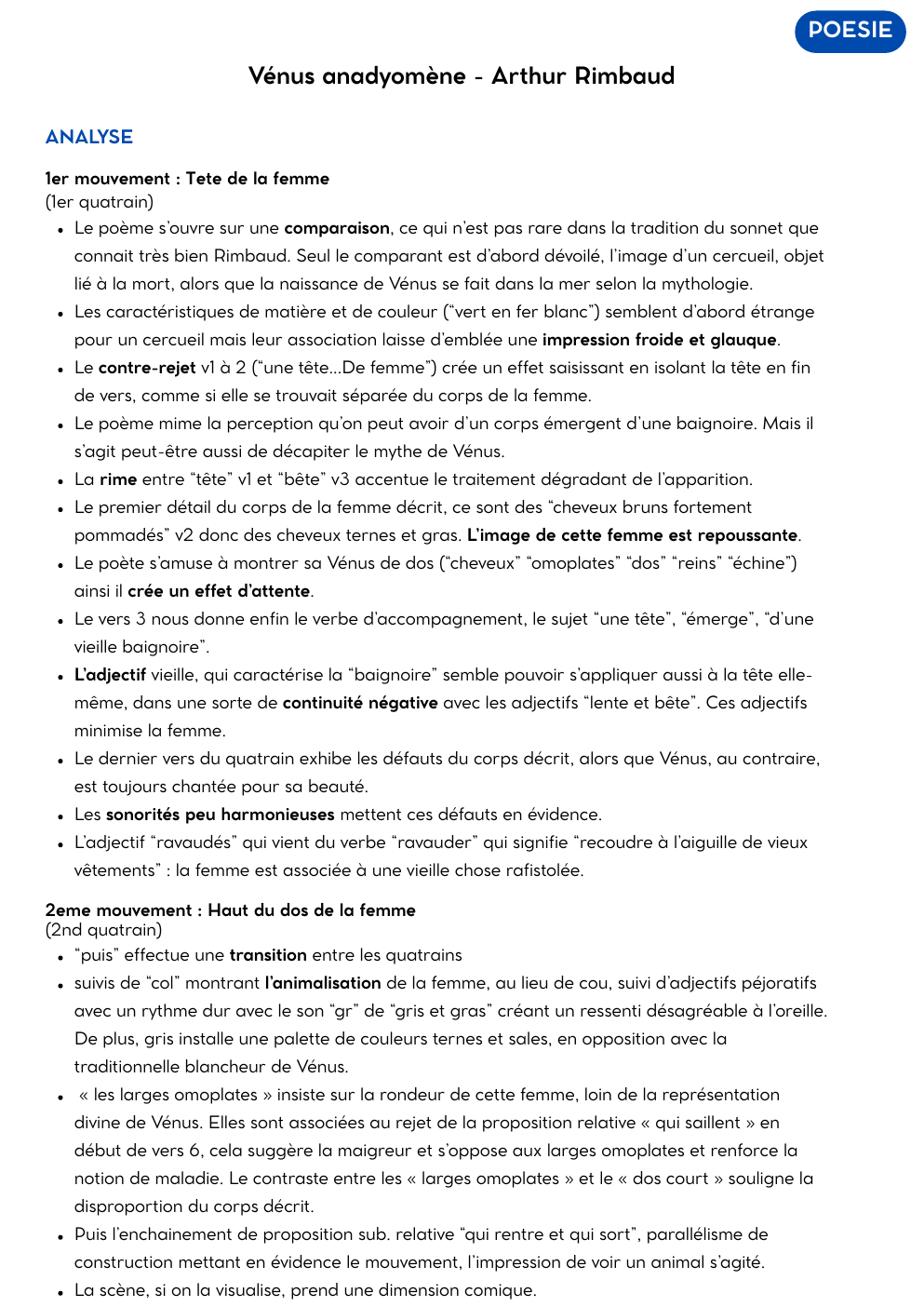Venus Anadyomene - Arthur Rimbaud
Publié le 02/05/2025
Extrait du document
«
POESIE
Vénus anadyomène - Arthur Rimbaud
ANALYSE
1er mouvement : Tete de la femme
(1er quatrain)
Le poème s’ouvre sur une comparaison, ce qui n’est pas rare dans la tradition du sonnet que
connait très bien Rimbaud.
Seul le comparant est d’abord dévoilé, l’image d’un cercueil, objet
lié à la mort, alors que la naissance de Vénus se fait dans la mer selon la mythologie.
Les caractéristiques de matière et de couleur (“vert en fer blanc”) semblent d’abord étrange
pour un cercueil mais leur association laisse d’emblée une impression froide et glauque.
Le contre-rejet v1 à 2 (“une tête...De femme”) crée un effet saisissant en isolant la tête en fin
de vers, comme si elle se trouvait séparée du corps de la femme.
Le poème mime la perception qu’on peut avoir d’un corps émergent d’une baignoire.
Mais il
s’agit peut-être aussi de décapiter le mythe de Vénus.
La rime entre “tête” v1 et “bête” v3 accentue le traitement dégradant de l’apparition.
Le premier détail du corps de la femme décrit, ce sont des “cheveux bruns fortement
pommadés” v2 donc des cheveux ternes et gras.
L’image de cette femme est repoussante.
Le poète s’amuse à montrer sa Vénus de dos (“cheveux” “omoplates” “dos” “reins” “échine”)
ainsi il crée un effet d’attente.
Le vers 3 nous donne enfin le verbe d’accompagnement, le sujet “une tête”, “émerge”, “d’une
vieille baignoire”.
L’adjectif vieille, qui caractérise la “baignoire” semble pouvoir s’appliquer aussi à la tête ellemême, dans une sorte de continuité négative avec les adjectifs “lente et bête”.
Ces adjectifs
minimise la femme.
Le dernier vers du quatrain exhibe les défauts du corps décrit, alors que Vénus, au contraire,
est toujours chantée pour sa beauté.
Les sonorités peu harmonieuses mettent ces défauts en évidence.
L’adjectif “ravaudés” qui vient du verbe “ravauder” qui signifie “recoudre à l’aiguille de vieux
vêtements” : la femme est associée à une vieille chose rafistolée.
2eme mouvement : Haut du dos de la femme
(2nd quatrain)
“puis” effectue une transition entre les quatrains
suivis de “col” montrant l’animalisation de la femme, au lieu de cou, suivi d’adjectifs péjoratifs
avec un rythme dur avec le son “gr” de “gris et gras” créant un ressenti désagréable à l’oreille.
De plus, gris installe une palette de couleurs ternes et sales, en opposition avec la
traditionnelle blancheur de Vénus.
« les larges omoplates » insiste sur la rondeur de cette femme, loin de la représentation
divine de Vénus.
Elles sont associées au rejet de la proposition relative « qui saillent » en
début de vers 6, cela suggère la maigreur et s’oppose aux larges omoplates et renforce la
notion de maladie.
Le contraste entre les « larges omoplates » et le « dos court » souligne la
disproportion du corps décrit.
Puis l’enchainement de proposition sub.
relative “qui rentre et qui sort”, parallélisme de
construction mettant en évidence le mouvement, l’impression de voir un animal s’agité.
La scène, si on la visualise, prend une dimension comique.
Ainsi, la maladresse du mouvement s’ajoute à la disgrâce du corps.
Le détail dans la description (« La graisse sous la peau paraît en feuilles plates » v7) cherche
à créer le dégoût.
Le schéma de rimes un peu inhabituel crée également de la dysharmonie, ABBA embrassées
v7 “la rondeur des reins” accentue la grosseur de la dame
“semble” montre une hésitation du poète suivi de “prendre de l’essor” comme si la femme
effectuait un effort afin de s’extirper de la baignoire.
3ème mouvement : Bas du dos de la femme
(1er tercet)
Ainsi, le regard du lecteur poursuit sa descente le long du dos de la femme.
Le terme « échine » appartient au vocabulaire animal, ce qui est en soi une façon de
dégrader le corps féminin; pareil avec le vers 13 et le nom « croupe ";
Ce lexique vient en outre faire écho à l'adjectif « bête » du vers 3.
“Echine” associé à l’adjectif “rouge” s’oppose à la pureté d’une belle peau blanche adorée au
19ème siècle.
L'évocation est péjorative, la femme étant assimilée à un simple assemblage de différentes
parties et comparée à un animal.
(« sent un goût ») : Rimbaud accentue la sensation de vague dégoût qu'il cherche à susciter
avec une synesthésie à caractère négatif.
De plus, tous les sens sont sollicités, la vue avec
“rouge”, l’odorat avec “sent” et le gout avec “gout” au v1.
L'expression « Horrible étrangement » c'est un signe de la nouvelle poésie de Rimbaud : la
beauté n'est pas seulement une projection idéale, elle est plus complexe (cf.
la phrase de
Baudelaire : « Le beau est toujours bizarre »).
Avec l'introduction du pronom indéfini « on », Rimbaud....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- VENUS ANADYOMENE DE RIMBAUD
- Fiche de lecture, Arthur Rimbaud, Cahiers de Douai.
- Arthur Rimbaud : Les Cahiers de Douai
- venus d'anadyomène Rimbaud
- Analyse linéaires de Ornière de Arthur Rimbaud