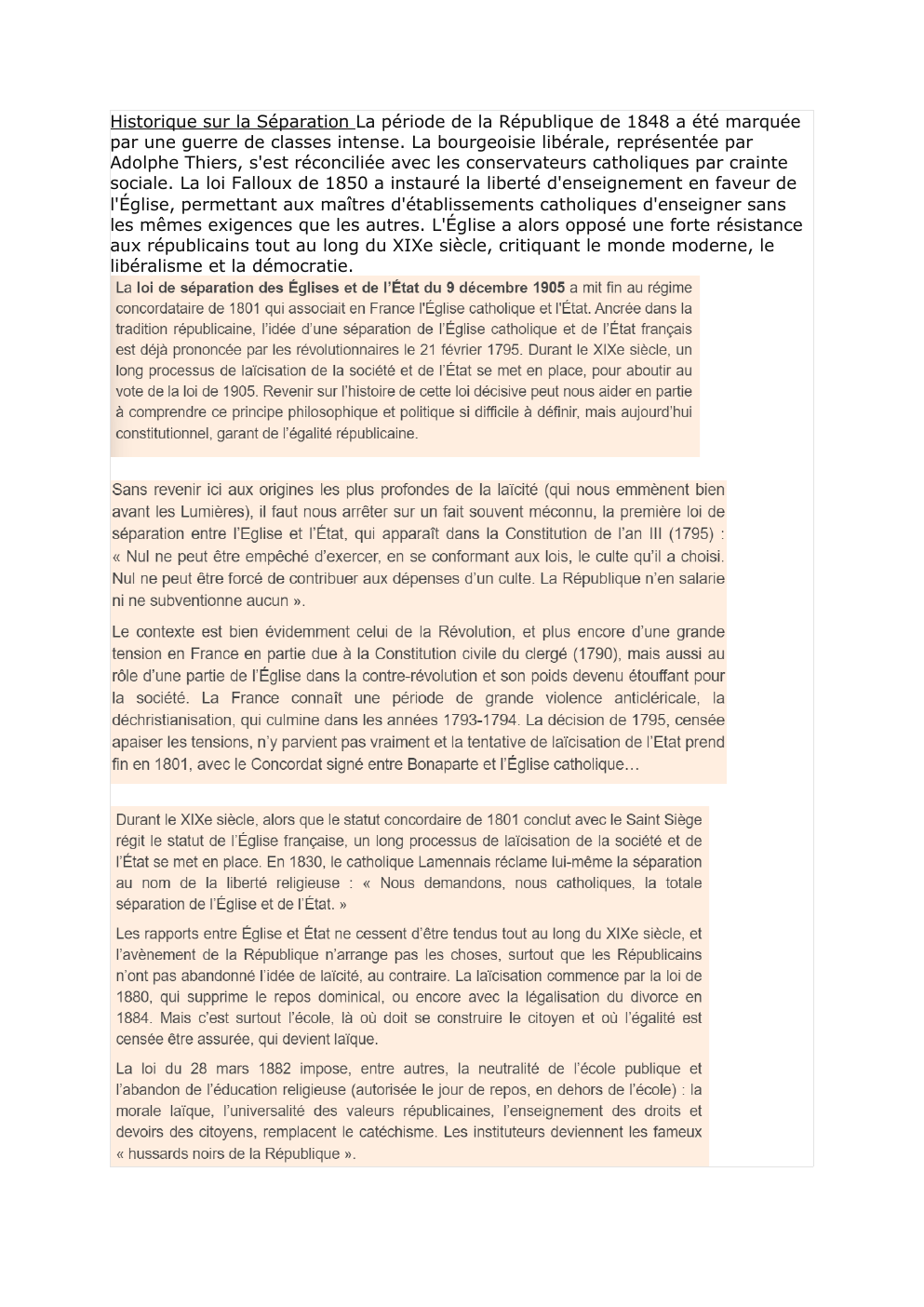séparation église et état
Publié le 13/05/2025
Extrait du document
«
Historique sur la Séparation La période de la République de 1848 a été marquée
par une guerre de classes intense.
La bourgeoisie libérale, représentée par
Adolphe Thiers, s'est réconciliée avec les conservateurs catholiques par crainte
sociale.
La loi Falloux de 1850 a instauré la liberté d'enseignement en faveur de
l'Église, permettant aux maîtres d'établissements catholiques d'enseigner sans
les mêmes exigences que les autres.
L'Église a alors opposé une forte résistance
aux républicains tout au long du XIXe siècle, critiquant le monde moderne, le
libéralisme et la démocratie.
La Troisième République a été le théâtre d'affrontements entre le
cléricalisme catholique, le laïcisme agressif et l'anticléricalisme.
Des
mesures laïques ont été prises, telles que la laïcisation des hôpitaux et
cimetières (1881), la suppression des aumôneries militaires (1883) et
l'autorisation du divorce (1884).
À partir des années 1890, un esprit de conciliation a émergé, avec la
politique de Ralliement visant à rapprocher les républicains laïcs et les
catholiques.
Cependant, cette tentative de conciliation a été brisée à la fin
du XIXe siècle c’est en partie en tout cas,l’affaire Dreyfus qui ravive les
tensions.
L’église voit dans cette affaire d’état un complot des protestants,
des juifs et des francs-macons ; elle s’appuie dans sa campagne sur des
journaux comme « la Croix » ou « le pelerin », et montre qu’elle a encore
un véritable pouvoir.
La période de la séparation de l'Église et de l'État devient alors agitée en France,
C’est dans ce climat que la gauche remporte les élections législatives de 1898,
notamment le gouvernement d'Émile Combes à la fin du XIXe et au début du XXe
siècle.
Combes, ministre de l’Instruction publique et des Cultes en 1895, met en
œuvre des politiques anticatholiques.
Son gouvernement adopte une position laïque
radicale, symbolisée par la loi de 1901 qui exige la transparence financière des
congregation(si sont riche—influence antirépubliciane vers la jeunesse).
En 1902,
Combes durcit les mesures en rejetant les demandes d'autorisation des
congrégations religieuses, entraînant des tensions, principalement dans les régions
catholiques et la colère du Pape Pie X .
Mais combes n’est pas encore une vraie
séparation.
C’est sans doute l’intrasigeance du pape justement, qui va jusqu’à
rompre les relations diplomatiques avec la France, qui pousse Combes à se
résoudre à la séparation en 1904.
En 1904, il interdit l'enseignement aux
congrégations, provoquant un conflit avec le Vatican et la rupture des relations
diplomatiques entre la France et le Saint-Siège.
Ce n’est pourtant pas à emile combes que l’on doit la loi de séparation de l’église et de l’état.
Il est en effet contraint de démissionner en janvier 1905.
Il a cependant influencé en partie les
travaux qui vont suivre, jusqu’à l’élaboration de la loi.
Le projet de loi sur la séparation
des Églises et de l'État est porté par une commission présidée par Ferdinand
Buisson.
qui œuvrent pour trouver un équilibre entre les intérêts divergents.
Briand,
rapporteur de la commission, joue un rôle essentiel dans l'élaboration du texte,
cherchant à concilier les opinions divergentes afin d’équilibrer et pour assurer son
adoption et son application efficace.
Le projet de loi, déposé en 1905, prévoit une
séparation loyale et complète, tout en tenant compte des sensibilités religieuses et
politiques.
Briand, conscient des défis, cherche un soutien transversal pour la loi,
conciliant la droite catholique sans céder à l'extrême gauche, adoptant la
loi avec quelques compromis pour garantir son acceptation et son
applicabilité, soulignant l'importance de considérer les préoccupations des
catholiques.
Les débats durent d’avril à juillet 1905, la loi de séparation des églises et de
l’état est votée le 9 décembre 1905.
Plusieurs grands principes la fondent : elle
affirme l’indépendance réciproque de l’état et de l’église, désormais gérés par
des associations cultuelle laïques.
C’est une loi « juste et sage » selon Jean
Jaures.
La loi de séparation des Églises et de l'État, adoptée en 1905, est le fruit de ces
efforts, marquant un tournant majeur dans l'histoire de la laïcité en France.
Elle met
fin au régime concordataire établi par Napoléon Bonaparte et rompt les liens entre
l'Église et l'État, instaurant une neutralité de l'État à l'égard des cultes.
Cette loi
constitue une avancée significative vers la laïcité et consacre la liberté de conscience
et....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- loi de séparation de l'état et l'église
- La séparation de l'Église et de l'État
- dissertation sur la séparation des pouvoirs: « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »
- séparation.
- TD DROIT CONSTITUTIONNEL Séance 5: L théorie de la séparation des pouvoir