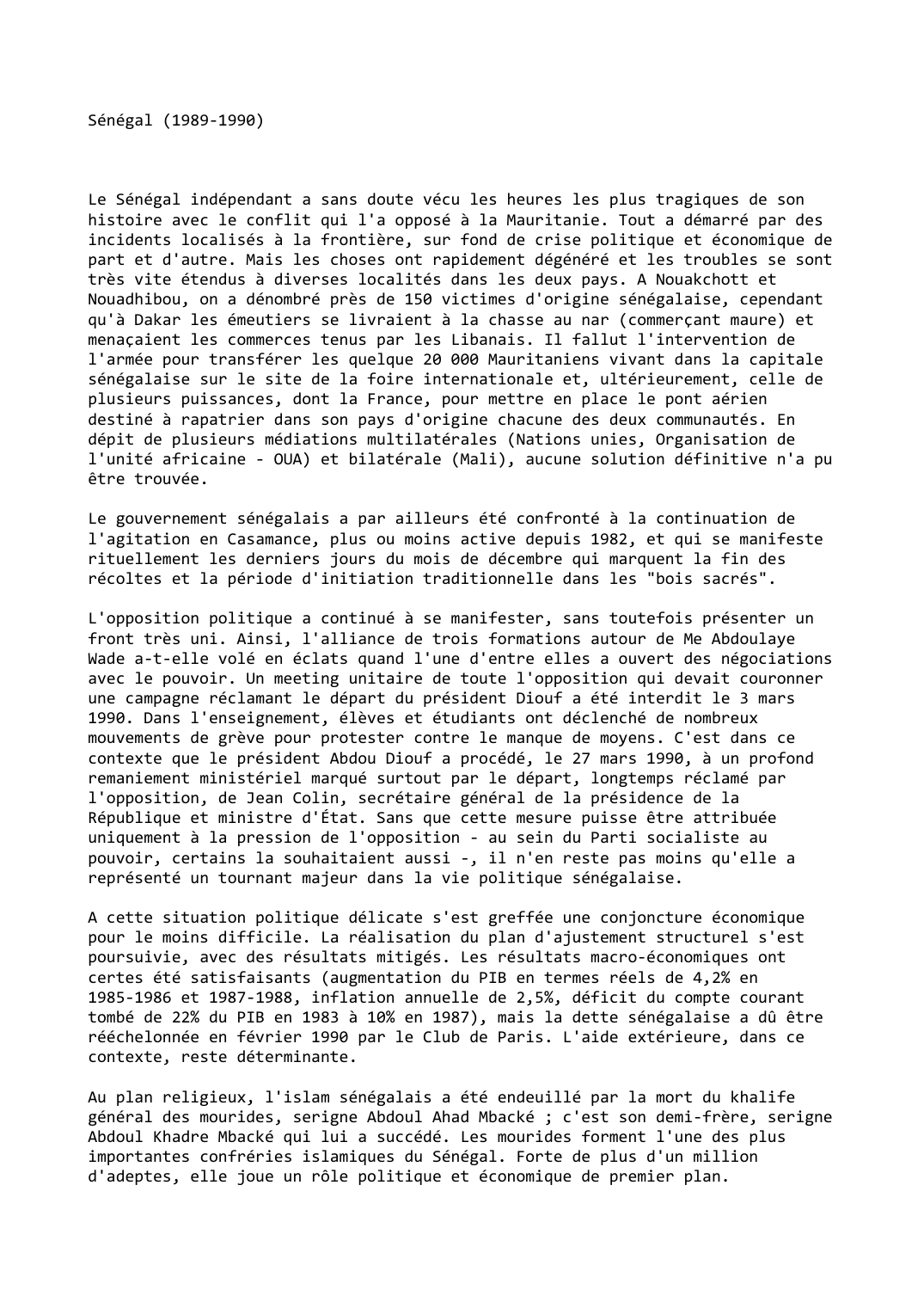Sénégal (1989-1990)
Publié le 23/09/2020

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Sénégal (1989-1990). Ce document contient 541 mots soit 2 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format PDF sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en: Histoire-géographie.
«
Sénégal (1989-1990)
Le Sénégal indépendant a sans doute vécu les heures les plus tragiques de son
histoire avec le conflit qui l'a opposé à la Mauritanie.
Tout a démarré par des
incidents localisés à la frontière, sur fond de crise politique et économique de
part et d'autre.
Mais les choses ont rapidement dégénéré et les troubles se sont
très vite étendus à diverses localités dans les deux pays.
A Nouakchott et
Nouadhibou, on a dénombré près de 150 victimes d'origine sénégalaise, cependant
qu'à Dakar les émeutiers se livraient à la chasse au nar (commerçant maure) et
menaçaient les commerces tenus par les Libanais.
Il fallut l'intervention de
l'armée pour transférer les quelque 20 000 Mauritaniens vivant dans la capitale
sénégalaise sur le site de la foire internationale et, ultérieurement, celle de
plusieurs puissances, dont la France, pour mettre en place le pont aérien
destiné à rapatrier dans son pays d'origine chacune des deux communautés.
En
dépit de plusieurs médiations multilatérales (Nations unies, Organisation de
l'unité africaine - OUA) et bilatérale (Mali), aucune solution définitive n'a pu
être trouvée.
Le gouvernement sénégalais a par ailleurs été confronté à la continuation de
l'agitation en Casamance, plus ou moins active depuis 1982, et qui se manifeste
rituellement les derniers jours du mois de décembre qui marquent la fin des
récoltes et la période d'initiation traditionnelle dans les "bois sacrés".
L'opposition politique a continué à se manifester, sans toutefois présenter un
front très uni.
Ainsi, l'alliance de trois formations autour de Me Abdoulaye
Wade a-t-elle volé en éclats quand l'une d'entre elles a ouvert des négociations
avec le pouvoir.
Un meeting unitaire de toute l'opposition qui devait couronner
une campagne réclamant le départ du président Diouf a été interdit le 3 mars
1990.
Dans l'enseignement, élèves et étudiants ont déclenché de nombreux
mouvements de grève pour protester contre le manque de moyens.
C'est dans ce
contexte que le président Abdou Diouf a procédé, le 27 mars 1990, à un profond
remaniement ministériel marqué surtout par le départ, longtemps réclamé par
l'opposition, de Jean Colin, secrétaire général de la présidence de la
République et ministre d'État.
Sans que cette mesure puisse être attribuée
uniquement à la pression de l'opposition - au sein du Parti socialiste au
pouvoir, certains la souhaitaient aussi -, il n'en reste pas moins qu'elle a
représenté un tournant majeur dans la vie politique sénégalaise.
A cette situation politique délicate s'est greffée une conjoncture économique
pour le moins difficile.
La réalisation du plan d'ajustement structurel s'est
poursuivie, avec des résultats mitigés.
Les résultats macro-économiques ont
certes été satisfaisants (augmentation du PIB en termes réels de 4,2% en
1985-1986 et 1987-1988, inflation annuelle de 2,5%, déficit du compte courant
tombé de 22% du PIB en 1983 à 10% en 1987), mais la dette sénégalaise a dû être
rééchelonnée en février 1990 par le Club de Paris.
L'aide extérieure, dans ce
contexte, reste déterminante.
Au plan religieux, l'islam sénégalais a été endeuillé par la mort du khalife
général des mourides, serigne Abdoul Ahad Mbacké ; c'est son demi-frère, serigne
Abdoul Khadre Mbacké qui lui a succédé.
Les mourides forment l'une des plus
importantes confréries islamiques du Sénégal.
Forte de plus d'un million
d'adeptes, elle joue un rôle politique et économique de premier plan..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Zimbabwé (1989-1990)
- Vanuatu (1989-1990)
- URSS (1989-1990): La tourmente
- Turquie (1989-1990): Dissensions dans la majorité parlementaire
- Turquie (1989-1990) Dissensions dans la majorité parlementaire