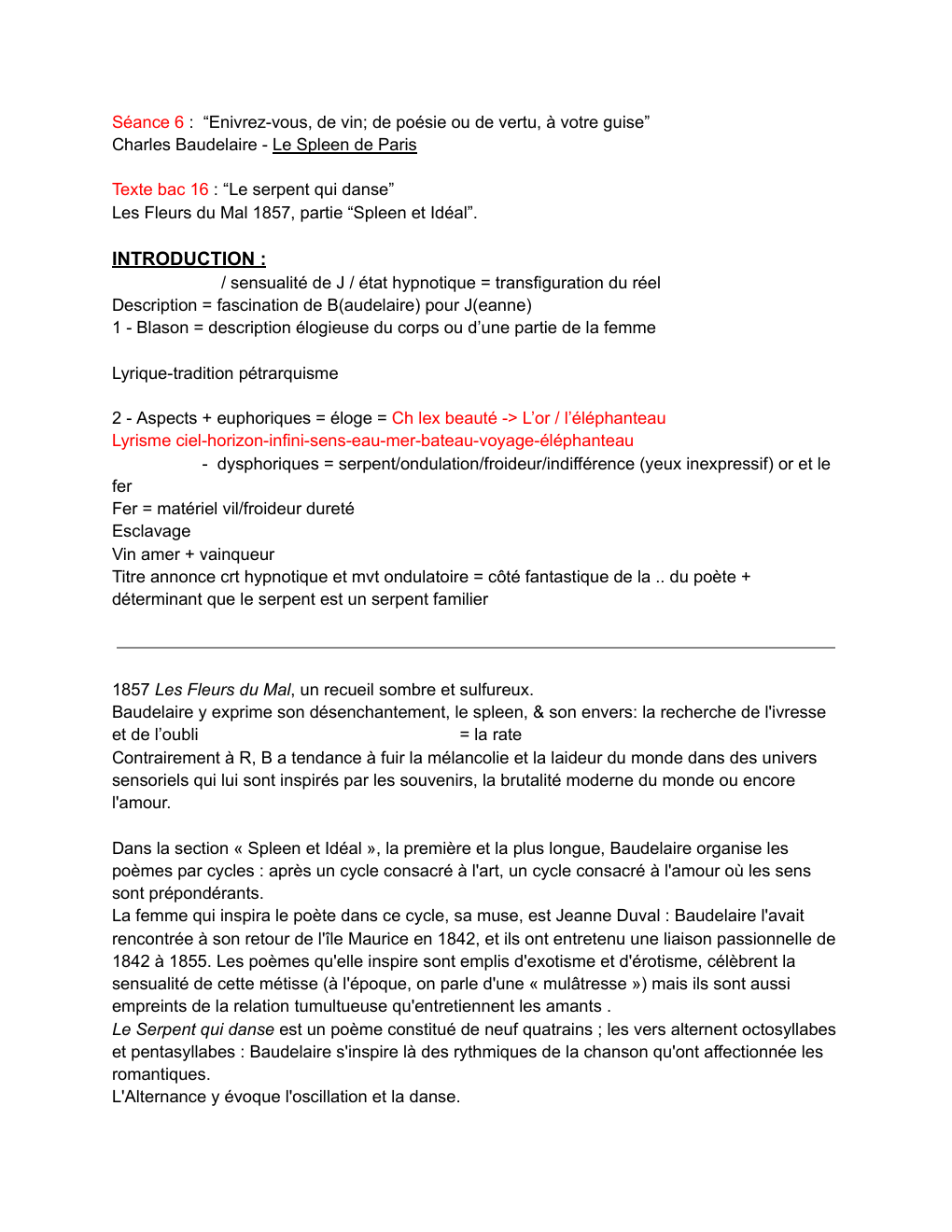Séance 6 : “Enivrez-vous, de vin; de poésie ou de vertu, à votre guise” Charles Baudelaire - Le Spleen de Paris Texte bac 16 : “Le serpent qui danse”
Publié le 09/05/2025
Extrait du document
«
Séance 6 : “Enivrez-vous, de vin; de poésie ou de vertu, à votre guise”
Charles Baudelaire - Le Spleen de Paris
Texte bac 16 : “Le serpent qui danse”
Les Fleurs du Mal 1857, partie “Spleen et Idéal”.
INTRODUCTION :
/ sensualité de J / état hypnotique = transfiguration du réel
Description = fascination de B(audelaire) pour J(eanne)
1 - Blason = description élogieuse du corps ou d’une partie de la femme
Lyrique-tradition pétrarquisme
2 - Aspects + euphoriques = éloge = Ch lex beauté -> L’or / l’éléphanteau
Lyrisme ciel-horizon-infini-sens-eau-mer-bateau-voyage-éléphanteau
- dysphoriques = serpent/ondulation/froideur/indifférence (yeux inexpressif) or et le
fer
Fer = matériel vil/froideur dureté
Esclavage
Vin amer + vainqueur
Titre annonce crt hypnotique et mvt ondulatoire = côté fantastique de la ..
du poète +
déterminant que le serpent est un serpent familier
1857 Les Fleurs du Mal, un recueil sombre et sulfureux.
Baudelaire y exprime son désenchantement, le spleen, & son envers: la recherche de l'ivresse
et de l’oubli
= la rate
Contrairement à R, B a tendance à fuir la mélancolie et la laideur du monde dans des univers
sensoriels qui lui sont inspirés par les souvenirs, la brutalité moderne du monde ou encore
l'amour.
Dans la section « Spleen et Idéal », la première et la plus longue, Baudelaire organise les
poèmes par cycles : après un cycle consacré à l'art, un cycle consacré à l'amour où les sens
sont prépondérants.
La femme qui inspira le poète dans ce cycle, sa muse, est Jeanne Duval : Baudelaire l'avait
rencontrée à son retour de l'île Maurice en 1842, et ils ont entretenu une liaison passionnelle de
1842 à 1855.
Les poèmes qu'elle inspire sont emplis d'exotisme et d'érotisme, célèbrent la
sensualité de cette métisse (à l'époque, on parle d'une « mulâtresse ») mais ils sont aussi
empreints de la relation tumultueuse qu'entretiennent les amants .
Le Serpent qui danse est un poème constitué de neuf quatrains ; les vers alternent octosyllabes
et pentasyllabes : Baudelaire s'inspire là des rythmiques de la chanson qu'ont affectionnée les
romantiques.
L'Alternance y évoque l'oscillation et la danse.
Ce poème est un blason : un poème qui célèbre la beauté et la sensualité de l'être aimé.
Mais
certains éléments rendent cet objet du désir .
PB = Comment la déclaration d'amour poétique mêle-t-elle ivresse de la contemplation et vision
inquiétante de la femme et de l'amour ?
I / V.1-12 : Ouverture lyrique sur le mode du blason
II / V.13-28 : La description de l'être désiré et de ses métamorphoses envoûtantes et
inquiétantes
III / V.29-36 : Extase finale : l'ivresse du baiser
I / Ouverture lyrique sur le mode du blason (V1-12)
BOUCLAGE : Le poème s’ouvre sur une contemplation de l’être aimé et désiré qui va exprimer
la fascination complète du poème.
Les 3 premiers Q forment 2 phrases
Q1 (vers 1-4) :1 exclamation qui exprime l’admiration du fait qu’il soit dépendant de cette
attitude/vision “que j’aime voir”.
Idée qu’une drogue le soulage
“Chère indolente” apostrophe mis en apposition / de celle à qui s’adresse l’éloge/blason
“Chère” = évoque le discours amoureux + idolâtrie
“Indolente” = celle qui adapte une nonchalance de la longueur
J = côté très cool
Qq qui sens pas la douleur, se préoccupe de rien => annonce déjà ici la froideur du serpent.
1 désordre de la phr.
COD arrive qu’au vers 4
V1 = l’excla qui est le vb conjugué + sujet
D’un seul coup au vers 2 = le compl du ,om + après au vers 3 = une comparaison + seulement
après le COD
Intérêt = désordre émotionnel et du poète, trouble du désir, sensualité.
Un tx marqué -> le
vertige
“Miroiter” = aspect de miroir brillant = une image du serpent
Il rajoute une image “étoffe” => fait penser à la soie
Idée d’une matière précieuse + d’emblée le mvt ondulatoire qui est contenu ds le ch lex du mvt
“Comme une étoffe vacillante”.
On a cette imaginaire du mvt + montre fascination du regard absorbé par un détail.
Intro l’idée
du vertige.
Q2 (vers 5-8): Deuxième phr
1er détail = la peau => évoque la mer, passe à 1 autre lieu de son corps “Aux âcres parfums”
Expression d’un soulagement à regarder J.
2ème éléments = “sur ta chevelure profonde”.
On a
d’abord “sur” cette préposition prépare la métaphore de la mer (+ compl du nom).
Un CCL
encore dans le “Aux âcres parfums”
“Mer odorante et vagabonde” : une métaphore mis en apposition encore un compl du nom
Des sonorités nasales = envoûtantes.
Sons lourds, ronds, sensuels (“on”).
Fait durer le plaisir,
désir.
Cette “chevelure profonde” => déclenche l'idée de l'océan.
Cheveux épais, long
“profonde” = profond aussi au cb de rêves, imaginaires => d’emblée être un refuge profonde =>
me toucher + vue
Compl du nom = ajoute un détail olfactive.
“Mer odorante et vagabonde” -> “odorante” = pas gênant mais “vagabonde” = hypallage, ce
serait le poète ou le bateau = vagabond
L’hypallage permet de mélanger la chevelure de J + poète
Ce prolongement, 1 compl du nom
“Bleus et bruns” => couleur des cheveux de J, couleur qui déclenche un imaginaire
Couleur de l’océan/mer.
Pluriel de flot reprends l’abondance de sa chevelure
Une masse présente, pl + mot “flots’ => mvt + épaisseur et fait correspondre la chevelure de J +
la mer.
Qqch d’une incantation dans cette description.
Il y a aussi la métamorphose de l’âme du
poète dans le Q3.
“Parfum” rime avec “bruns” = odeur capiteuse = odeur du parfum musqué rond, crée et renvoie
aux odeurs.
Q3 : V9-10 = un PSC circ de comparaison.
Encore une image qu’on identifie pas
V11-12 = Enfin la prop.circ à la fin.
Longue description -> chevelure prépare une image du
voyage par les sens/odorats, vue, toucher
La mer = évasion absolue
Son âme subit cette transformation grâce à la rêverie “âme” = pas son corps, c’est l’esprit, ce
qu”il y a de non matériel en nous.
Un mvt de détachement dans le rêve dans l’âme du poète
V9-10 => motif de la renaissance/positif avec “matin” => symbolise un renouveau
“S’éveille” + “vent” éléments vitals,dynamiques qui pousse
Comparaison en premier.
V11-12 : “appareille” = champ lex du navire + idée d’un mvt aérien avec le “vent”.
Il y a une
liberté avec un mvt ascendant.
“Rêveuse” = Une qualité de son âme (poète) + preuve avec le
pO = manière particulière de voir le monde
BOUCLAGE : On retrouve à travers J la fig de la Muse qui provoque la rêverie du poète +
l’oublie de ses souffrances dans le plaisir des sens.
Le corps de J = pas abstrait, elle dégage
une sensualité très charnelle
II / La description de l'être désiré et de ses métamorphoses envoûtantes et
inquiétantes (V13-28)
BOUCLAGE : Le poète continue à détailler le corps de J, de sa bien-aimée.
On a un va et vient
entre l’observation et passe d’un mvt large à des détails.
Ce qui continue d’évoquer
l'envoûtement.
Cet envoûtement va être assombri par des détails + inquiétants.
Q4 (vers 13-16): On continue dans l’art du blason avec les yeux.
Description des yeux mais idéalisée.
On a une nég partielle “rien ne se révèle” => le pronom + adv de la neg = au début ce
regard il y a rien dedans 1 mot mis en valeur pour le fait qu’il va recevoir des compliments
Le vide = renforcé par 2 compl du pronom
“De doux ni d’amer” => complément
Les yeux sont ridiculement vides.
Le vers impaire met en valeur …
Regard d’indifférence ou mensonge
Attribut du suj => “Sont deux bijoux froids où se mêle”
La métaphore “bijoux” = motif trad de la poésie amoureuse mais “Froids” = reprend le vers
précédent
“Bijoux” = B joue avec, il reprend l’image et vante la beauté de la F + lui accole un adj trivial qu’y
ne lui va pas du tout “froid” au sens indifférent.
Ici Jeanne ne manifeste pas de tendresse à B.
Cette froideur évoque le métal des bijoux au sens abstrait.
Puis vont apparaître 2 métaux qui
développent le double aspect de ce regard.
Une formule oxymorique, une association de chose qui s’oppose
“Or” = métal précieux, recherche, au sens trésor
Ambiguïté, son regard y tient de l’or mais aussi du fer => dureté, un métal non noble + évoque
esclavage.
B fait réf à l’âge d’or, l’âge de “fer”
Q5 : V17 => J s’anime car elle marche, il va décrire sa démarche.
Il la tutoie, l’interpelle
Réapparaît au milieu du poème, image du serpent, le titre, explique par sa démarche -> associe
à l’indolence au début, une démarche chaloupée.
V18 => joue l’expression, isolé dans un vers impair, adj + compl de l’adj qui exprime la cause =
elle ne fait pas de manière, se laisse aller => nonchalance, l’interpelle de nouveau
Il explique sa vision d’elle avec sa démarche.
Rime “cadence” avec “danse” => annonce/commence le rythme saccadé qu’on aura après.
Côté très déhanché, chaloupe de la démarche.
“Bâton” =....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ORAL DU BAC : FICHE DE SYNTHÈSE Texte n° 1 Séquence n°1 Titre : Une charogne Année : 1857 Auteur : Charles Baudelaire
- Charles Baudelaire, «Un hémisphère dans une chevelure», Petits poèmes en prose ou Le Spleen de Paris, 1869
- Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris « Un hémisphère dans une chevelure ». Commentaire
- Charles Baudelaire: Le Spleen de Paris, « À une heure du matin».
- Charles Baudelaire : Le Spleen de Paris, «À une heure du matin ».