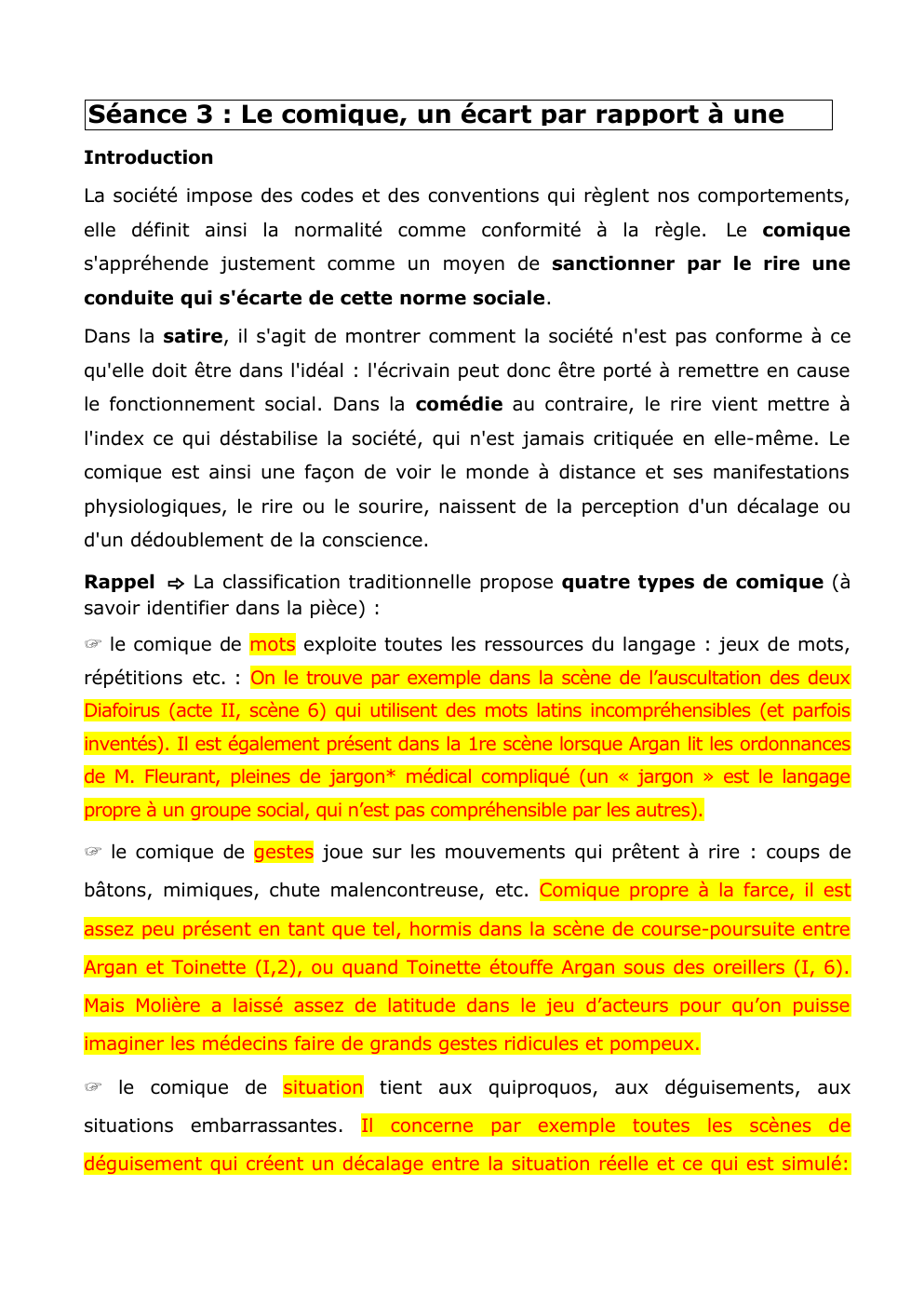Séance 3 : Le comique, un écart par rapport à une norme
Publié le 04/05/2025
Extrait du document
«
Séance 3 : Le comique, un écart par rapport à une
Introduction
La société impose des codes et des conventions qui règlent nos comportements,
elle définit ainsi la normalité comme conformité à la règle.
Le comique
s'appréhende justement comme un moyen de sanctionner par le rire une
conduite qui s'écarte de cette norme sociale.
Dans la satire, il s'agit de montrer comment la société n'est pas conforme à ce
qu'elle doit être dans l'idéal : l'écrivain peut donc être porté à remettre en cause
le fonctionnement social.
Dans la comédie au contraire, le rire vient mettre à
l'index ce qui déstabilise la société, qui n'est jamais critiquée en elle-même.
Le
comique est ainsi une façon de voir le monde à distance et ses manifestations
physiologiques, le rire ou le sourire, naissent de la perception d'un décalage ou
d'un dédoublement de la conscience.
Rappel ⇨ La classification traditionnelle propose quatre types de comique (à
savoir identifier dans la pièce) :
☞ le comique de mots exploite toutes les ressources du langage : jeux de mots,
répétitions etc.
: On le trouve par exemple dans la scène de l’auscultation des deux
Diafoirus (acte II, scène 6) qui utilisent des mots latins incompréhensibles (et parfois
inventés).
Il est également présent dans la 1re scène lorsque Argan lit les ordonnances
de M.
Fleurant, pleines de jargon* médical compliqué (un « jargon » est le langage
propre à un groupe social, qui n’est pas compréhensible par les autres).
☞ le comique de gestes joue sur les mouvements qui prêtent à rire : coups de
bâtons, mimiques, chute malencontreuse, etc.
Comique propre à la farce, il est
assez peu présent en tant que tel, hormis dans la scène de course-poursuite entre
Argan et Toinette (I,2), ou quand Toinette étouffe Argan sous des oreillers (I, 6).
Mais Molière a laissé assez de latitude dans le jeu d’acteurs pour qu’on puisse
imaginer les médecins faire de grands gestes ridicules et pompeux.
☞ le comique de situation tient aux quiproquos, aux déguisements, aux
situations embarrassantes.
Il concerne par exemple toutes les scènes de
déguisement qui créent un décalage entre la situation réelle et ce qui est simulé:
Cléante en faux maître de musique qui chante une chanson amoureuse à doublesens avec Angélique devant Argan (3, II) ; Toinette en faux médecin (8, III) ;
Argan en faux mort (III, scènes 11 à 14)…Les quiproquos appartiennent aussi au
comique de situation.
☞ le comique de caractère s'en prend aux travers et aux ridicules des individus
ou des types : l'avare, l'étourdi, la coquette etc.
De nombreuses scènes révèlent le
tempérament colérique d’Argan (qui s’énerve souvent contre Toinette, à la scène 1,
I ou contre son frère, à la scène 3, III).
Le comique de caractère est aussi utilisé
pour ridiculiser Thomas Diafoirus, qui récite bêtement un compliment appris par
cœur (scène 5, II), tant il manque d’aisance sociale (d’ailleurs, le fait qu’il se
trompe et prenne Angélique pour Béline constitue un quiproquo* (= malentendu),
propre au comique de situation).
Béline aussi est concernée puisqu’elle surjoue
l’affection avec son mari (qu’elle déteste en réalité), son hypocrisie a donc aussi un
effet comique (I, 6 et 7).
Tous les personnages sont concernés par le comique de
caractère, sauf les personnages moins excessifs (Béralde, Angélique, Cléante, qui
incarnent tous trois la raison classique).
On peut aussi apercevoir le comique de répétition dans la pièce : Il est surtout
présent dans les scènes burlesques, la fausse auscultation de Toinette (« le
poumon ! ») et dans la cérémonie finale où Argan, en « bachelier » répète en «
latin de cuisine » 4 fois les mêmes remèdes (à base de purgations…) quelle que
soit la maladie à soigner.
Mais il nous faut aller plus loin dans son étude pour aborder au mieux Le Malade
imaginaire.
I.
Le comique au théâtre : farce et comédie
a) Les origines grecques de la comédie
Née en Grèce vers le Ve siècle av.
J.-C., la comédie athénienne a une origine
religieuse et populaire.
Elle est liée aux fêtes données en l'honneur de Dionysos.
Ce sont des processions joyeuses, des danses, des mascarades.
Le cortège, le
cômos, va ensuite se fixer sur une esplanade, et devenir spectacle théâtral.
Dès l'Antiquité, comédie et tragédie sont deux genres distincts, qui s'opposent
sur plusieurs points.
La tragédie se déroule dans un passé lointain et glorieux,
met en scène des personnages royaux et/ou d'origine divine, qui font face à des
situations exceptionnelles et ont un destin hors du commun, tandis que la
comédie se déroule dans le présent du dramaturge et fait appel à des situations
stéréotypées qui vont influencer les auteurs latins.
L'intrigue traditionnelle est
une histoire de malentendus nés de la fourberie ou de l'erreur ; elle se construit
autour d'un conflit par exemple entre un homme infidèle et une femme acariâtre
ou encore entre un jeune homme et son père.
La tragédie veut susciter, selon la
formule d'Aristote, la « crainte » et la « pitié » chez le spectateur tandis que la
comédie cherche à le faire rire.
Sur quels conflits familiaux se fonde l'intrigue du Malade imaginaire ?
La pièce repose sur différents rapports de famille conflictuels : l’autorité d’un
père et les élans d’indépendance de sa fille, la relation déséquilibrée entre un
mari vieillissant et berné et sa seconde épouse cupide, les conflits entre belle-fille
et belle-mère.
b) La farce
Forme primitive et grossière de la comédie, elle devient un genre à part entière
au Moyen Âge.
Elle est ce corps étranger à la nourriture spirituelle des mystères
médiévaux, qui n'est pas forcément de bon goût, car elle est en partie liée avec
le corps, la réalité sociale et le quotidien trivial ; elle est associée au grotesque et
au bouffon.
C'est un instrument efficace de subversion contre les pouvoirs et les tabous, et
elle permet de prendre sa revanche sur les contraintes de la société : elle est
donc libératrice comme le rire qui l'accompagne.
La farce rappelle un rite d'origine païenne qui recrée un chaos éphémère ou sont
mis en scène la sauvagerie, l'inversion et l'absurde.
Occupant momentanément
l'espace
public,
c'est-a-dire
la
rue,
cette
fête
fait
participer
une
foule
d'anonymes, déguisés et masqués souvent selon des codes précis et fédérés par
une multitude d'emblèmes grotesques, a une parodie de procession.
De quelle tradition s'agit-il ? du carnaval
Relevez dans la scène 14 de l'acte III une référence à ce moment très
particulier de l'année où tout est permis, où les rôles s'inversent et où la
folie devient la norme.
En quoi cela rejoint-il l'aspect spectaculaire de la comédie-ballet ?
Représentée durant le carnaval, la pièce est placée par Béralde sous le signe de ce
moment très particulier de l'année où tout est permis, où les rôles s'inversent et
où la folie devient la norme : « Le carnaval autorise cela » (III, 14), dit-il en
parlant de la fausse cérémonie au cours de laquelle Argan est fait médecin.
Cette
dimension carnavalesque rejoint l'aspect spectaculaire de la comédie-ballet et
permet une surenchère à la fois scénique et comique : les danseurs-chanteurs du
deuxième intermède sont doublement déguisés (« Égyptiens et Égyptiennes, vêtus
en Mores ») et la cérémonie finale mobilise pas moins der quarante-six artistes
costumés autour d'Argan (didascalie de la première entrée de ballet du troisième
intermède).
Certains passages de la pièce mettent en œuvre un comique farcesque.
Relevez lesquels, et analysez les situations et thèmes propres à la farce
qu'on y retrouve.
La pièce exploite des motifs et procédés typiques de la farce.
Ainsi, le motif de la
bastonnade intervient à plusieurs reprises : dans la scène 5 de l’acte I, quand
Argan poursuit Toinette «son bâton à la main», ou encore dans le premier
intermède, quand Polichinelle est rançonné et bastonné par les Archers du Guet.
Le comique farcesque est aussi présent à travers les «gags» scatologiques (Argan
sort de scène, à deux reprises, pour se soulager, I, 3 et III, 1) et les injures,
notamment celles que profère régulièrement Argan à l’encontre de Toinette (« Ah,
chienne! ah, carogne...!» sont d’ailleurs les premiers mots qu’il lui adresse, I, 2).
c) La commedia dell'arte
C'est une forme théâtrale caractérisée par l'improvisation, qui permet de mettre
en valeur le métier des comédiens.
Apparue au XVIe siècle, c'est un théâtre
populaire où chaque acteur fait son numéro à partir d'un canevas sommaire.
Il
exécute des lazzi (plaisanteries, jeux de scène bouffons) qui servent à
caractériser son personnage.
Les personnages sont réduits à une douzaine de
types très codifiés et facilement reconnaissables, les « tipi fissi » (littéralement «
types fixes ») : couples d'amoureux, vieillards comiques, valets.
On retrouve des
constantes dans les sujets d'intrigue, tels que des amours contrariées par des
vieillards libidineux, des travestissements et des scènes de reconnaissance.
La
commedia influence profondément le théâtre de Molière.
Dans quels personnages perçoit-on l'influence des « tipi fissi » ?
Dans Le Malade imaginaire, on perçoit l’influence de la commedia dell’arte dans
le personnage de Toinette, une servante rusée qui constitue une sorte de double....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- STATISTIQUESTest de l'écart réduit1) COMPARAISON D'UNE MOYENNE A UNE NORME :X de moyenne µ et d'écart type ?X=1n? Xin i =1On compare µ à XZ=X-µsuit une loisna) N(0 ; 1) si n >= 30b) St (n - 1) si n< 30 et X normale.
- Seconde Baccalauréat professionnel métiers de la relation clients RAPPORT DE STAGE PMFP2
- Rapport sur le machine learning
- Les ENDORPHINES D'où vient la sensation de bien-être après une intense séance de sport ?
- princesse de Clèves- Séance 2 : La première apparition de Mlle de Chartres