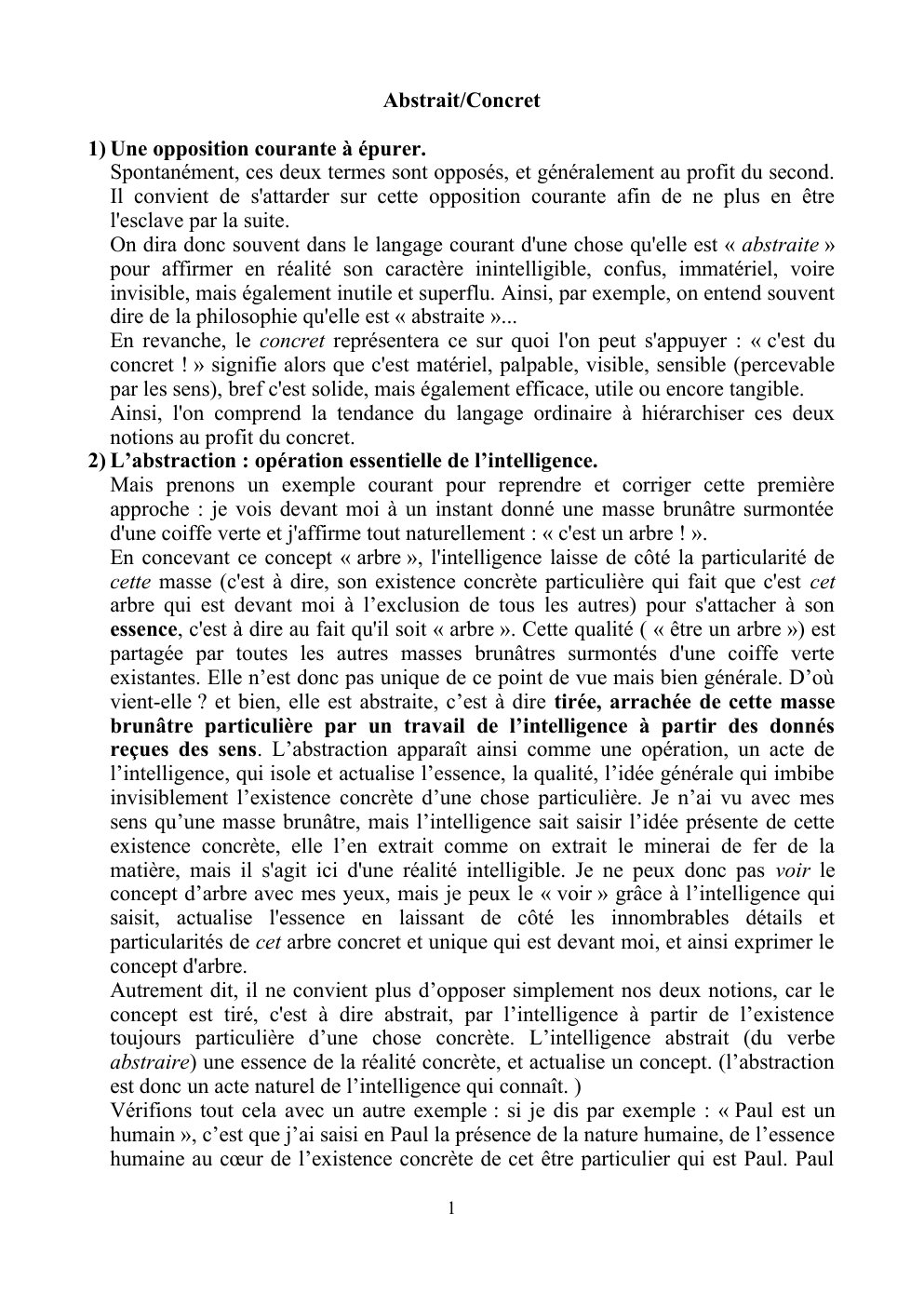Repères Philosophiques Terminale
Publié le 06/04/2025
Extrait du document
«
Abstrait/Concret
1) Une opposition courante à épurer.
Spontanément, ces deux termes sont opposés, et généralement au profit du second.
Il convient de s'attarder sur cette opposition courante afin de ne plus en être
l'esclave par la suite.
On dira donc souvent dans le langage courant d'une chose qu'elle est « abstraite »
pour affirmer en réalité son caractère inintelligible, confus, immatériel, voire
invisible, mais également inutile et superflu.
Ainsi, par exemple, on entend souvent
dire de la philosophie qu'elle est « abstraite »...
En revanche, le concret représentera ce sur quoi l'on peut s'appuyer : « c'est du
concret ! » signifie alors que c'est matériel, palpable, visible, sensible (percevable
par les sens), bref c'est solide, mais également efficace, utile ou encore tangible.
Ainsi, l'on comprend la tendance du langage ordinaire à hiérarchiser ces deux
notions au profit du concret.
2) L’abstraction : opération essentielle de l’intelligence.
Mais prenons un exemple courant pour reprendre et corriger cette première
approche : je vois devant moi à un instant donné une masse brunâtre surmontée
d'une coiffe verte et j'affirme tout naturellement : « c'est un arbre ! ».
En concevant ce concept « arbre », l'intelligence laisse de côté la particularité de
cette masse (c'est à dire, son existence concrète particulière qui fait que c'est cet
arbre qui est devant moi à l’exclusion de tous les autres) pour s'attacher à son
essence, c'est à dire au fait qu'il soit « arbre ».
Cette qualité ( « être un arbre ») est
partagée par toutes les autres masses brunâtres surmontés d'une coiffe verte
existantes.
Elle n’est donc pas unique de ce point de vue mais bien générale.
D’où
vient-elle ? et bien, elle est abstraite, c’est à dire tirée, arrachée de cette masse
brunâtre particulière par un travail de l’intelligence à partir des donnés
reçues des sens.
L’abstraction apparaît ainsi comme une opération, un acte de
l’intelligence, qui isole et actualise l’essence, la qualité, l’idée générale qui imbibe
invisiblement l’existence concrète d’une chose particulière.
Je n’ai vu avec mes
sens qu’une masse brunâtre, mais l’intelligence sait saisir l’idée présente de cette
existence concrète, elle l’en extrait comme on extrait le minerai de fer de la
matière, mais il s'agit ici d'une réalité intelligible.
Je ne peux donc pas voir le
concept d’arbre avec mes yeux, mais je peux le « voir » grâce à l’intelligence qui
saisit, actualise l'essence en laissant de côté les innombrables détails et
particularités de cet arbre concret et unique qui est devant moi, et ainsi exprimer le
concept d'arbre.
Autrement dit, il ne convient plus d’opposer simplement nos deux notions, car le
concept est tiré, c'est à dire abstrait, par l’intelligence à partir de l’existence
toujours particulière d’une chose concrète.
L’intelligence abstrait (du verbe
abstraire) une essence de la réalité concrète, et actualise un concept.
(l’abstraction
est donc un acte naturel de l’intelligence qui connaît.
)
Vérifions tout cela avec un autre exemple : si je dis par exemple : « Paul est un
humain », c’est que j’ai saisi en Paul la présence de la nature humaine, de l’essence
humaine au cœur de l’existence concrète de cet être particulier qui est Paul.
Paul
1
est unique, personne ne peut exister à sa place, en revanche l’humanité est
également présente chez Pierre et Marie.
Quand j’abstrais l'essence d’humanité et
exprime son concept, je laisse de côté les caractéristiques qui font de Paul un être
irremplaçable pour considérer ce qu’il a de commun avec Pierre et Marie.
Je n’ai
jamais serré la main de l’humanité en général et pourtant cela ne veut pas dire
qu’elle n’existe pas, elle existe réellement aux yeux de l’intelligence qui l’a
abstraite du réel concret qu'elle structure.
Ainsi, il faut distinguer deux emplois du
verbe « être » : 1°) Paul est, il existe et nul ne peut être à sa place, c’est vrai aussi
du brin d’herbe ou de l’arbre, il s’agit alors de la réalité concrète, d'une
substance particulière ; et 2°) Paul est un « humain », humain étant une qualité
réelle que Paul partage avec Pierre et Marie … qualité, essence commune à une
pluralité d'êtres que l’intelligence tire du réel grâce à une opération abstractive.
C’est ainsi que l’intelligence peut commencer sa quête de la connaissance du réel
concret qui est toujours plus riche que ce qu’elle peut en saisir.
C’est que le monde
n’est pas simplement perceptible par les sens, il est aussi compréhensible par
l’intelligence, mais la compréhension suppose toujours d’abord la perception
sensible.
Ainsi, toute l’entreprise de connaissance du réel est présente dans cette
admirable phrase d’Einstein : « le plus incompréhensible, c’est que le monde soit
compréhensible ».
3°) Plusieurs type d’abstraction.
L’intelligence peut se rapporter au monde selon plusieurs point de vue :
1°) Les sciences naturelles telles que la biologie ou la chimie étudient l’être sous le
rapport de la mobilité : l’objet des sciences physiques est corruptible, ce qui
signifie qu'il s’use (ce qui est une forme de mobilité) ; même les étoiles vieillissent.
Il s’agit alors de rechercher les causes de ce mouvement par l’observation et de
formuler des lois générales dégagées, abstraites des caractéristiques individuelles.
Par exemple, le chimiste s’intéressera aux propriétés, à la nature du soufre en
général et non simplement du morceau de soufre particulier qui est devant lui.
2°) Mais on peut abstraire davantage : ainsi, les mathématiques étudient le réel du
point de vue de la quantité, dégagée, abstraite de la matière sensible.
Par ce
surcroît d’abstraction, la connaissance gagne en exactitude : l’objet des sciences
mathématiques, le nombre, ne varie jamais.
Pour mieux comprendre, on peut dire
que l’abstraction mathématique est à l’abstraction physique ce que serait à une
audition musicale ordinaire une étude où on laisserait tomber les sons pour ne plus
retenir que le rythme, le nombre.
3°) Enfin, la métaphysique considère le réel à une autre profondeur : en tant qu’il
est, non pas en tant qu’il est telle ou telle chose, mais en tant qu’il existe.
Ainsi, la réalité concrète peut être connue sous différents rapports, en fonction de
ce que l’intelligence en abstrait.
(la mobilité, le nombre, l'existence.)
2
En acte / en puissance.
Le mot « puissance » ne doit pas être confondu avec la force ou la domination.
Pour comprendre cette distinction formalisée par Aristote, commençons donc par
prendre un exemple : lorsque vous avez commencé à apprendre à lire, vous étiez
en puissance d'être un lecteur, mais vous ne l'étiez donc pas en acte.
Vous aviez en
vous l'aptitude, la potentialité de devenir lecteur, et au fur et à mesure, par le travail
et l'apprentissage, vous avez peu à peu actualisé cette aptitude.
Ainsi, vous avez
accompli en vous, réalisé ce qui n'était en vous présent qu'en puissance.
Notez bien que le chien et le nourrisson ne savent pas lire en acte, mais le
chien, à la différence du nourrisson, n'est lecteur ni en acte, ni en puissance ! Le
nourrisson, lui, l'est en puissance et pas (encore) en acte.
Il en a fondamentalement
la capacité, et cette capacité peut ou non être actualisée.
Mais cette actualisation n'est que partielle ; votre aptitude à lire se perfectionne
au fur et à mesure que vous vous mesurez par exemple à des textes nouveaux, plus
difficiles ou plus exigeants.
C'est donc un processus inachevé.
De nouvelles
aptitudes se font jours sur la base des actualisations réalisées : pour connaître la
philosophie, par exemple, la lecture peut être utile...
Autre exemple : le développement d'une plante ou d'un embryon ; la graine
n'est pas un épi de blé en acte, mais elle a en elle réellement l'aptitude à se
développer en épis.
Elle l'est donc en puissance, et non en acte.
On le voit, ces
deux notions sont complémentaires, l'une ne peut être expliquée qu'avec l'autre.
Ajoutons enfin que tout passage de la puissance à l'acte suppose la priorité de
l'acte.
L'eau froide ne deviendra chaude en acte que sous l'effet d'une source de
chaleur en acte.
Cause / fin
3
L’intelligence humaine face à la réalité ne se satisfait pas du donné sensoriel
provenant des cinq sens, elle l'interroge, elle le crible de pourquoi, et tout enfant
témoigne déjà de ce dynamisme de l'intelligence.
Répondre à ces questions, c'est
déterminer les causes des phénomènes, or Aristote a montré que l'interrogation de
l'intelligence s'orientait selon quatre grandes visées qui révèlent autant de type de
causalité.
Il prenait l'exemple d'une statue.
1°) en quoi est cette chose ? Quelle en est la cause matérielle ? Du marbre, du
bois, de la matière vivante ...
2°) mais justement, la matière est organisée, elle n'est pas sans forme, quelle est
alors la forme de la chose considérée, qu'est-ce que c'est ? On pourrait dire que la
cause formelle de la chose correspond au plan, à l'idée qui préside à l'organisation
des éléments matériels qui font que cette chose est une statue, une maison ou un
simple bloc de marbre.
La matière n'est donc jamais sans une certaine forme.
(Rappelons que dans le cas....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Notions repères thèmes de terminale
- Correction dissertation sur le Moyen orient hggsp terminale
- regulation cortisol svt terminale
- Le Langage - Cours Complet Philosophie Terminale
- Révisions HGGSP Terminale Thème 5 L'environnement