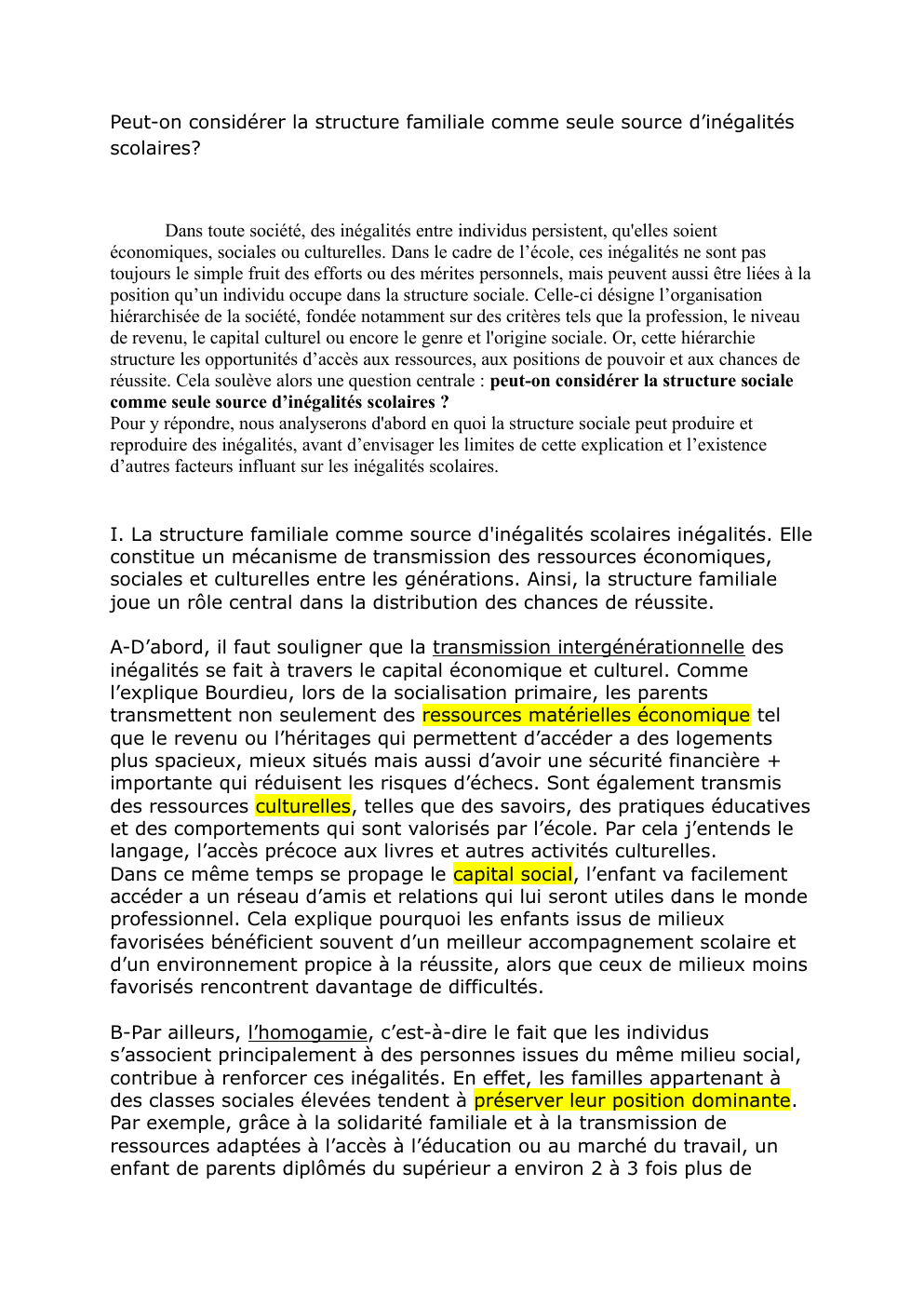Peut-on considérer la structure familiale comme seule source d'inégalités scolaires ?
Publié le 28/05/2025
Extrait du document
«
Peut-on considérer la structure familiale comme seule source d’inégalités
scolaires?
Dans toute société, des inégalités entre individus persistent, qu'elles soient
économiques, sociales ou culturelles.
Dans le cadre de l’école, ces inégalités ne sont pas
toujours le simple fruit des efforts ou des mérites personnels, mais peuvent aussi être liées à la
position qu’un individu occupe dans la structure sociale.
Celle-ci désigne l’organisation
hiérarchisée de la société, fondée notamment sur des critères tels que la profession, le niveau
de revenu, le capital culturel ou encore le genre et l'origine sociale.
Or, cette hiérarchie
structure les opportunités d’accès aux ressources, aux positions de pouvoir et aux chances de
réussite.
Cela soulève alors une question centrale : peut-on considérer la structure sociale
comme seule source d’inégalités scolaires ?
Pour y répondre, nous analyserons d'abord en quoi la structure sociale peut produire et
reproduire des inégalités, avant d’envisager les limites de cette explication et l’existence
d’autres facteurs influant sur les inégalités scolaires.
I.
La structure familiale comme source d'inégalités scolaires inégalités.
Elle
constitue un mécanisme de transmission des ressources économiques,
sociales et culturelles entre les générations.
Ainsi, la structure familiale
joue un rôle central dans la distribution des chances de réussite.
A-D’abord, il faut souligner que la transmission intergénérationnelle des
inégalités se fait à travers le capital économique et culturel.
Comme
l’explique Bourdieu, lors de la socialisation primaire, les parents
transmettent non seulement des ressources matérielles économique tel
que le revenu ou l’héritages qui permettent d’accéder a des logements
plus spacieux, mieux situés mais aussi d’avoir une sécurité financière +
importante qui réduisent les risques d’échecs.
Sont également transmis
des ressources culturelles, telles que des savoirs, des pratiques éducatives
et des comportements qui sont valorisés par l’école.
Par cela j’entends le
langage, l’accès précoce aux livres et autres activités culturelles.
Dans ce même temps se propage le capital social, l’enfant va facilement
accéder a un réseau d’amis et relations qui lui seront utiles dans le monde
professionnel.
Cela explique pourquoi les enfants issus de milieux
favorisées bénéficient souvent d’un meilleur accompagnement scolaire et
d’un environnement propice à la réussite, alors que ceux de milieux moins
favorisés rencontrent davantage de difficultés.
B-Par ailleurs, l’homogamie, c’est-à-dire le fait que les individus
s’associent principalement à des personnes issues du même milieu social,
contribue à renforcer ces inégalités.
En effet, les familles appartenant à
des classes sociales élevées tendent à préserver leur position dominante.
Par exemple, grâce à la solidarité familiale et à la transmission de
ressources adaptées à l’accès à l’éducation ou au marché du travail, un
enfant de parents diplômés du supérieur a environ 2 à 3 fois plus de
chances d’obtenir lui-même un diplôme du supérieur qu’un enfant
d’ouvriers..
Ce phénomène limite la mobilité sociale et rend plus difficile
l’ascension pour les enfants issus de milieux modestes.
C-Enfin, le soutien scolaire varie selon la configuration familiale.
Dans les
familles nombreuses, une forme de solidarité peut s’installer entre frères
et sœurs, les aînés aidant souvent les plus jeunes dans leurs devoirs.
À
l’inverse, dans les familles monoparentales, le parent – généralement la
mère – dispose de moins de temps et de ressources pour accompagner
ses enfants dans leur scolarité.
Ces familles, plus exposées à la précarité,
font face à une surcharge mentale et matérielle qui nuit à l’investissement
scolaire.
D’autre part, la vie familiale reproduit aussi des inégalités de genre : dans
de nombreux foyers, les filles restent plus souvent sollicitées pour les
tâches domestiques ou la garde des enfants, ce qui peut affecter leur
temps de travail scolaire.
Ces éléments montrent que les conditions matérielles, affectives et
organisationnelles liées à la structure familiale influencent les parcours
scolaires, même si elles ne déterminent pas à elles seules la réussite ou
l’échec.
Par ailleurs, les attentes éducatives varient selon le milieu social.
Dans les
milieux favorisés, les filières longues et générales sont valorisées, tandis
que les familles populaires, marquées par une crainte de l’échec scolaire,
privilégient souvent des parcours courts et professionnalisants.
Ces
stratégies d’orientation différenciées peuvent aussi être comprises à
travers les travaux de Raymond Boudon qui met l’accent sur les choix
rationnels des familles en fonction de leur position sociale.
Selon lui, les
familles populaires préfèrent les filières courtes par souci de sécurité
scolaire ou économique, ce qu’il appelle les inégalités secondaires.
En somme, la structure familiale, à travers la transmission des
ressources, l’homogamie, l’influence de l’origine sociale, les
pratiques éducatives et la répartition des rôles, constitue bien une
source majeure d’inégalités sociales.
Mais d’autres facteurs
permettent d’expliquer les inégalités scolaires…
II.
La structure familiale n’explique pas à elle seule les inégalités sociales
A.
L’école, un facteur autonome de reproduction des inégalités
Si la famille joue un rôle dans la réussite scolaire, l’école elle-même peut
être un acteur de reproduction des inégalités.
Loin de la neutralité qu’elle
revendique, elle valorise des compétences issues des classes favorisées,
comme l’aisance à l’oral ou la familiarité avec le langage académique.
Ces
exigences implicites constituent ce que l’on appelle un curriculum caché,
qui avantage les élèves socialement dotés.
Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron ont ainsi parlé de violence
symbolique : l’école impose des normes culturelles spécifiques en les
présentant comme universelles.
Ce processus se retrouve dans
l’évaluation scolaire, souvent biaisée culturellement, et dans l’orientation,
où les élèves des classes populaires, même performants, sont plus
souvent dirigés vers les filières courtes du fait de préjugés ou de faibles
attentes de la part des enseignants.
En ce....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Quels sont les conséquences sociales des inégalités scolaires
- [Ne pas prendre pour naturelles des inégalités sociales] Jean-Jacques ROUSSEAU
- Thomas S. Kuhn : La Structure des révolutions scientifiques (résumé et analyse)
- L’augmentation des facteurs de production, travail et capital, est-elle la seule source de la croissance économique ?
- Après avoir rappelé l’intérêt des Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS) pour rendre compte des inégalités économiques et sociales, vous montrerez les limites de cet instrument pour l’étude des inégalités.