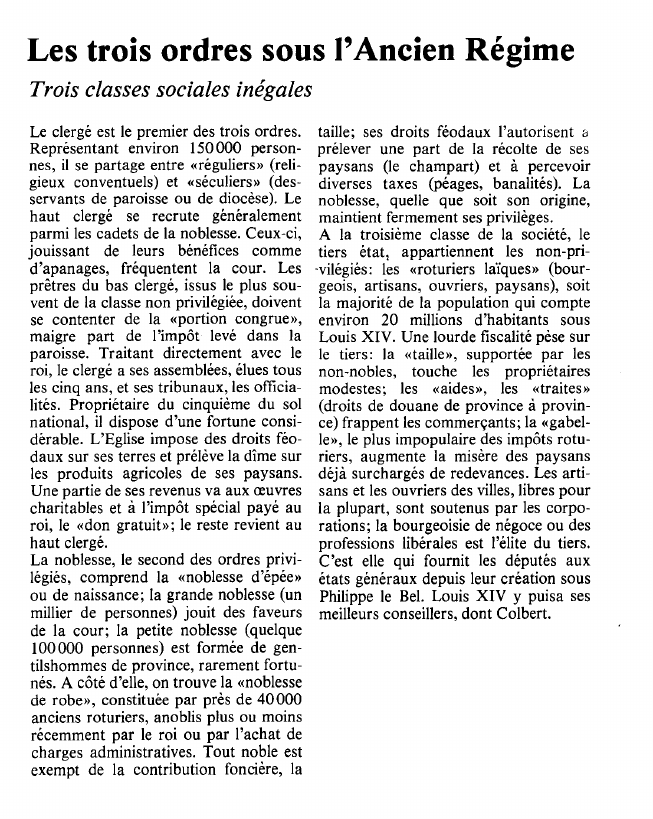Les trois ordres sous l'Ancien RégimeTrois classes sociales inégales.
Publié le 17/05/2020

Extrait du document
«
1 / 2 Les trois ordres sous l'Ancien Régime
Trois classes sociales inégales
Le clergé est le premier des trois ordres.
Représentant environ 150 000 person
nes, il se partage entre «réguliers» (reli
gieux conventuels) et ((séculiers» (des
servants
de paroisse ou de diocèse).
Le haut clergé se recrute généralement
parmi les cadets de la noblesse.
Ceux-ci,
jouissant de leurs bénéfices comme
d'apanages, fréquentent la cour.
Les
prêtres du bas clergé, issus
le plus sou
vent de la classe non privilégiée, doivent se contenter de la ((portion congrue», maigre part de l'impôt levé dans la
paroisse.
Traitant directement avec le roi, le clergé a ses assemblées, élues tous
les cinq ans, et ses tribunaux, les officia
lités.
Propriétaire du cinquième du sol
national,
il dispose d'une fortune consi
dérable.
L'Eglise impose des droits féo daux sur ses terres et prélève la dîme sur les produits agricoles de ses paysans.
Une partie de ses revenus va aux œuvres
charitables et à l'impôt spécial payé au
roi,
le ((don gratuit»; le reste revient au
haut clergé.
La noblesse,
le second des ordres privi
légiés, comprend la (moblesse d'épée» ou de naissance; la grande noblesse (un
millier de personnes) jouit des faveurs de la cour; la petite noblesse (quelque 100000 personnes) est formée de gen
tilshommes de province, rarement fortu
nés.
A côté d'elle, on trouve la (moblesse de robe», constituée par près de 40000 anciens roturiers, anoblis plus ou moins
récemment par le roi ou par l'achat de charges administratives.
Tout noble est
exempt de la contribution foncière, la taille;
ses droits féodaux l'autorisent
" prélever une part de la récolte de ses
paysans (le champart) et à percevoir
diverses taxes (péages, banalités).
La
noblesse, quelle que soit son origine,
maintient fermement ses privilèges.
A la troisième classe
de la société, le tiers état, appartiennent les non-pri·vilégiés: les ((roturiers laïques» (bour
geois, artisans, ouvriers, paysans), soit
la majorité
de la population qui compte
environ 20 millions d'habitants sous
Louis XIV.
Une lourde fiscalité pèse sur le tiers: la ((taille», supportée par les
non-nobles, touche les propriétaires
modestes; les ((aides», les (draites» (droits de douane de province à provin
ce) frappent les commerçants; la ((gabel le», le plus impopulaire des impôts rotu
riers, augmente la misère des paysans
déjà surchargés
de redevances.
Les arti
sans et les ouvriers des villes, libres pour
la plupart, sont soutenus par les corpo
rations; la bourgeoisie
de négoce ou des
professions libérales est l'élite du tiers.
C'est
elle qui fournit les députés aux
états généraux depuis leur création sous
Philippe
le Bel.
Louis XIV y puisa ses
meilleurs conseillers, dont Colbert.
2 / 2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les trois ordres sous l'Ancien Régime:Trois classes sociales inégales.
- dans quelle mesure les classes sociales sont-elles un outil pertinent dans l’analyse de la société ? dissertation
- Les classes sociales dans le Guépard de Lampedusa.
- Pourquoi les frontières entres les classes sociales ont elles tendance a se brouiller ?
- STRATIFICATION SOCIALE, CLASSES SOCIALES