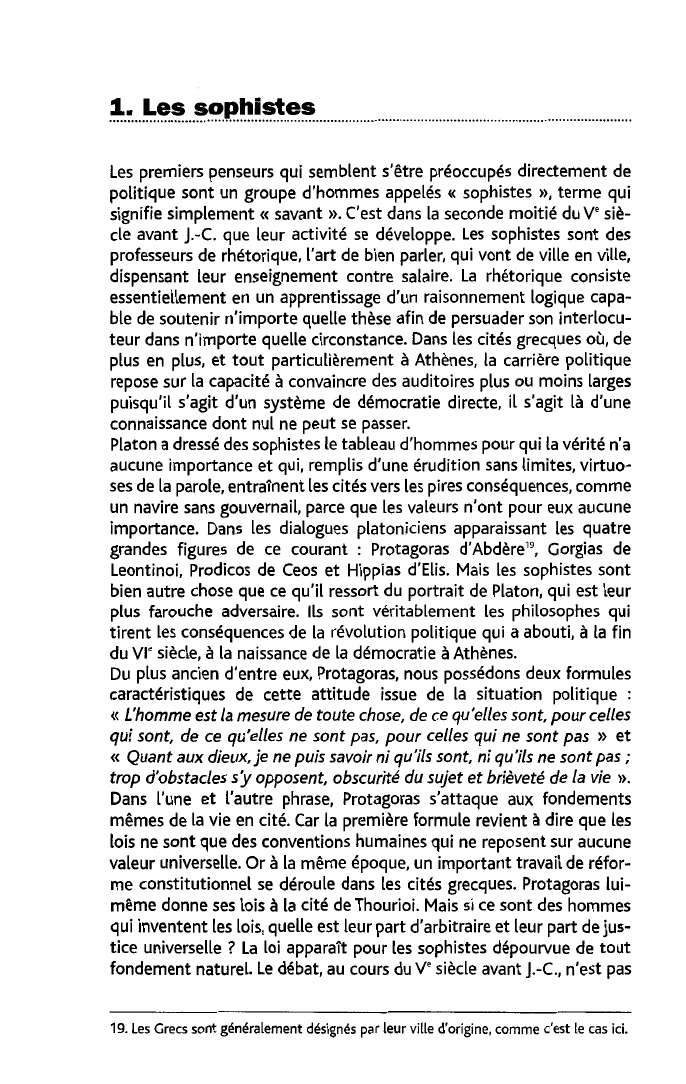Les sophistes
Publié le 16/05/2020

Extrait du document
«
-~-~---~~~---~~.P.~~~~~~ ........................................................................
..............
.
Les premiers penseurs qui semblent s'être préoccupés directement de
politique sont un groupe d'hommes appelés « sophistes », terme qui
signifie simplement« savant ».C'est dans la seconde moitié du v· siè
cle avant J.-C.
que leur activité se développe.
Les sophistes sont des
professeurs
de rhétorique, l'art de bien parler, qui vont de ville en ville,
dispensant leur enseignement contre salaire.
La rhétorique consiste
essentiellement
en un apprentissage d'un raisonnement logique capa
ble de soutenir n'importe quelle thèse afin de persuader son interlocu
teur dans n'importe quelle circonstance.
Dans les cités grecques où, de
plus en plus, et tout particulièrement à Athènes, la carrière politique
repose sur
la capacité à convaincre des auditoires plus ou moins larges
puisqu'il s'agit d'un système de démocratie directe, il s'agit là d'une
connaissance dont
nul ne peut se passer.
Platon a dressé des sophistes le tableau d'hommes pour qui la vérité n'a
aucune importance et
qui, remplis d'une érudition sans limites, virtuo
ses
de la parole, entraînent les cités vers les pires conséquences, comme
un navire sans gouvernail, parce que les valeurs n'ont pour eux aucune
importance.
Dans les dialogues platoniciens apparaissant les quatre
grandes
figures de ce courant : Protagoras d'Abdère 19
, Gorgias de
Leontinoi, Prodicos de Ceos et Hippias d'Elis.
Mais les sophistes sont
bien autre chose que ce qu'il ressort du portrait de Platon, qui est leur
plus farouche adversaire.
Ils sont véritablement les philosophes qui
tirent les conséquences de la révolution politique qui a abouti, à la fin
du VI° siècle, à la naissance de la démocratie à Athènes.
Du plus ancien d'entre eux, Protagoras, nous possédons deux formules
caractéristiques
de cette attitude issue de la situation politique :
« l'homme est la mesure de toute chose, de ce qu'elles sont, pour celles
qui sont, de ce qu'elles ne sont pas, pour celles qui ne sont pas » et
« Quant aux dieux, je ne puis savoir ni qu'ils sont, ni qu'ils ne sont pas;
trop d'obstacles sy opposent, obscurité du sujet et brièveté de la vie ».
Dans l'une et l'autre phrase, Protagoras s'attaque aux fondements
mêmes
de la vie en cité.
Car la première formule revient à dire que les
lois ne sont que des conventions humaines qui ne reposent sur aucune
valeur
universelle.
Or à la même époque, un important travail de réfor
me constitutionnel se déroule dans les cités grecques.
Protagoras lui
même donne ses lois à la cité de Thourioi.
Mais si ce sont des hommes
qui inventent les lois, quelle est leur part d'arbitraire et leur part de jus
tice
universelle ? La loi apparaît pour les sophistes dépourvue de tout
fondement naturel.
Le débat, au cours du v· siècle avant J.-C., n'est pas
19.
Les Grecs sont généralement désignés par leur ville d'origine, comme c'est le cas ici.
-46 -.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓