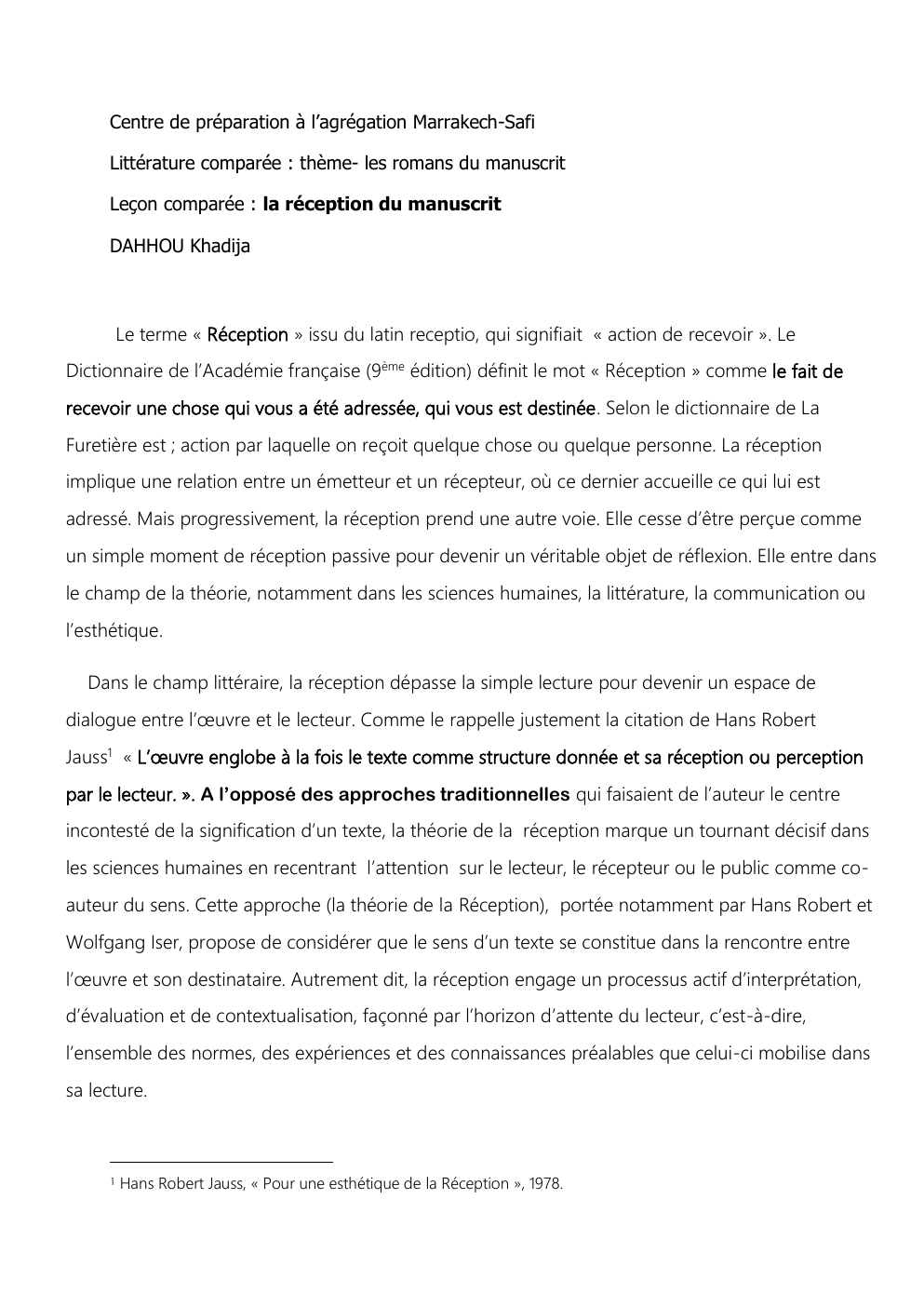Leçon comparée : la réception du manuscrit
Publié le 30/06/2025
Extrait du document
«
Centre de préparation à l’agrégation Marrakech-Safi
Littérature comparée : thème- les romans du manuscrit
Leçon comparée : la réception du manuscrit
DAHHOU Khadija
Le terme « Réception » issu du latin receptio, qui signifiait « action de recevoir ».
Le
Dictionnaire de l’Académie française (9ème édition) définit le mot « Réception » comme le fait de
recevoir une chose qui vous a été adressée, qui vous est destinée.
Selon le dictionnaire de La
Furetière est ; action par laquelle on reçoit quelque chose ou quelque personne.
La réception
implique une relation entre un émetteur et un récepteur, où ce dernier accueille ce qui lui est
adressé.
Mais progressivement, la réception prend une autre voie.
Elle cesse d’être perçue comme
un simple moment de réception passive pour devenir un véritable objet de réflexion.
Elle entre dans
le champ de la théorie, notamment dans les sciences humaines, la littérature, la communication ou
l’esthétique.
Dans le champ littéraire, la réception dépasse la simple lecture pour devenir un espace de
dialogue entre l’œuvre et le lecteur.
Comme le rappelle justement la citation de Hans Robert
Jauss1 « L’œuvre englobe à la fois le texte comme structure donnée et sa réception ou perception
par le lecteur.
».
A l’opposé des approches traditionnelles qui faisaient de l’auteur le centre
incontesté de la signification d’un texte, la théorie de la réception marque un tournant décisif dans
les sciences humaines en recentrant l’attention sur le lecteur, le récepteur ou le public comme coauteur du sens.
Cette approche (la théorie de la Réception), portée notamment par Hans Robert et
Wolfgang Iser, propose de considérer que le sens d’un texte se constitue dans la rencontre entre
l’œuvre et son destinataire.
Autrement dit, la réception engage un processus actif d’interprétation,
d’évaluation et de contextualisation, façonné par l’horizon d’attente du lecteur, c’est-à-dire,
l’ensemble des normes, des expériences et des connaissances préalables que celui-ci mobilise dans
sa lecture.
1
Hans Robert Jauss, « Pour une esthétique de la Réception », 1978.
Dans Samarcande d’Amin Maalouf, Beatus Ille d’Antonio Muñoz Molina, et Le Messie de
Stockholm de Cynthia Ozick, le manuscrit occupe une place centrale, non seulement comme
élément de l’intrigue, mais surtout comme catalyseur d’une réflexion plus profonde.
La réception du
manuscrit, entendue ici comme l'ensemble des réactions — affectives, intellectuelles, idéologiques
— suscitées par la confrontation à un texte original, souvent ancien ou mythifié, devient alors un
révélateur des enjeux littéraires eux-mêmes.
Recevoir un manuscrit, dans ces récits, ce n’est pas
juste accéder à un contenu : c’est être transformé par ce contenu, voire mis à l’épreuve par lui.
C’est
aussi, souvent, douter de son authenticité, de sa provenance, de son message.
Ainsi, la réception
devient une expérience littéraire à part entière, mêlant espoir, frustration, fascination, parfois
manipulation.
La lecture devient alors une mise en abyme de la lecture littéraire elle-même : chaque
personnage qui lit ou cherche à lire le manuscrit se retrouve à inventer une partie de ce qu’il lit, à y
projeter ses désirs, à chercher une vérité qui lui échappe.
Dès lors, la réception du manuscrit dans ces trois romans dépasse l’intrigue : elle devient un
miroir de l’acte de lire, un commentaire sur le lien intime et parfois dangereux que le lecteur
entretient avec le texte.
Cela fait de ces œuvres non seulement des romans d’enquête ou de quête,
mais aussi des fictions réflexives, où la littérature parle de la littérature, et où la réception d’un texte
fictif interroge notre propre rapport aux livres et aux histoires.
Nous poserons donc la problématique suivante : en quoi la mise en scène de la réception du
manuscrit dans ces trois romans révèle-t-elle une réflexion sur la littérature elle-même, et sur la
manière dont un texte est lu, interprété, voire investi d’un pouvoir quasi sacré ?
Pour répondre à cette interrogation, nous analyserons d’abord le cadre de la réception, en
étudiant les contextes dans lesquels les manuscrits apparaissent et circulent ; nous verrons ensuite
le processus de lecture à travers les regards des personnages-lecteurs qui s’en emparent ; enfin,
nous montrerons comment la réception du manuscrit devient une métaphore puissante de la
littérature, de son pouvoir de transformation, mais aussi de ses limites.
I.
Le cadre de la réception
1.
Une réception ancrée dans un contexte historico-politique
Dans chacun des trois romans étudiés Samarcande d’Amin Maalouf, Le Messie de Stockholm
de Cynthia Ozick et Beatus Ille d’Antonio Molina, la réception du manuscrit est indissociable d’un
contexte historique ou politique spécifique, qui oriente la lecture, la conditionne ou la perturbe.
Le
manuscrit ne se limite pas à un objet littéraire, il devient le support vivant d’une mémoire brisée et
menacée.
En ce sens, l’esthétique de la réception s’enracine dans une dynamique mémorielle.
Dans Samarcande, le manuscrit des robaiyat d’Omar Khayyam traverse une longue chaîne de
bouleversements politiques et culturels.
Depuis le XIème siècle jusqu’au naufrage du Titanic.
Chaque étape de transmission est marquée par la violence de l’histoire, les invasions mongoles, la
secte des assassins, les guerres.
« La guerre avait été déclarée à midi.
Retraite, débâcle, invasion
famine, commune, massacres… »P.165.
Ce manuscrit résiste à l’effacement, il circule
clandestinement, caché dans les murs, transmis par la mémoire orale, récité ou traduit.
Dans Beatus Ille, l’ancrage historique est plus direct encore : l’Espagne franquiste, ou le
régime a effacé la mémoire des intellectuels républicains.
Le manuscrit de Jacinto Solana, poète
engagé, agit comme une archive clandestine.
Lorsque Minaya le découvre, il n’y voit pas qu’une
œuvre littéraire, mais un document politique.
La réception du manuscrit devient un acte critique et
réparateur qui relie la lecture à la justice mémorielle.
Dans Le Messie de Stockholm, le contexte historique est celui de l’après-shoah.
Le manuscrit
attribué à Bruno Schulz-probablement faux-est perçu comme la dernière trace d’un monde détruit.
Pour Lars, l’objet manuscrit devient un substitut d’identité, une filiation fictive, mais nécessaire.
Ici, la
réception est une manière de faire revivre une mémoire interdite, c’est refuser la disparition totale.
Même si le manuscrit est douteux.
Son effet est réel, il mobilise la mémoire, l’histoire, et projette
une appartenance.
Ainsi, dans ces trois romans, la réception du manuscrit est inséparable de son contexte :
guerre, persécution, censure, exil.
Le manuscrit est une mémoire vivante, une preuve, une voix qui
se faire un chemin dans l’Histoire.
Pourtant, au-delà du cadre historique qui oriente la réception, le
manuscrit devient une quête intime, parfois obsessionnelle.
2.
De la quête à la réception
La réception du manuscrit ne se réduit pas à sa simple possession ou à sa lecture immédiate,
dans les trois romans, la réception est souvent précédé par une quête, un cheminement
personnel, intellectuel, voire initiatique.
Chez certains personnages, le manuscrit est activement
recherché parfois aux prix d’un engagement existentiel profond, tandis que chez d’autres, il est
reçu sans préparation, comme un legs mystérieux ou accidentel.
Dans Samarcande, la quête la plus structurée est celle d’Omar Lesage au XXème
siècle.
« Moi l’étranger d’Amérique…qui avait fait le trajet de Paris à Constantinople de train à
travers trois empires, pour m’enquérir d’un manuscrit, d’un vieux livre de poésie, dérisoire fétu de
papier dans l’Orient des tumultes.
»P.181.Obnubilé par l’existence du manuscrit des robaiyat, il
entame une enquête complexe, marquée par des déplacements géographiques (de l’Europe à la
Perse), des rencontres (Rochefort, Djamaleddine, Mirza Reza, puis Chirine) et une succession
d’obstacles.
Ce parcours n’est simplement intellectuel, il est existentiel.
Le manuscrit est un objet
obsessionnel qui guide ses choix, sa vie sentimentale (notamment avec Chirine), et même son
identité : il porte le nom d’Omar, en hommage au poète.
Sa quête atteint une dimension
spirituelle.
A l’inverse, des personnages comme Vartan l’arménien, ou le Rédempteur, ne
cherchent pas le manuscrit, ils le reçoivent, mais l’intègre dans leur propre projet idéologique ou
religieux.
Dans Le Messie de Stockholm , la quête est totalement incarnée par Lars, personnage
littéralement obsédé par le manuscrit supposé de Bruno Schulz.
« Je ne puis vous dire combien de
fois j’ai lu l’autre.
Mais en traduction.
C’est mon père j’ai besoin de lire l’original.
» P.48.
Il ne
cherche pas seulement un texte : il cherche un père, une origine, une légitimité intellectuelle et
identitaire.
Lorsque le manuscrit reçu, par l’intermédiaire d’Adela, Lars le considère comme la
confirmation matérielle d’un mythe personnel.
En revanche, Adela, qui transmet le manuscrit, ne
l’a pas vraiment cherché, elle le détient comme un héritage trouble, une possible supercherie.
Sa
réception est passive.
Ainsi, la quête précède et fonde la réception.
Dans Beatus Ille, Minaya lui aussi commence par une quête intellectuelle, d’abord
innocente : il veut écrire une thèse sur Jacinto Solana.
Mais très vite, cette enquête devient une
obsession.
Toutefois, Inès qui transmet le manuscrit n’a jamais cherché à le comprendre ou à
l’étudier.
La réception est ici double ; passive chez le détenteur, active chez le chercheur.
Dans les trois romans, la réception du manuscrit est précédée pour certains personnages, d’une
quête longue, intime, souvent douloureuse.
Le manuscrit, dans ces cas-là, ne trouve sa place qu’au
terme d’in désir patiemment construit, et c’est précisément cette attente, cette....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- devoir 2 français cned La Leçon, d’Eugène Ionesco
- L'art et la technique leçon+exercice philosophie
- Leçon n°5: Le travail et la technique nous aliènent-ils ?
- leçon liberté conscience: Faire son devoir, est-ce renoncer à sa liberté ?
- « Il y a longtemps que les fables n'existent plus pour leur moralité. N'importe quel gamin vous le dira : le plaisir, c'est l'histoire, et peu importe la leçon ! ». Que pensez-vous de cette réflexion parue dans un journal à l'occasion du spectacle de l'acteur Fabrice Luchini consacré aux Fables de La Fontaine ?