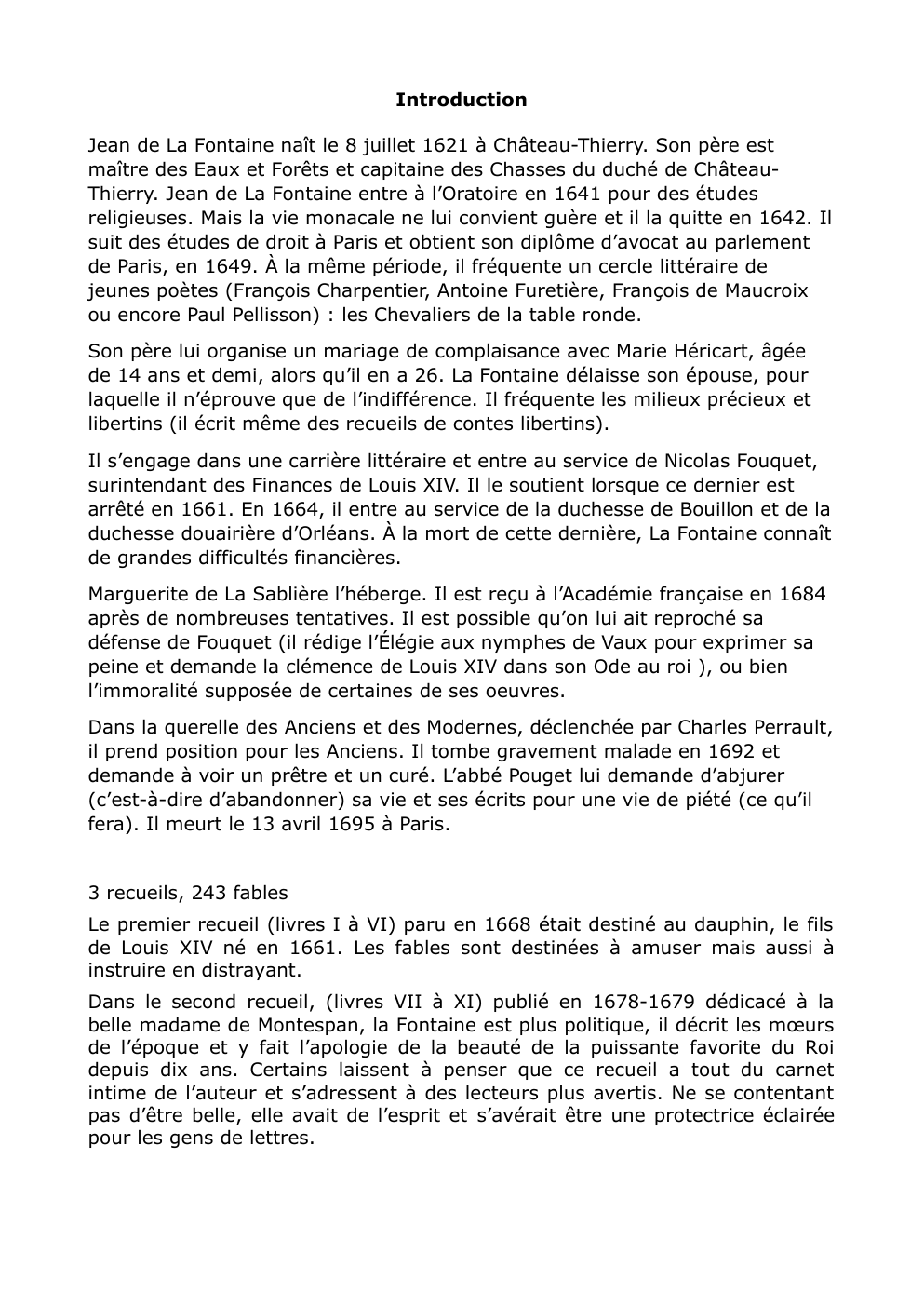le gland et la citrouille - jean de la Fontaine
Publié le 25/04/2025
Extrait du document
«
Introduction
Jean de La Fontaine naît le 8 juillet 1621 à Château-Thierry.
Son père est
maître des Eaux et Forêts et capitaine des Chasses du duché de ChâteauThierry.
Jean de La Fontaine entre à l’Oratoire en 1641 pour des études
religieuses.
Mais la vie monacale ne lui convient guère et il la quitte en 1642.
Il
suit des études de droit à Paris et obtient son diplôme d’avocat au parlement
de Paris, en 1649.
À la même période, il fréquente un cercle littéraire de
jeunes poètes (François Charpentier, Antoine Furetière, François de Maucroix
ou encore Paul Pellisson) : les Chevaliers de la table ronde.
Son père lui organise un mariage de complaisance avec Marie Héricart, âgée
de 14 ans et demi, alors qu’il en a 26.
La Fontaine délaisse son épouse, pour
laquelle il n’éprouve que de l’indifférence.
Il fréquente les milieux précieux et
libertins (il écrit même des recueils de contes libertins).
Il s’engage dans une carrière littéraire et entre au service de Nicolas Fouquet,
surintendant des Finances de Louis XIV.
Il le soutient lorsque ce dernier est
arrêté en 1661.
En 1664, il entre au service de la duchesse de Bouillon et de la
duchesse douairière d’Orléans.
À la mort de cette dernière, La Fontaine connaît
de grandes difficultés financières.
Marguerite de La Sablière l’héberge.
Il est reçu à l’Académie française en 1684
après de nombreuses tentatives.
Il est possible qu’on lui ait reproché sa
défense de Fouquet (il rédige l’Élégie aux nymphes de Vaux pour exprimer sa
peine et demande la clémence de Louis XIV dans son Ode au roi ), ou bien
l’immoralité supposée de certaines de ses oeuvres.
Dans la querelle des Anciens et des Modernes, déclenchée par Charles Perrault,
il prend position pour les Anciens.
Il tombe gravement malade en 1692 et
demande à voir un prêtre et un curé.
L’abbé Pouget lui demande d’abjurer
(c’est-à-dire d’abandonner) sa vie et ses écrits pour une vie de piété (ce qu’il
fera).
Il meurt le 13 avril 1695 à Paris.
3 recueils, 243 fables
Le premier recueil (livres I à VI) paru en 1668 était destiné au dauphin, le fils
de Louis XIV né en 1661.
Les fables sont destinées à amuser mais aussi à
instruire en distrayant.
Dans le second recueil, (livres VII à XI) publié en 1678-1679 dédicacé à la
belle madame de Montespan, la Fontaine est plus politique, il décrit les mœurs
de l’époque et y fait l’apologie de la beauté de la puissante favorite du Roi
depuis dix ans.
Certains laissent à penser que ce recueil a tout du carnet
intime de l’auteur et s’adressent à des lecteurs plus avertis.
Ne se contentant
pas d’être belle, elle avait de l’esprit et s’avérait être une protectrice éclairée
pour les gens de lettres.
Le Gland et la citrouille fait partie du livre IX du recueil, édité pour la reùière
fois en 1678 c’est la 4ème fable et elle est écrite sous forme de farce.
(*)
L’auteur remet en cause Dieu à partir d’un gland et d’une citrouille.
On peut
donc dire que ce poème appartient au comique burlesque.
Résumé : un fermier se plaint que les glands ne sont pas aussi gros que les
citrouilles.
Quand il s’assoupit au pied d’un arbre, un gland tombe et le blesse
au nez.
Il se dit que la nature est bien faite et qu’il est finalement préférable
que le gland ne soit pas aussi lourd qu’une citrouille.
(mesfiches de français)
Un paysan nommé Mathieu Gareau, est un personnage du Pédant joué de
Cyrano de Bergerac
→ Lecture du texte
Nous pouvons donc nous demander dans quelle mesure cette fable dépasse sa
morale initiale, par son allure théâtrale et comique en faisant plaisamment la
satire d’un personnage prétentieux.
Pour répondre à cette problématique nous verrons dans un premier temps la
moralité initiale (début-V3) puis la remise en cause de l’ordre divin ( V4-19)
ensuite nous continuerons par l’expérience de la réalité (V19-25) , et enfin
nous terminerons par le retour à la raison( V26- la fin).
Analyse
MVT 1 : Moralité initiale
V1 2 verbes faire au présent de vérité générale.
Simplicité du verbe faire,
louange à Dieu.
Premier hémistiche.
Affirmation claire et nette.
V2 et 3 Enjambement, négation d'action, négation avec « sans ».
Antithèse.
« Chercher » + « treuve »
V3 Complément circonstanciel de lieu.
Simplicité de l'exemple comique
absurde.
rappelle le titre.
MVT 2 : remise en cause de l’ordre divin
V 4.
Déterminant indéfini.
Entrée dans le récit du perso.
Connotation rurale
Fait référence au registre de la farce, préparation de la suite.
V 5.
« Gros » / « menue ».
Antithèse.
Remarque déséquilibrée concernant le
travail Divin.
V....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le Gland et la citrouille - La Fontaine (Fiche de révision - Bac Français)
- Jean de LA FONTAINE (1621-1695) (Recueil : Les Fables) - Le Berger et son troupeau
- JEAN DE LA FONTAINE
- Jean de La Fontaine: fable 12 du livre X des Fables : « La Lionne et l'Ourse »
- Les deux amis est la 11ème fable du livre 8 de Jean de la Fontaine