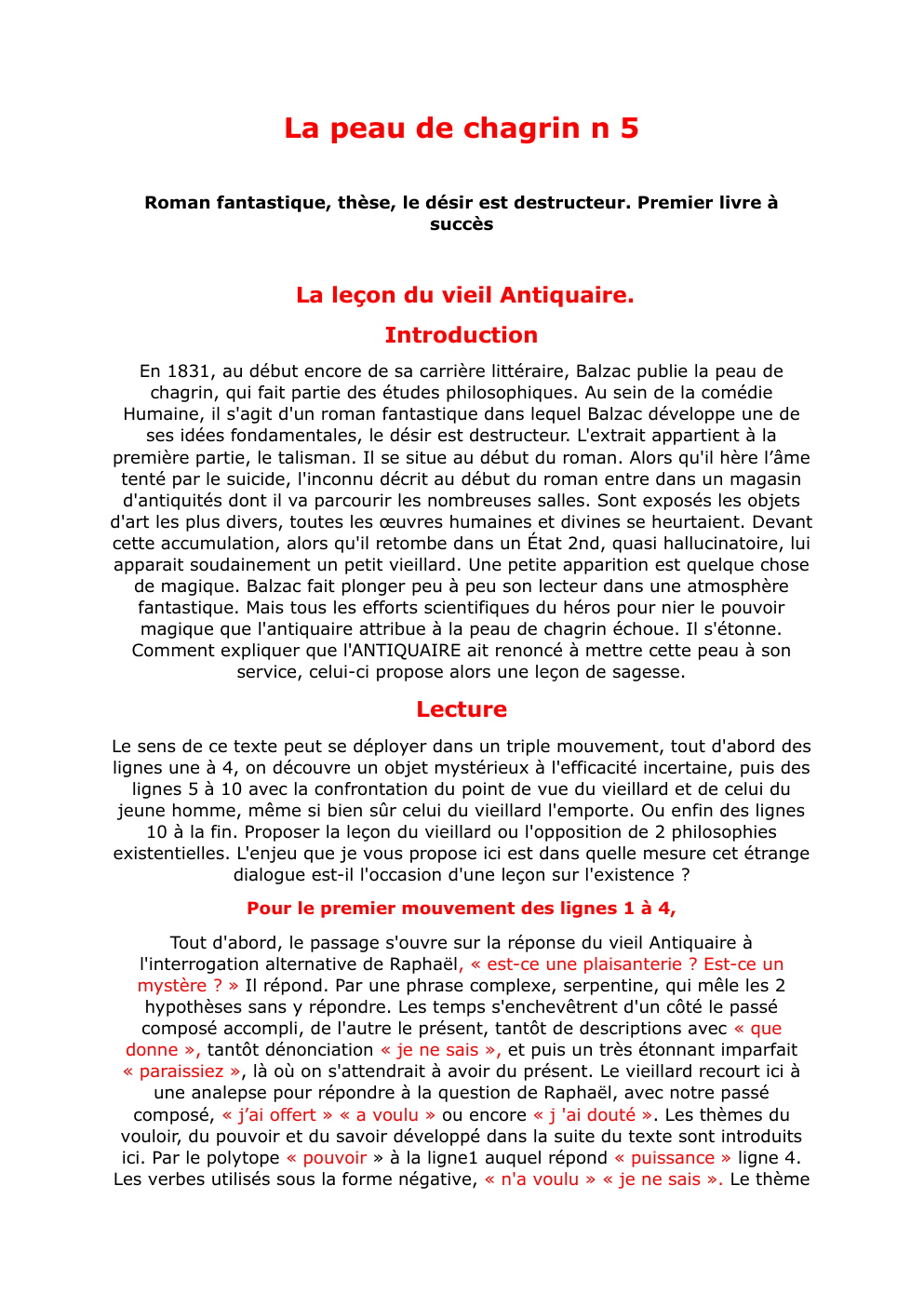La peau de chagrin n 5 Roman fantastique, thèse, le désir est destructeur. Premier livre à succès La leçon du vieil Antiquaire.
Publié le 13/04/2025
Extrait du document
«
La peau de chagrin n 5
Roman fantastique, thèse, le désir est destructeur.
Premier livre à
succès
La leçon du vieil Antiquaire.
Introduction
En 1831, au début encore de sa carrière littéraire, Balzac publie la peau de
chagrin, qui fait partie des études philosophiques.
Au sein de la comédie
Humaine, il s'agit d'un roman fantastique dans lequel Balzac développe une de
ses idées fondamentales, le désir est destructeur.
L'extrait appartient à la
première partie, le talisman.
Il se situe au début du roman.
Alors qu'il hère l’âme
tenté par le suicide, l'inconnu décrit au début du roman entre dans un magasin
d'antiquités dont il va parcourir les nombreuses salles.
Sont exposés les objets
d'art les plus divers, toutes les œuvres humaines et divines se heurtaient.
Devant
cette accumulation, alors qu'il retombe dans un État 2nd, quasi hallucinatoire, lui
apparait soudainement un petit vieillard.
Une petite apparition est quelque chose
de magique.
Balzac fait plonger peu à peu son lecteur dans une atmosphère
fantastique.
Mais tous les efforts scientifiques du héros pour nier le pouvoir
magique que l'antiquaire attribue à la peau de chagrin échoue.
Il s'étonne.
Comment expliquer que l'ANTIQUAIRE ait renoncé à mettre cette peau à son
service, celui-ci propose alors une leçon de sagesse.
Lecture
Le sens de ce texte peut se déployer dans un triple mouvement, tout d'abord des
lignes une à 4, on découvre un objet mystérieux à l'efficacité incertaine, puis des
lignes 5 à 10 avec la confrontation du point de vue du vieillard et de celui du
jeune homme, même si bien sûr celui du vieillard l'emporte.
Ou enfin des lignes
10 à la fin.
Proposer la leçon du vieillard ou l'opposition de 2 philosophies
existentielles.
L'enjeu que je vous propose ici est dans quelle mesure cet étrange
dialogue est-il l'occasion d'une leçon sur l'existence ?
Pour le premier mouvement des lignes 1 à 4,
Tout d'abord, le passage s'ouvre sur la réponse du vieil Antiquaire à
l'interrogation alternative de Raphaël, « est-ce une plaisanterie ? Est-ce un
mystère ? » Il répond.
Par une phrase complexe, serpentine, qui mêle les 2
hypothèses sans y répondre.
Les temps s'enchevêtrent d'un côté le passé
composé accompli, de l'autre le présent, tantôt de descriptions avec « que
donne », tantôt dénonciation « je ne sais », et puis un très étonnant imparfait
« paraissiez », là où on s'attendrait à avoir du présent.
Le vieillard recourt ici à
une analepse pour répondre à la question de Raphaël, avec notre passé
composé, « j’ai offert » « a voulu » ou encore « j 'ai douté ».
Les thèmes du
vouloir, du pouvoir et du savoir développé dans la suite du texte sont introduits
ici.
Par le polytope « pouvoir » à la ligne1 auquel répond « puissance » ligne 4.
Les verbes utilisés sous la forme négative, « n'a voulu » « je ne sais ».
Le thème
de l'énergie est également explicitement introduit ligne 2, au travers de la
présentation des clients qui auraient pu conclure le pacte.
Par ailleurs, les paroles
du vieillard insistent sur l'aspect mystérieux de la peau en mêlant tonalité,
fantastique et tragique avec le relevé suivant, « terrible pouvoir », « talisman »,
« problématique influence », « destinée », « fatalement » ou encore « je ne sais
quelle puissance ».
Il sous-entend que la peau a quelque chose de surnaturel,
d'inexpliqué, d'inquiétant.
Les adjectifs péjoratifs terribles et problématiques
illustrent cette idée ainsi que l'adverbe « fatalement » doublé de l'adverbe
intensif « si ».
Toutefois, la plaisanterie n'est pas exclue par le gérondif « en se
moquant ».
Le vieil antiquaire n'est pas sûr de l'authenticité du contrat proposé
par la peau.
Et exprime sans doute et sa méconnaissance par la négation, « je
ne sais pas », ou par les verbes « douter » ou « s’abstenir », doutes, conforté
par l'aspect contradictoire des réactions de ses clients.
D'un côté le Gérondif
« tout en se moquant » auquel répond une négation, « aucun n'a voulu », alors
pourquoi ? Pourquoi les actes contredisent ils ainsi les paroles ? Tout simplement
parce que la peau fait peur.
2e mouvement des lignes, 5 à 10
Avec la confrontation des 2 points de vue.
Les paroles du vieillard sont
interrompues par le jeune homme intrigué par la peau et le fait que le marchand
ne l’a pas utilisé par lui-même, il intervient grâce à une question oralisée, ainsi
que par le Gérondif dans l’incise « en l'interrompant ».
Ce sont les seules paroles
de Raphaël dans ce passage.
Le vieillard, réponds par une exclamation et utilise
le procédé de l’anadiplose du verbe « essayer » pour exposer avec plus d'énergie
l'idée exprimée par Raphaël.
Sa réponse est constituée ensuite par une série de
questions rhétoriques.
Alors de nouveau il élude la question posée.
2 hypothèses,
soit il ne croit pas en ce pouvoir, soit il démontre que ce pacte ne s’essaie pas,
soit on le conclut, soit on ne le conclut pas.
La première question s'adresse
directement à Raphaël, comme le montre le pronom personnel de la 5e
personne, « vous » qui apparaissez à 2 reprises, c’est une question qui provoque
le jeune homme en reposant sur une proposition subordonnée circonstancielle.
De condition.
Ainsi que le recours au temps du conditionnel présent cette fois-ci dans la
principale pour montrer qu'ici qui est irréel, nous sommes ici dans l'irréel du
présent.
Le vieil homme veut en effet démontrer par l'absurde qu'il y a des
risques qu'on ne prend pas, car ils sont mortifères.
Et les deux questions
suivantes ont une portée plus large On a remplacé la P 5 « vous » par le pronom
indéfini « on », puis par le substantif homme qui a une portée plus philosophique
aussi, en évoquant le pouvoir de l'homme face à la vie.
On retrouve le procédé
du Polyptote.
Ici « peut-on » deviendra « a-t-il pu » dans la principale.
Recours à l'euphémisme, arrêter le cours de sa vie.
Donc ceci.
Avec, le jeu
d'opposition avec la vie et la mort.
« Scinder la mort », qui évoque le suicide et
l'impuissance de l'homme.
Enfin la mort impuissance, marquée par le recours à
négation, avec l’adverbe « jamais ».
Le vieillard insiste, puisque trouver le terme
« revient » sur l'inconstance de Raphaël.
Le plus que parfait, « vous aviez
résolu » s'oppose ici au présent de narration, « vous occupe et vous distrait », et
la conjonction de coordination « mais » à valeur adversative ainsi que l'adverbe
« Tout à coup » montre à quel point Raphaël change de comportement.
L'idée de
mort est au cœur, des paroles du vieillard les verbes « suicider » et « mourir »
répondent aux euphémismes à des questions précédentes et sont tous les 2
situés en fin de proposition pour mieux les mettre en valeur et insister ainsi sur
la versatilité de Raphaël.
Vous avez dû remarquer également, le chiasme avec
« suicide occupe distrait et mourir ».
Que la mort occupe le début et la fin de de
la proposition, l’apostrophe « enfant » met en lumière la différence d'âge entre
les 2 personnages.
Et annonce ainsi la leçon de sagesse qui va suivre.
On voit le
recours à l'interro-négatif et au comparatif de supériorité, « plus intéressant » en
tout cas, qui résonne comme une mise en garde ou au moins un conseil,
l'énigme de la vie est désignée par la périphrase « chacun de vos jours ».
Cette
énigme vaut mieux que celle de la peau.
En tout cas, pour le vieil antiquaire, le
thème du mystère revient pour désigner la peau avec les termes « secrets et
énigmes ».
Ce qui nous amène au 3e mouvement
Sur l'expression de la sagesse du vieil antiquaire et l’opposition de 2 philosophies
existentielles.
Le 3e mouvement s'ouvre par l'impératif, « écoutez-moi ».
Le
vieillard donne ainsi un ordre et délivre un témoignage de sa vie passée.
C'est
donc l'occasion d'une nouvelle analepse.
Enfin, on avait déjà eu dans le premier
mouvement, analepse se centrait, cette fois-ci sur le personnage avec le pronom
personnel « je » et l'utilisation du passé composé, le.
Vieillard se pose finalement
comme une figure d'autorité, une figure de sagesse.
À ce qui était déjà annoncé
par l'apostrophe « enfants ».
Il inscrit son récit dans le temps avec l’évocation
historique à la Cour licencieuse du Régent, c'est à dire de Philippe d'Orléans,
Régence qui s'étend de l'année 1715 à l’année 1723 dont il fut témoin.
Il fut
témoin de la vie de débauche qui régnait alors à Versailles.
L'évocation de son
âge,102 ans, renforce l'aspect mystérieux de ce personnage.
Le récit joue alors
sur la comparaison, « comme vous »....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La Peau de chagrin est-il un roman fantastique ?
- La peau de chagrin, Honoré de Balzac - Roman réaliste ou fantastique ?
- La Peau de chagrin est-il un roman fantastique ?
- Commentaire Composé: La Peau de Chagrin, Balzac - Étude du passage de la description de l'antiquaire, de la page 89 à 91
- Titre : « Le Petit Prince » Auteur : Antoine de Saint Exupéry Genre du livre : roman et conte