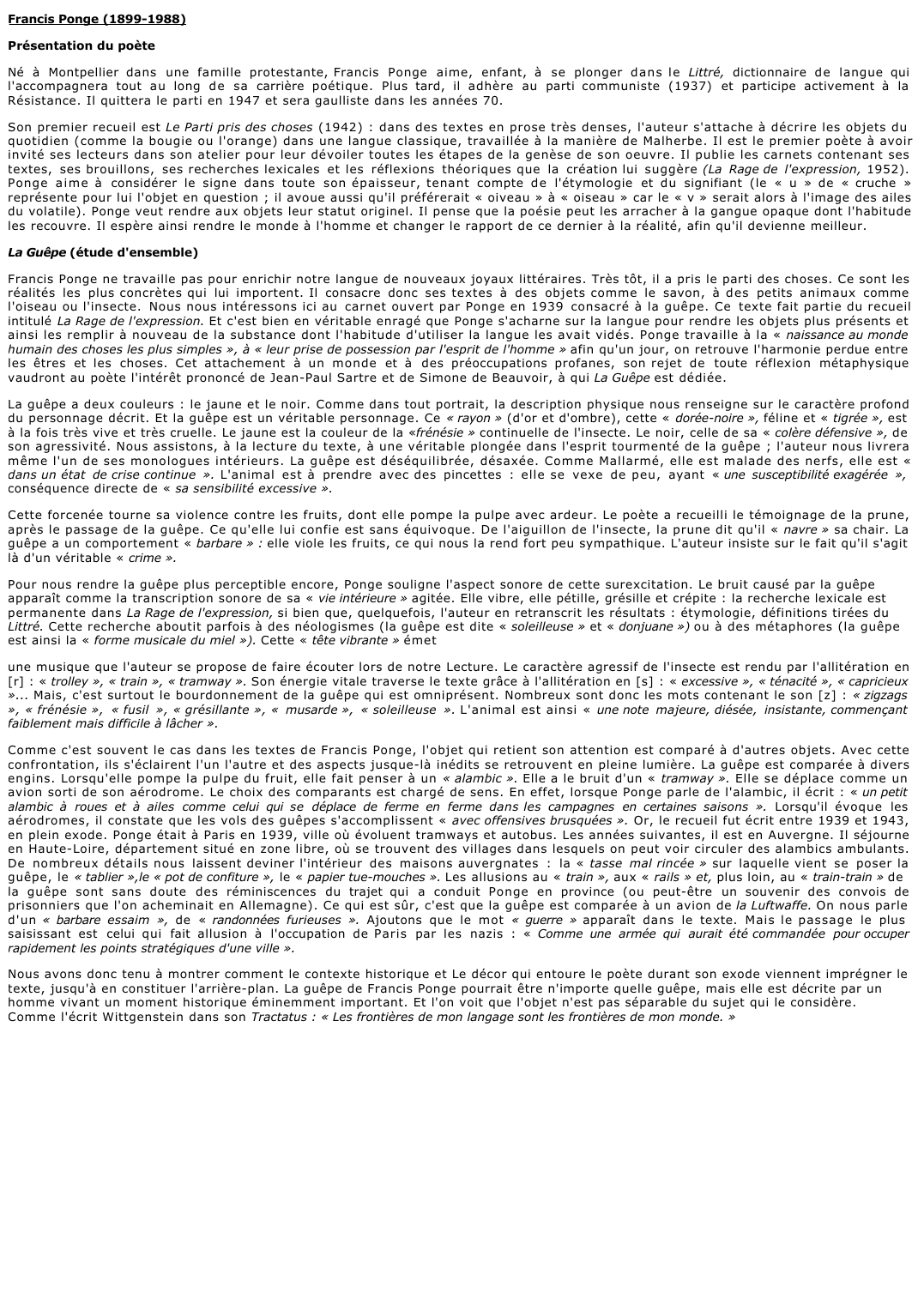Francis Ponge : La Guêpe
Publié le 15/05/2020

Extrait du document
«
Francis Ponge (1899-1988)
Présentation du poète
Né à Montpellier dans une famille protestante, Francis Ponge aime, enfant, à se plonger dans le Littré, dictionnaire de langue qui l'accompagnera tout au long de sa carrière poétique.
Plus tard, il adhère au parti communiste (1937) et participe activement à laRésistance.
Il quittera le parti en 1947 et sera gaulliste dans les années 70.
Son premier recueil est Le Parti pris des choses (1942) : dans des textes en prose très denses, l'auteur s'attache à décrire les objets du quotidien (comme la bougie ou l'orange) dans une langue classique, travaillée à la manière de Malherbe.
Il est le premier poète à avoirinvité ses lecteurs dans son atelier pour leur dévoiler toutes les étapes de la genèse de son oeuvre.
Il publie les carnets contenant sestextes, ses brouillons, ses recherches lexicales et les réflexions théoriques que la création lui suggère (La Rage de l'expression, 1952). Ponge aime à considérer le signe dans toute son épaisseur, tenant compte de l'étymologie et du signifiant (le « u » de « cruche »représente pour lui l'objet en question ; il avoue aussi qu'il préférerait « oiveau » à « oiseau » car le « v » serait alors à l'image des ailesdu volatile).
Ponge veut rendre aux objets leur statut originel.
Il pense que la poésie peut les arracher à la gangue opaque dont l'habitudeles recouvre.
Il espère ainsi rendre le monde à l'homme et changer le rapport de ce dernier à la réalité, afin qu'il devienne meilleur.
La Guêpe (étude d'ensemble)
Francis Ponge ne travaille pas pour enrichir notre langue de nouveaux joyaux littéraires.
Très tôt, il a pris le parti des choses.
Ce sont lesréalités les plus concrètes qui lui importent.
Il consacre donc ses textes à des objets comme le savon, à des petits animaux commel'oiseau ou l'insecte.
Nous nous intéressons ici au carnet ouvert par Ponge en 1939 consacré à la guêpe.
Ce texte fait partie du recueilintitulé La Rage de l'expression.
Et c'est bien en véritable enragé que Ponge s'acharne sur la langue pour rendre les objets plus présents et ainsi les remplir à nouveau de la substance dont l'habitude d'utiliser la langue les avait vidés.
Ponge travaille à la « naissance au monde humain des choses les plus simples », à « leur prise de possession par l'esprit de l'homme » afin qu'un jour, on retrouve l'harmonie perdue entre les êtres et les choses.
Cet attachement à un monde et à des préoccupations profanes, son rejet de toute réflexion métaphysiquevaudront au poète l'intérêt prononcé de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir, à qui La Guêpe est dédiée.
La guêpe a deux couleurs : le jaune et le noir.
Comme dans tout portrait, la description physique nous renseigne sur le caractère profonddu personnage décrit.
Et la guêpe est un véritable personnage.
Ce « rayon » (d'or et d'ombre), cette « dorée-noire », féline et « tigrée », est à la fois très vive et très cruelle.
Le jaune est la couleur de la « frénésie » continuelle de l'insecte.
Le noir, celle de sa « colère défensive », de son agressivité.
Nous assistons, à la lecture du texte, à une véritable plongée dans l'esprit tourmenté de la guêpe ; l'auteur nous livreramême l'un de ses monologues intérieurs.
La guêpe est déséquilibrée, désaxée.
Comme Mallarmé, elle est malade des nerfs, elle est «dans un état de crise continue ».
L'animal est à prendre avec des pincettes : elle se vexe de peu, ayant « une susceptibilité exagérée », conséquence directe de « sa sensibilité excessive ».
Cette forcenée tourne sa violence contre les fruits, dont elle pompe la pulpe avec ardeur.
Le poète a recueilli le témoignage de la prune,après le passage de la guêpe.
Ce qu'elle lui confie est sans équivoque.
De l'aiguillon de l'insecte, la prune dit qu'il « navre » sa chair.
La guêpe a un comportement « barbare » : elle viole les fruits, ce qui nous la rend fort peu sympathique.
L'auteur insiste sur le fait qu'il s'agit là d'un véritable « crime ».
Pour nous rendre la guêpe plus perceptible encore, Ponge souligne l'aspect sonore de cette surexcitation.
Le bruit causé par la guêpeapparaît comme la transcription sonore de sa « vie intérieure » agitée.
Elle vibre, elle pétille, grésille et crépite : la recherche lexicale est permanente dans La Rage de l'expression, si bien que, quelquefois, l'auteur en retranscrit les résultats : étymologie, définitions tirées du Littré.
Cette recherche aboutit parfois à des néologismes (la guêpe est dite « soleilleuse » et « donjuane ») ou à des métaphores (la guêpe est ainsi la « forme musicale du miel »).
Cette « tête vibrante » émet
une musique que l'auteur se propose de faire écouter lors de notre Lecture.
Le caractère agressif de l'insecte est rendu par l'allitération en[r] : « trolley », « train », « tramway ».
Son énergie vitale traverse le texte grâce à l'allitération en [s] : « excessive », « ténacité », « capricieux »...
Mais, c'est surtout le bourdonnement de la guêpe qui est omniprésent.
Nombreux sont donc les mots contenant le son [z] : « zigzags », « frénésie », « fusil », « grésillante », « musarde », « soleilleuse ».
L'animal est ainsi « une note majeure, diésée, insistante, commençant faiblement mais difficile à lâcher ».
Comme c'est souvent le cas dans les textes de Francis Ponge, l'objet qui retient son attention est comparé à d'autres objets.
Avec cetteconfrontation, ils s'éclairent l'un l'autre et des aspects jusque-là inédits se retrouvent en pleine lumière.
La guêpe est comparée à diversengins.
Lorsqu'elle pompe la pulpe du fruit, elle fait penser à un « alambic ».
Elle a le bruit d'un « tramway ».
Elle se déplace comme un avion sorti de son aérodrome.
Le choix des comparants est chargé de sens.
En effet, lorsque Ponge parle de l'alambic, il écrit : « un petit alambic à roues et à ailes comme celui qui se déplace de ferme en ferme dans les campagnes en certaines saisons ».
Lorsqu'il évoque les aérodromes, il constate que les vols des guêpes s'accomplissent « avec offensives brusquées ».
Or, le recueil fut écrit entre 1939 et 1943, en plein exode.
Ponge était à Paris en 1939, ville où évoluent tramways et autobus.
Les années suivantes, il est en Auvergne.
Il séjourneen Haute-Loire, département situé en zone libre, où se trouvent des villages dans lesquels on peut voir circuler des alambics ambulants.De nombreux détails nous laissent deviner l'intérieur des maisons auvergnates : la « tasse mal rincée » sur laquelle vient se poser la guêpe, le « tablier »,le « pot de confiture », le « papier tue-mouches ».
Les allusions au « train », aux « rails » et, plus loin, au « train-train » de la guêpe sont sans doute des réminiscences du trajet qui a conduit Ponge en province (ou peut-être un souvenir des convois deprisonniers que l'on acheminait en Allemagne).
Ce qui est sûr, c'est que la guêpe est comparée à un avion de la Luftwaffe.
On nous parle d'un « barbare essaim », de « randonnées furieuses ».
Ajoutons que le mot « guerre » apparaît dans le texte.
Mais le passage le plus saisissant est celui qui fait allusion à l'occupation de Paris par les nazis : « Comme une armée qui aurait été commandée pour occuper rapidement les points stratégiques d'une ville ».
Nous avons donc tenu à montrer comment le contexte historique et Le décor qui entoure le poète durant son exode viennent imprégner letexte, jusqu'à en constituer l'arrière-plan.
La guêpe de Francis Ponge pourrait être n'importe quelle guêpe, mais elle est décrite par unhomme vivant un moment historique éminemment important.
Et l'on voit que l'objet n'est pas séparable du sujet qui le considère.Comme l'écrit Wittgenstein dans son Tractatus : « Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde.
».
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Objet d'étude : La poésie du XIX et du XX siècle. Parcours complémentaire : Alchimie poétique : réinventer le monde. Analyse linéaire 2/2 « Le Pain », Francis Ponge, Le Parti pris des choses, 1942
- Lecture linéaire - L'Huitre de Francis Ponge
- écrit d appropriation francis ponge
- PONGE, Francis (1899-1988)Francis Ponge a écrit : " Tout se passe (du moins l'imaginais-je souvent) comme si, depuisque j'ai commencé à écrire, je courais, sans le moindre succès, " après " l'estime d'unecertaine personne.
- L'huître, Francis PONGE, Le partit pris des choses, lecture linéaire