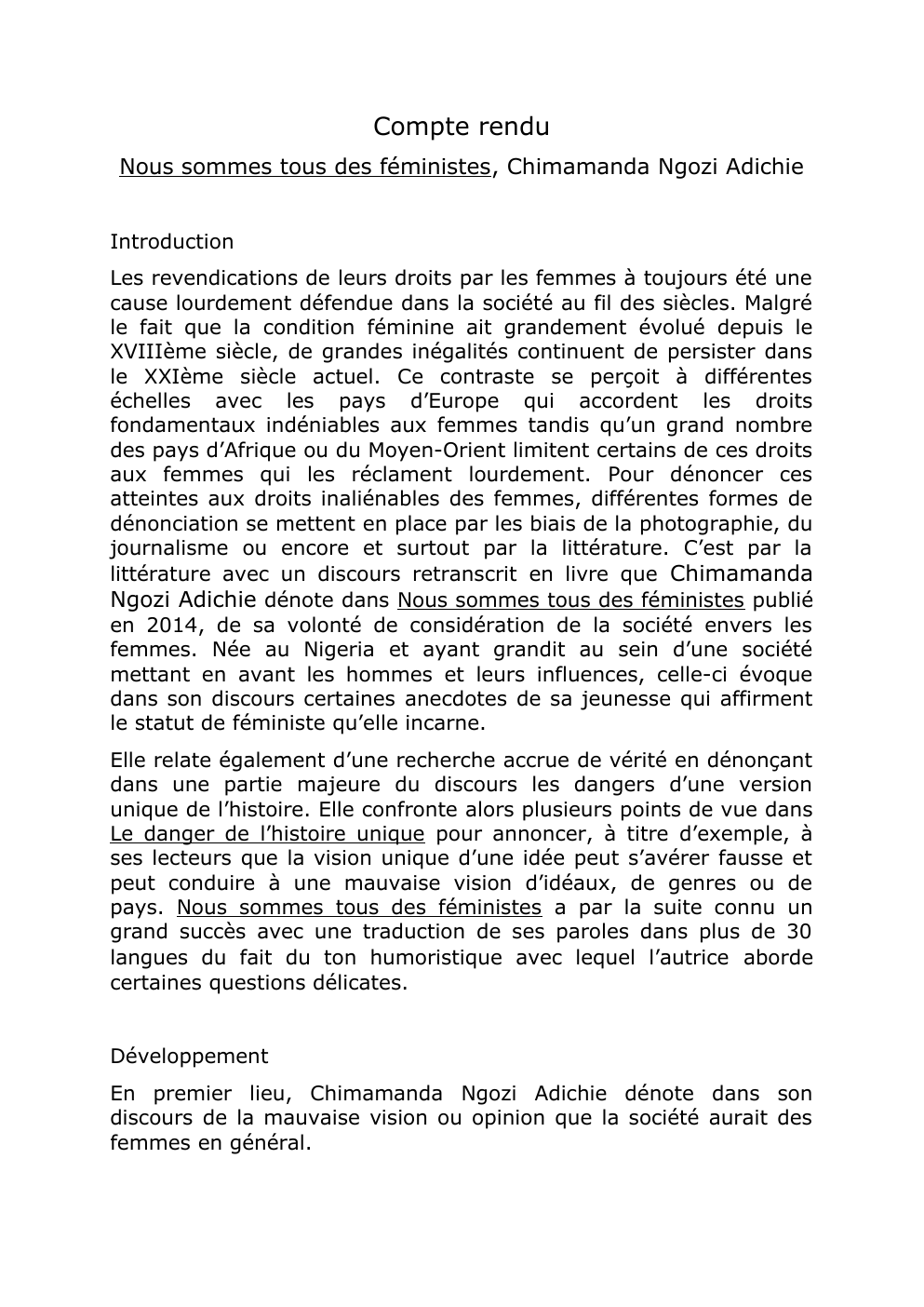Fiche de lecture : Nous sommes tous des féministes
Publié le 26/05/2025
Extrait du document
«
Compte rendu
Nous sommes tous des féministes, Chimamanda Ngozi Adichie
Introduction
Les revendications de leurs droits par les femmes à toujours été une
cause lourdement défendue dans la société au fil des siècles.
Malgré
le fait que la condition féminine ait grandement évolué depuis le
XVIIIème siècle, de grandes inégalités continuent de persister dans
le XXIème siècle actuel.
Ce contraste se perçoit à différentes
échelles avec les pays d’Europe qui accordent les droits
fondamentaux indéniables aux femmes tandis qu’un grand nombre
des pays d’Afrique ou du Moyen-Orient limitent certains de ces droits
aux femmes qui les réclament lourdement.
Pour dénoncer ces
atteintes aux droits inaliénables des femmes, différentes formes de
dénonciation se mettent en place par les biais de la photographie, du
journalisme ou encore et surtout par la littérature.
C’est par la
littérature avec un discours retranscrit en livre que Chimamanda
Ngozi Adichie dénote dans Nous sommes tous des féministes publié
en 2014, de sa volonté de considération de la société envers les
femmes.
Née au Nigeria et ayant grandit au sein d’une société
mettant en avant les hommes et leurs influences, celle-ci évoque
dans son discours certaines anecdotes de sa jeunesse qui affirment
le statut de féministe qu’elle incarne.
Elle relate également d’une recherche accrue de vérité en dénonçant
dans une partie majeure du discours les dangers d’une version
unique de l’histoire.
Elle confronte alors plusieurs points de vue dans
Le danger de l’histoire unique pour annoncer, à titre d’exemple, à
ses lecteurs que la vision unique d’une idée peut s’avérer fausse et
peut conduire à une mauvaise vision d’idéaux, de genres ou de
pays.
Nous sommes tous des féministes a par la suite connu un
grand succès avec une traduction de ses paroles dans plus de 30
langues du fait du ton humoristique avec lequel l’autrice aborde
certaines questions délicates.
Développement
En premier lieu, Chimamanda Ngozi Adichie dénote dans son
discours de la mauvaise vision ou opinion que la société aurait des
femmes en général.
Cette vision péjorative des femmes peut s’expliquer par la
revendication de l’autrice comme féministe.
En effet, le féminisme
revendique le fait que les femmes sont considérées comme
inferieures aux hommes et qu’elles se doivent d’assurer leur propre
montée en importance dans la société, pour atteindre le même
niveau social que les hommes.
Ce mouvement est donc
automatiquement associé à un extrémisme qu’il faut combattre, ce
qui explique le rejet de la société vis-à-vis du féminisme que
revendique l’autrice.
Chimamanda Ngozi Adichie nous fait donc part
de sa découverte de ce terme qu’elle-même considérait comme
dépréciatif avant de se l’approprier fièrement.
Cette image peu
convaincante est expliquée par la vision du terme par son ami
Okolama : « à en juger par son ton – celui qu’on emploiera pour
accuser une personne de soutenir le terrorisme ».
Selon l’autrice, si
une femme s’approprie ce terme, le fait que cette les connotations
liées à ce mot soient tellement poussées, celle-ci pourrait connaître
des complications liées à sa vie sociale ou amoureuse : « faute de
trouver un mari ».
Chimamanda Ngozi Adichie établit un contraste
révélant l’idée qu’une femme féministe peut tout à fait être une
femme heureuse.
Elle annonce euphoriquement qu’elle est une
« Féministe africaine heureuse qui ne déteste pas les hommes, qui
aime mettre du brillant à lèvres et des talons hauts pour son plaisir,
et non pour séduire les hommes ».
Par une certaine forme
d’humour, les revendications de l’autrice sont plus facilement
acceptées par les lecteurs.
Par la suite, Chimamanda Ngozi Adichie revient sur la condition
sociale et économique de la femme qui est fortement dénigrée par la
société.
Bien longtemps, la femme était économiquement
dépendante de son mari dans ses dépenses.
Elle devait également
lui verser une dot lors du mariage avec celui-ci pour garantir son
amour ainsi que son appartenance.
Les femmes étaient donc
longtemps réduites aux décisions de leur mari d’un point de vue
économique.
Cette idée, aujourd’hui absurde, s’est amenuisée pour
ensuite disparaitre dans un grand nombre de pays occidentaux et
pays d’Europe.
Mais en Afrique, c’est toujours le cas selon l’autrice :
les femmes sont encore dépendantes de leur mari.
Cela se démontre
avec l’une des anecdotes de l’autrice : la fois ou celle-ci s’est rendue
dans un hôtel au Nigeria et a sans aucune hésitation été considérée
comme une prostituée, ce qui prouve que la société n’envisage
aucunement le fait qu’une femme puisse réussir dans la vie et être
économiquement confortable.
Une autre anecdote témoigne de la
différence de traitement entre les hommes et les femmes.
Lors
d’une discussion entre Chimamanda Ngozi Adichie et son ami Louis à
propos de si les inégalités entre hommes et femmes persistaient
encore ou non, l’autrice laisse un pourboire au garagiste qui a aidé
les a aidés avec leur automobile.
Contre toute attente, le garagiste
remercie l’ami de l’autrice : Louis en raison de son genre : « parce
que Louis était un homme ».
Cette différence de traitement, peut
importe la classe sociale est également évoquée par Wangari
Maathai, lauréate provenant cette fois du Kenya : « Plus on s’élève
dans l’échelle sociale, moins il y a de femmes ».
Cela s’explique car
les femmes ont acquis le droit au travail depuis peu, plus
particulièrement lors de la Première Guerre mondiale lorsque cellesci remplaçaient les hommes dans les usines à armement.
De plus, Chimamanda Ngozi Adichie dénonce le fait que les hommes
se montrent inconvenables envers les femmes qui sont plus
courageuses : « Pourquoi des êtres exposés à des grossesses et à
des indispositions passagères ne pourraient-ils exercer des droits
dont on n’a jamais imaginé de priver les gens qui ont la goutte tous
les hivers et qui s’enrhument aisément ? ».
Selon l’autrice, les
femmes s’indignent du fait que seule une différence biologique est à
l’origine de ces différences de traitements des deux genres par la
société.
Pourquoi seul un gène serait à l’origine d’automatisation
dans les taches, cela, l’autrice se le demande vigoureusement :
« Les femmes sont-elles nées avec le gène de la cuisine....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche de lecture, Arthur Rimbaud, Cahiers de Douai.
- HGGSP : Fiche de Lecture article Wagner
- fiches de lecture FICHE N°1 : SIDDARTHA METAMORPHOSES DU MOI
- fiche de lecture 1984 d'Orwell
- Audier, Serge. "Néo-libéralisme(s)", introduction. Fiche de lecture