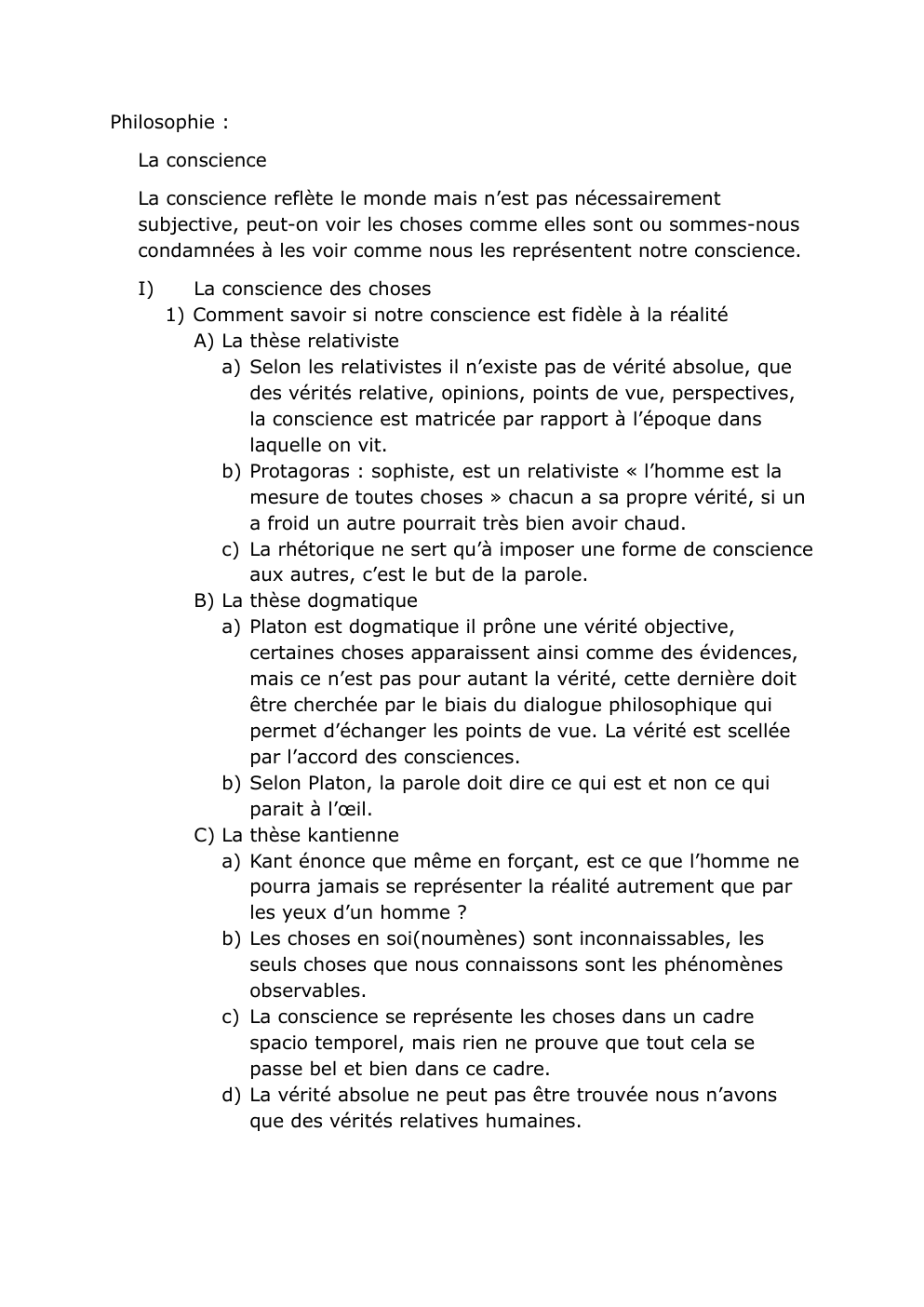étude d'un thème de terminale en philosophie : la conscience
Publié le 13/04/2025
Extrait du document
«
Philosophie :
La conscience
La conscience reflète le monde mais n’est pas nécessairement
subjective, peut-on voir les choses comme elles sont ou sommes-nous
condamnées à les voir comme nous les représentent notre conscience.
I)
La conscience des choses
1) Comment savoir si notre conscience est fidèle à la réalité
A) La thèse relativiste
a) Selon les relativistes il n’existe pas de vérité absolue, que
des vérités relative, opinions, points de vue, perspectives,
la conscience est matricée par rapport à l’époque dans
laquelle on vit.
b) Protagoras : sophiste, est un relativiste « l’homme est la
mesure de toutes choses » chacun a sa propre vérité, si un
a froid un autre pourrait très bien avoir chaud.
c) La rhétorique ne sert qu’à imposer une forme de conscience
aux autres, c’est le but de la parole.
B) La thèse dogmatique
a) Platon est dogmatique il prône une vérité objective,
certaines choses apparaissent ainsi comme des évidences,
mais ce n’est pas pour autant la vérité, cette dernière doit
être cherchée par le biais du dialogue philosophique qui
permet d’échanger les points de vue.
La vérité est scellée
par l’accord des consciences.
b) Selon Platon, la parole doit dire ce qui est et non ce qui
parait à l’œil.
C) La thèse kantienne
a) Kant énonce que même en forçant, est ce que l’homme ne
pourra jamais se représenter la réalité autrement que par
les yeux d’un homme ?
b) Les choses en soi(noumènes) sont inconnaissables, les
seuls choses que nous connaissons sont les phénomènes
observables.
c) La conscience se représente les choses dans un cadre
spacio temporel, mais rien ne prouve que tout cela se
passe bel et bien dans ce cadre.
d) La vérité absolue ne peut pas être trouvée nous n’avons
que des vérités relatives humaines.
e) Il faut discerner le monde tel que nous le connaissons du
monde te qu’il existe à l’extérieur de nous(couleurs), nous
ne pouvons le connaitre : idéalisme transcendantal.
2) Comment être sûr que le monde existe en dehors de ma
conscience
A) Pourquoi douter de l’existence du monde
a) Descartes énonce le doute hyperbolique, (il est passionné
par la certitude) il faut douter de toute chose afin d’arriver
à une vérité relative, en effet, c’est en écartant tout ce qui
faux que l’on se rapproche de la vérité.
b) Qu’est ce qui me prouve que la vie n’est pas un rêve dont
on ne se réveillerait jamais (expérience du cerveau sous
vide), j’ai des sensations mais comment être sûr que ces
sensations sont causées par des objets extérieurs à ma
conscience.
c) 1ère hypothèse : ces sensations sont causées par ma
conscience en elle-même, cette théorie mène au
solipsisme, ainsi rien n’existerait en dehors de ma
conscience, ici Descartes ne dit pas que le monde n’existe
pas, il dit juste que l’existence du monde n’est pas une
vérité absolue.
Nous sommes incapables de distinguer la
réalité : Zhuangzi, chinois, il rêve d’un papillon ou alors un
papillon rêve qu’il est un homme.
d) 2nde hypothèse : le monde n’est qu’une illusion engendrée
par un « un malin génie » mots de Descartes.
e) 3ème hypothèse : les choses existent mais ce ne sont pas
des choses ce sont des objets en dehors de notre
conscience : thèse de Berkeley.la matière n’existe pas tout
est esprit.
B) Comment puis-je savoir que le monde existe en dehors de ma
conscience ?
a) Descartes précise que son doute est purement théorique, il
s’agit seulement de penser que c’est vrai.
b) Il ne s’agit pas pour lui de douter de l’existence mais de
douter des évidences, mon existence en tant que chose est
indubitable : théorie du cogito : « cogito ergo sum » =>
conscience réfléchie.
On ne peut douter de sa propre
existence.
c) Descartes doute lui-même de ce qu’il dit et les qualifies
d’hyperbolique, la réalité physique a infiniment plus de
cohérence que les rêves.
d) D’après pascal, nous pouvons démontrer autrement que
par la raison, nous pouvons démontrer avec le cœur et les
sentiments, ainsi l’existence du monde n’a pas besoin
d’être démontré.
II)
La conscience de soi
1) Puis je me connaitre moi-même : on peut se demander si la
conscience se reflète bien elle-même.
A) La thèse cartésienne
a) Descartes dit que nous connaissons plus ce que nous
savons de nous que ce que nous connaissons de l’extérieur,
à notre insu.
b) Comment pourra-t-on ne pas être au courant de nos propre
pensées (amours, désirs, idées), ainsi avec Descartes on
assimile la pensée et la conscience.
B) L’hypothèse de l’inconscient
a) Je suis un autre, écrit Rimbaud, nous pouvons avoir le
sentiment que quelque chose en nous nous est étranger.
Est-il réellement facile de se connaitre soi-même.
b) Freud estime qu’il y a plus d’inconscient que de conscient
dans le corps humain, le psychisme prendra la forme d’un
iceberg dont la partie émergée représenterait la science,
ainsi l’esprit humain refoulerait ses pensées internes
(souvenirs douloureux) afin de se protéger, on ne saurait
donc se connaitre vraiment sans passer par la
psychanalyse, on conclut contre Descartes et pour Freud
que l’esprit n'est pas plus simple à comprendre que le
corps.
C) La critique sartrienne de l’hypothèse de l’inconscient
a) L’inconscience pose donc un problème moral, si le moi n’est
plus maitre de sa propre maison, alors le moi n’est plus
maitre de ses actes, agit-il encore de manière volontaire et
consciente.
b)....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA CONSCIENCE (résumé de cours de philosophie)
- Le Langage - Cours Complet Philosophie Terminale
- Révisions HGGSP Terminale Thème 5 L'environnement
- Étude de cas - Philosophie et Rationalité
- THÈME 1 : ÉTUDE ÉCONOMIQUE DE LA CÔTE D’IVOIRE