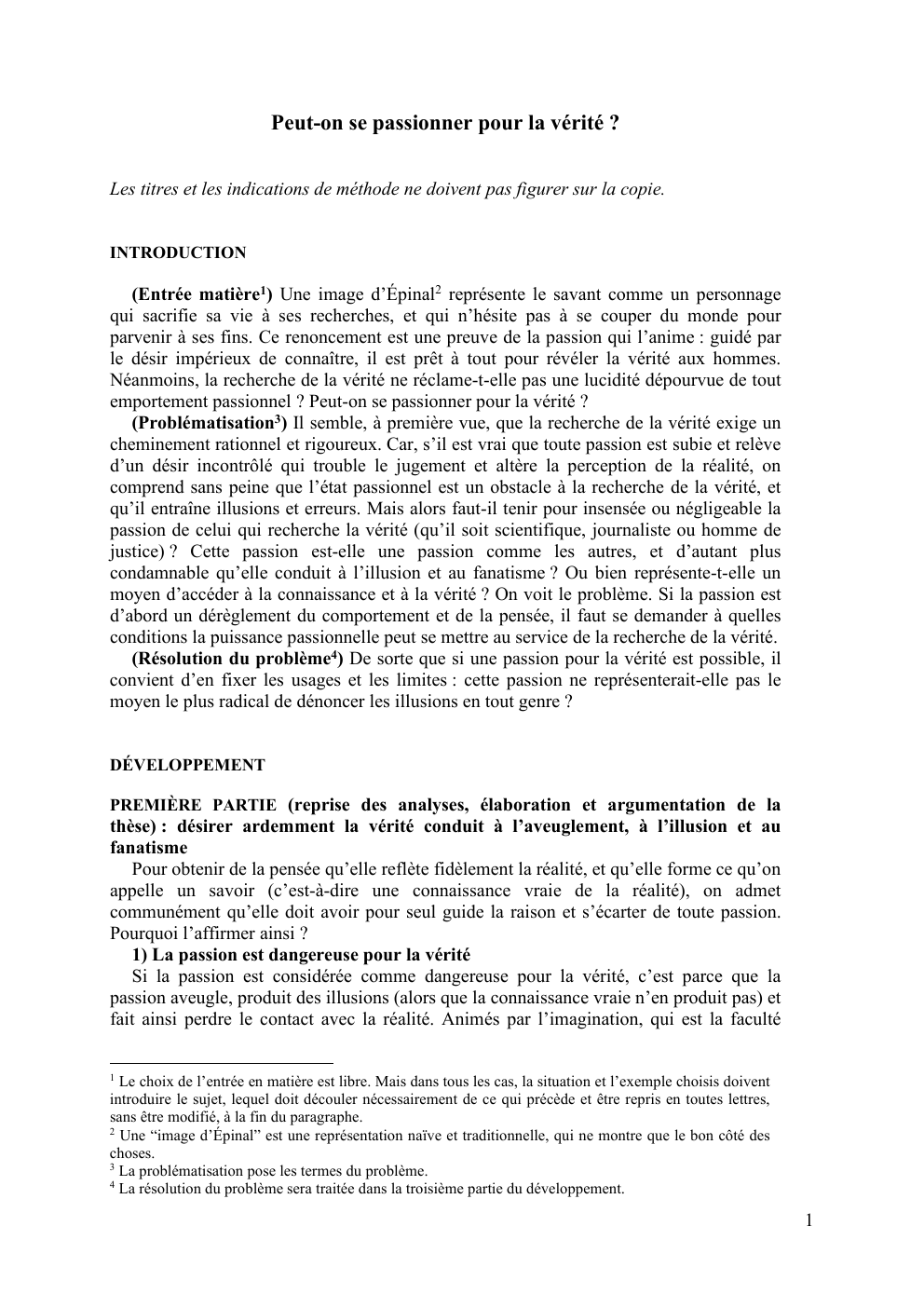Devoir de philosophie: Peut-on se passionner pour la vérité ?
Publié le 13/04/2025
Extrait du document
«
Peut-on se passionner pour la vérité ?
Les titres et les indications de méthode ne doivent pas figurer sur la copie.
INTRODUCTION
(Entrée matière1) Une image d’Épinal2 représente le savant comme un personnage
qui sacrifie sa vie à ses recherches, et qui n’hésite pas à se couper du monde pour
parvenir à ses fins.
Ce renoncement est une preuve de la passion qui l’anime : guidé par
le désir impérieux de connaître, il est prêt à tout pour révéler la vérité aux hommes.
Néanmoins, la recherche de la vérité ne réclame-t-elle pas une lucidité dépourvue de tout
emportement passionnel ? Peut-on se passionner pour la vérité ?
(Problématisation3) Il semble, à première vue, que la recherche de la vérité exige un
cheminement rationnel et rigoureux.
Car, s’il est vrai que toute passion est subie et relève
d’un désir incontrôlé qui trouble le jugement et altère la perception de la réalité, on
comprend sans peine que l’état passionnel est un obstacle à la recherche de la vérité, et
qu’il entraîne illusions et erreurs.
Mais alors faut-il tenir pour insensée ou négligeable la
passion de celui qui recherche la vérité (qu’il soit scientifique, journaliste ou homme de
justice) ? Cette passion est-elle une passion comme les autres, et d’autant plus
condamnable qu’elle conduit à l’illusion et au fanatisme ? Ou bien représente-t-elle un
moyen d’accéder à la connaissance et à la vérité ? On voit le problème.
Si la passion est
d’abord un dérèglement du comportement et de la pensée, il faut se demander à quelles
conditions la puissance passionnelle peut se mettre au service de la recherche de la vérité.
(Résolution du problème4) De sorte que si une passion pour la vérité est possible, il
convient d’en fixer les usages et les limites : cette passion ne représenterait-elle pas le
moyen le plus radical de dénoncer les illusions en tout genre ?
DÉVELOPPEMENT
PREMIÈRE PARTIE (reprise des analyses, élaboration et argumentation de la
thèse) : désirer ardemment la vérité conduit à l’aveuglement, à l’illusion et au
fanatisme
Pour obtenir de la pensée qu’elle reflète fidèlement la réalité, et qu’elle forme ce qu’on
appelle un savoir (c’est-à-dire une connaissance vraie de la réalité), on admet
communément qu’elle doit avoir pour seul guide la raison et s’écarter de toute passion.
Pourquoi l’affirmer ainsi ?
1) La passion est dangereuse pour la vérité
Si la passion est considérée comme dangereuse pour la vérité, c’est parce que la
passion aveugle, produit des illusions (alors que la connaissance vraie n’en produit pas) et
fait ainsi perdre le contact avec la réalité.
Animés par l’imagination, qui est la faculté
1
Le choix de l’entrée en matière est libre.
Mais dans tous les cas, la situation et l’exemple choisis doivent
introduire le sujet, lequel doit découler nécessairement de ce qui précède et être repris en toutes lettres,
sans être modifié, à la fin du paragraphe.
2
Une “image d’Épinal” est une représentation naïve et traditionnelle, qui ne montre que le bon côté des
choses.
3
La problématisation pose les termes du problème.
4
La résolution du problème sera traitée dans la troisième partie du développement.
1
d’idéaliser la réalité, nos désirs mettent en scène leur réalisation fantasmée.
Or les
fantasmes reconstruisent la réalité de manière purement imaginaire.
Deux exemples
peuvent l’illustrer5.
Les délires du jaloux l’amènent à voir partout des signes de tromperie
et à chercher dans les moindres détails la confirmation que ses ratiocinations sont vraies.
Le fanatique, quant à lui, aime passionnément la vérité (comme il aime Dieu, le bien, la
justice, la pureté), mais il refuse de prendre le temps de connaître, et, dans ses délires,
assène une « vérité » absolue, présentée sur le mode de l’immédiateté, sans les
médiations intellectuelles nécessaires à la découverte de la vérité.
Ces deux exemples
montrent que la passion pour la vérité cache un fantasme de maîtrise, de toute-puissance
et de violence, fort éloigné de la recherche rationnelle de la vérité.
2) Les qualités intellectuelles requises par la quête de la vérité sont très éloignées
du mode d’être passionnel
Pour déjouer ces pièges, l’homme oppose traditionnellement la raison à ses passions :
seule une recherche dépassionnée peut conduire à la découverte de la vérité.
Il faut donc
soumettre l’exercice de la pensée et du jugement au contrôle rigoureux de la logique et de
l’expérience, pour démasquer les erreurs de raisonnement, ne pas perdre le contact avec
la réalité et éviter de tomber dans la violence.
Il faut d’ailleurs remarquer que la
découverte de la vérité ne dépend pas d’une démarche volontaire, car la vérité s’impose
d’elle-même, hors de toute volonté de maîtrise du sujet.
En effet, la vérité se révèle
toujours sur le mode d’une expérience contraignante de la pensée : est vraie toute
proposition qui, sous certaines conditions, logiques ou empiriques, s’avère nécessaire.
Ainsi la vérité se reconnaît-elle dans l’impossibilité de penser contre elle ou de concevoir
qu’elle soit différente.
En ce sens, la vérité fait plier l’esprit de celui qui la saisit, plutôt
qu’elle ne s’y soumet.
3) La recherche de la vérité est une victoire sur la vie passionnelle
On peut donc affirmer que la recherche de la vérité, en s’opposant au processus de la
passion, aspire à une représentation fidèle de la réalité.
Sans le contrôle, par la raison, de
ce que nous pensons ou imaginons spontanément, nous serions toujours prisonniers de
nos opinions les plus flatteuses et les moins pénibles, donc sujets à la complaisance et à
l’erreur.
Nous ne nous adonnerions à la discussion que parce qu’elle nous conforterait
dans ce que nous savons déjà ; et nous n’accepterions une vérité que parce qu’elle n’irait
pas à l’encontre de ce que nous sommes et de ce que nous pensons.
Mais rechercher la
vérité, n’est-ce pas toujours penser contre soi-même, et contre la pente naturelle à
idéaliser la réalité pour la rendre conforme à nos désirs ? La vérité vient limiter mon
désir, et cela sans lui opposer un autre désir.
Conclusion provisoire et transition6
Si la passion conduit à l’erreur, à l’excès, à l’aveuglement, au fanatisme, et si, au
contraire, la recherche de la vérité s’inscrit dans un conflit du sujet avec lui-même, et se
résout dans un rapport critique du sujet à lui-même, il reste néanmoins que cette
recherche possède toutes les caractéristiques d’une passion.
DEUXIÈME PARTIE (objections et réfutation de la thèse, élaboration et
argumentation de l’antithèse) : la recherche de la vérité est une passion parmi
d’autres, mais ce n’est pas une passion comme les autres
Si la recherche de la vérité est une passion, elle possède des conditions particulières
qui la distinguent des autres passions.
Correctement dirigée, nul aveuglement ou
fanatisme ne doit résulter de ses effets.
5
6
Les exemples sont ici proposés après les explications, à titre d’illustration.
La difficulté soulevée dans la transition doit permettre d’introduire la deuxième partie.
2
1) Le désir de vérité est un besoin impérieux
Pourquoi les hommes désirent-ils ardemment la vérité ? D’où vient cette
préoccupation ? Pourquoi vouloir soumettre le discours à l’épreuve de la réalité, et
préférer la vérité à l’erreur et à l’ignorance ? Pourquoi vouloir sortir du rêve, et prendre
en compte, dans le discours, l’ordre des choses ? Quelle est l’origine du désir de vérité ?
Nietzsche (1844–1900) répond à toutes ces questions que c’est la nécessité de s’adapter,
de survivre et d’assurer la coexistence des individus qui les poussent à faire attention à la
réalité.
Le désir de vérité n’est donc qu’une question de survie.
Cependant, on pourrait
affirmer le contraire et dire que la reconnaissance de cette nécessité vitale est déjà l’effet
de la capacité de l’homme à prendre en considération la réalité : ainsi, ce ne serait pas par
nécessité de s’adapter que les hommes feraient attention à la réalité, mais parce qu’ils
feraient attention à la réalité qu’ils seraient ensuite capables de s’y adapter.
Mais
l’originalité de l’analyse nietzschéenne est de montrer que le désir de vérité n’a pas pour
origine la raison mais un besoin vital, presque physiologique, de l’être humain.
2) Critique du présupposé du sujet
Dès lors, si la recherche de la vérité relève d’un besoin impérieux, elle peut prendre la
forme d’une passion.
Cette passion est-elle condamnable sans nuance ? Force....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Devoir Maison philosophie: : L’homme se reconnaît-il mieux dans le travail ou dans le loisir ?
- Philosophie: le bonheur s'oppose-t-il au devoir?
- cours philosophie raison et vérité
- Philosophie dissert sur la vérité et science - DM : Ce qui est vrai est-il toujours vérifiable ? (plan)
- Comment définir la recherche de la vérité en philosophie ?