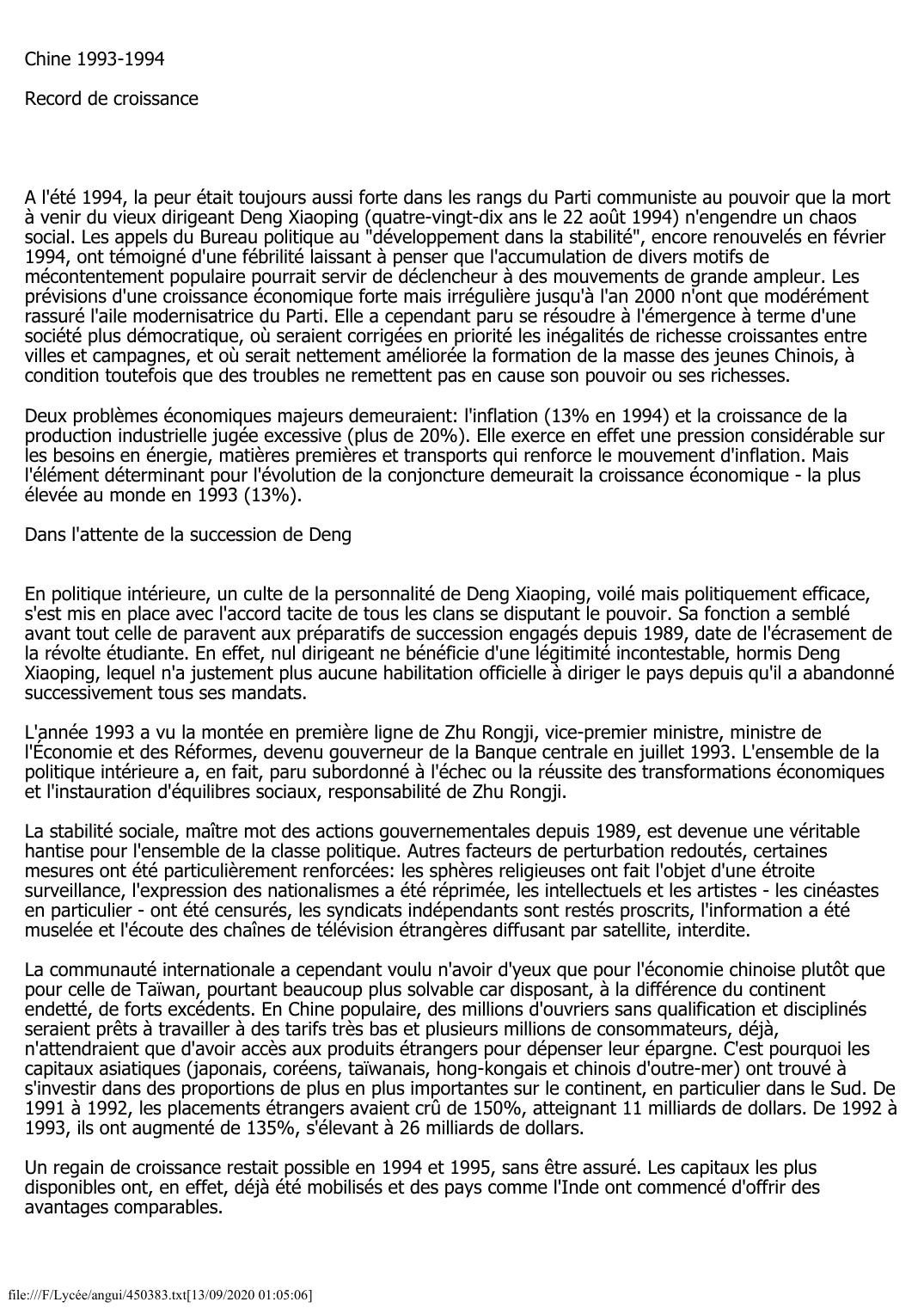Chine: 1993-1994 Record de croissance
Publié le 13/09/2020

Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Chine: 1993-1994 Record de croissance. Ce document contient 743 mots soit 2 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format PDF sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en: Histoire-géographie.
«
file:///F/Lycée/angui/450383.txt[13/09/2020 01:05:06]
Chine 1993-1994
Record de croissance
A l'été 1994, la peur était toujours aussi forte dans les rangs
du Parti communiste au pouvoir que la mort
à venir du vieux dirigeant Deng Xiaoping (quatre-vingt-dix ans le 22
août 1994) n'engendre un chaos
social.
Les appels du Bureau politique au "développement dans la stab
ilité", encore renouvelés en février
1994, ont témoigné d'une fébrilité laissant à penser que
l'accumulation de divers motifs de
mécontentement populaire pourrait servir de déclencheur à des m
ouvements de grande ampleur.
Les
prévisions d'une croissance économique forte mais irrégulièr
e jusqu'à l'an 2000 n'ont que modérément
rassuré l'aile modernisatrice du Parti.
Elle a cependant paru se ré
soudre à l'émergence à terme d'une
société plus démocratique, où seraient corrigées en prior
ité les inégalités de richesse croissantes entre
villes et campagnes, et où serait nettement améliorée la format
ion de la masse des jeunes Chinois, à
condition toutefois que des troubles ne remettent pas en cause son pouvo
ir ou ses richesses.
Deux problèmes économiques majeurs demeuraient: l'inflation (13%
en 1994) et la croissance de la
production industrielle jugée excessive (plus de 20%).
Elle exerce
en effet une pression considérable sur
les besoins en énergie, matières premières et transports qui re
nforce le mouvement d'inflation.
Mais
l'élément déterminant pour l'évolution de la conjoncture dem
eurait la croissance économique - la plus
élevée au monde en 1993 (13%).
Dans l'attente de la succession de Deng
En politique intérieure, un culte de la personnalité de Deng Xiaop
ing, voilé mais politiquement efficace,
s'est mis en place avec l'accord tacite de tous les clans se disputant l
e pouvoir.
Sa fonction a semblé
avant tout celle de paravent aux préparatifs de succession engagés
depuis 1989, date de l'écrasement de
la révolte étudiante.
En effet, nul dirigeant ne bénéficie d
'une légitimité incontestable, hormis Deng
Xiaoping, lequel n'a justement plus aucune habilitation officielle à
diriger le pays depuis qu'il a abandonné
successivement tous ses mandats.
L'année 1993 a vu la montée en première ligne de Zhu Rongji, vi
ce-premier ministre, ministre de
l'Économie et des Réformes, devenu gouverneur de la Banque central
e en juillet 1993.
L'ensemble de la
politique intérieure a, en fait, paru subordonné à l'échec o
u la réussite des transformations économiques
et l'instauration d'équilibres sociaux, responsabilité de Zhu Rong
ji.
La stabilité sociale, maître mot des actions gouvernementales depu
is 1989, est devenue une véritable
hantise pour l'ensemble de la classe politique.
Autres facteurs de pertu
rbation redoutés, certaines
mesures ont été particulièrement renforcées: les sphères
religieuses ont fait l'objet d'une étroite
surveillance, l'expression des nationalismes a été réprimée,
les intellectuels et les artistes - les cinéastes
en particulier - ont été censurés, les syndicats indépendant
s sont restés proscrits, l'information a été
muselée et l'écoute des chaînes de télévision étrangè
res diffusant par satellite, interdite.
La communauté internationale a cependant voulu n'avoir d'yeux que pou
r l'économie chinoise plutôt que
pour celle de Taïwan, pourtant beaucoup plus solvable car disposant,
à la différence du continent
endetté, de forts excédents.
En Chine populaire, des millions d'ou
vriers sans qualification et disciplinés
seraient prêts à travailler à des tarifs très bas et plusieu
rs millions de consommateurs, déjà,
n'attendraient que d'avoir accès aux produits étrangers pour dé
penser leur épargne.
C'est pourquoi les
capitaux asiatiques (japonais, coréens, taïwanais, hong-kongais e
t chinois d'outre-mer) ont trouvé à
s'investir dans des proportions de plus en plus importantes sur le conti
nent, en particulier dans le Sud.
De
1991 à 1992, les placements étrangers avaient crû de 150%, atte
ignant 11 milliards de dollars.
De 1992 à
1993, ils ont augmenté de 135%, s'élevant à 26 milliards de dol
lars.
Un regain de croissance restait possible en 1994 et 1995, sans être a
ssuré.
Les capitaux les plus
disponibles ont, en effet, déjà été mobilisés et des pays
comme l'Inde ont commencé d'offrir des
avantages comparables..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Zambie: 1993-1994
- Wallis et Futuna (1993-1994)
- Trinidad et Tobago (1993-1994)
- Taïwan (1993-1994)
- Thaïlande (1993-1994): Recherche d'une nouvelle respectabilité