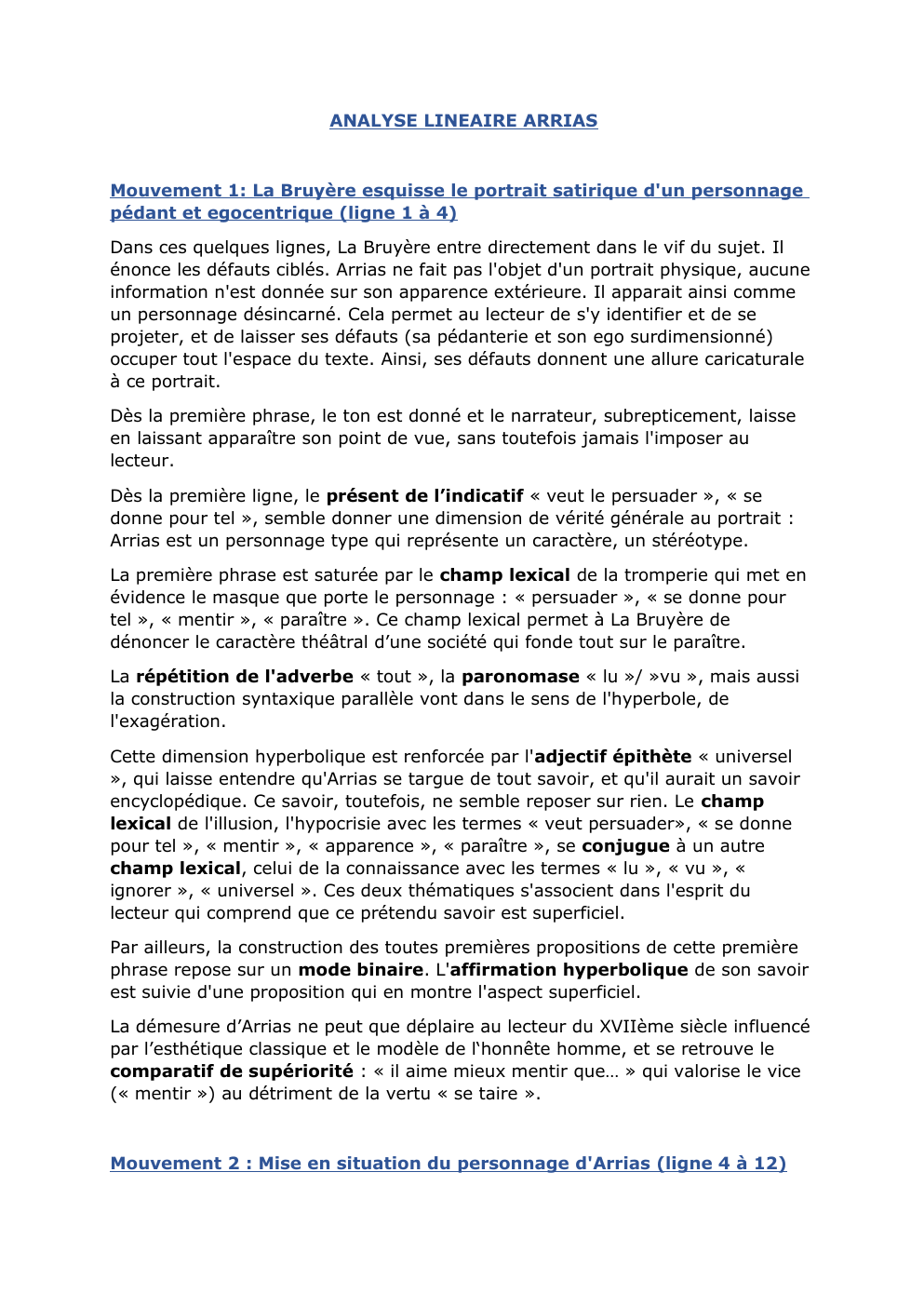analyse linéaire Arrias
Publié le 21/07/2025
Extrait du document
«
ANALYSE LINEAIRE ARRIAS
Mouvement 1: La Bruyère esquisse le portrait satirique d'un personnage
pédant et egocentrique (ligne 1 à 4)
Dans ces quelques lignes, La Bruyère entre directement dans le vif du sujet.
Il
énonce les défauts ciblés.
Arrias ne fait pas l'objet d'un portrait physique, aucune
information n'est donnée sur son apparence extérieure.
Il apparait ainsi comme
un personnage désincarné.
Cela permet au lecteur de s'y identifier et de se
projeter, et de laisser ses défauts (sa pédanterie et son ego surdimensionné)
occuper tout l'espace du texte.
Ainsi, ses défauts donnent une allure caricaturale
à ce portrait.
Dès la première phrase, le ton est donné et le narrateur, subrepticement, laisse
en laissant apparaître son point de vue, sans toutefois jamais l'imposer au
lecteur.
Dès la première ligne, le présent de l’indicatif « veut le persuader », « se
donne pour tel », semble donner une dimension de vérité générale au portrait :
Arrias est un personnage type qui représente un caractère, un stéréotype.
La première phrase est saturée par le champ lexical de la tromperie qui met en
évidence le masque que porte le personnage : « persuader », « se donne pour
tel », « mentir », « paraître ».
Ce champ lexical permet à La Bruyère de
dénoncer le caractère théâtral d’une société qui fonde tout sur le paraître.
La répétition de l'adverbe « tout », la paronomase « lu »/ »vu », mais aussi
la construction syntaxique parallèle vont dans le sens de l'hyperbole, de
l'exagération.
Cette dimension hyperbolique est renforcée par l'adjectif épithète « universel
», qui laisse entendre qu'Arrias se targue de tout savoir, et qu'il aurait un savoir
encyclopédique.
Ce savoir, toutefois, ne semble reposer sur rien.
Le champ
lexical de l'illusion, l'hypocrisie avec les termes « veut persuader», « se donne
pour tel », « mentir », « apparence », « paraître », se conjugue à un autre
champ lexical, celui de la connaissance avec les termes « lu », « vu », «
ignorer », « universel ».
Ces deux thématiques s'associent dans l'esprit du
lecteur qui comprend que ce prétendu savoir est superficiel.
Par ailleurs, la construction des toutes premières propositions de cette première
phrase repose sur un mode binaire.
L'affirmation hyperbolique de son savoir
est suivie d'une proposition qui en montre l'aspect superficiel.
La démesure d’Arrias ne peut que déplaire au lecteur du XVIIème siècle influencé
par l’esthétique classique et le modèle de l‘honnête homme, et se retrouve le
comparatif de supériorité : « il aime mieux mentir que… » qui valorise le vice
(« mentir ») au détriment de la vertu « se taire ».
Mouvement 2 : Mise en situation du personnage d'Arrias (ligne 4 à 12)
Après avoir esquissé les premiers traits du portrait d'Arrias, La Bruyère le met en
action, puisqu'il le met dans une situation, qui ne fera que confirmer sur le mode
de l'expérience, les traits de caractère déjà énoncés.
Là encore, nous voyons que le moraliste installe le lecteur dans une posture
d'observateur, et le laisse à même de juger.
Il l'accompagne, sans jamais
imposer son point de vue.
Arrias se retrouve donc à la table d'un Grand, ce qui
sera l'occasion de se montrer pédant, égocentrique, et même grossier.
On observe tout d'abord l'absence de repères spatiaux temporels.
Le lecteur
n'en sait pas beaucoup sur les circonstances de la situation.
Cet univers
désincarné, qui rappelle celui des fables, laissera ainsi le loisir aux défauts
d'Arrias de s'épanouir.
Ainsi, on remarque par exemple que les quelques indices
dont nous disposons sont précédés d'articles indéfinis « une cour », « un grand
», « une région ».
Cette indétermination donne des allures de fable à ce qui va
être dit et octroie une dimension apologétique à cette saynète.
Les convives, par ailleurs, ne sont quant à eux jamais nommés.
Ils sont tout
juste désignés par le pronom personnel sujet à la 3e personne du pluriel «
ils ».
L'hôte, quant a lui simplement désigné par la périphrase imprécise « un
grand ».
Une façon de renforcer l'aspect désincarné des personnages, mais
surtout, une manière de montrer comme ceux-ci « ne comptent pas », qu'ils ne
sont que des figurants, et sont inexistants face à l'égo d'Arrias, qui seul nom
prononcé.
Aussi, on remarque que le champ lexical de la parole « parle », « parole » «
dire », « discours », « récité », « historiettes » sature l'espace textuel.
Une façon
de signifier au lecteur combien notre personnage monopolise la parole, en
étalant ses connaissances.
Ces connaissances sont bien sûr superficielles et approximatives, puisqu'il récite
des « historiettes », ce qui laisse place à une dimension fictive avec le préfixe –
ette, et qu'il ne dépasse pas le niveau de l'anecdote.
Les propositions juxtaposées, le champ lexical de la parole témoigne
toutefois d'une habileté, puisque sait se montrer volubile, et parler pour ne pas
dire grand-chose.
Ces propositions, courtes, juxtaposées s'enchainent et
s'accumulent, mimant formellement une superposition de savoirs supposés, aussi
brefs que superficiels, et dénués de liens logiques, prononcés de manière
presque mécanique.
Par ailleurs, l'ensemble des propositions commence par le pronom personnel
sujet à la 3e personne du singulier « il », ce qui témoigne de l'hyper-présence
de son égo démesuré, puisqu'il est au centre de toute action.
Par son comportement, se dessine en filigrane, le portrait de l'anti-honnête
homme : Arrias se montre vaniteux quand l’honnête homme sait se faire discret
et mesuré.
Il est égocentrique alors que l'honnête homme s'emploie à mettre en
valeur son interlocuteur, Arrias prend la parole sans jamais la laisser aux autres,
quant l’honnête homme manie l'art de la conversation.
Il bafoue toutes les règles
de bienséance, n'hésitant pas à interrompre autrui, ou encore à rire de ses
propres plaisanteries.
Il se montre par ailleurs volontiers grossier, puisqu'il
aborde à table la question des « femmes du pays ».
Mouvement 3 : Chute de la saynète et d’Arrias : révélation des
mensonges d’Arrias (ligne 12 à15)
Un élément perturbateur, désigné par le pronom indéfini « quelqu'un », qui
reflète encore une fois le caractère anonyme de tout ceux entourent Arrias, vient
interrompre la logorrhée verbale de notre personnage.
Cette intervention est
mentionnée de manière brève et efficace, ce qui contraste avec le flot de
paroles débité par Arrias.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse linéaire #3 – Arrias Les Caractère – La bruyère
- Analyse linéaire Théodote, La Bruyère
- Préparation à l’oral du baccalauréat de français Analyse linéaire n°4 - Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, 1990 (épilogue)
- Objet d'étude : La poésie du XIX et du XX siècle. Parcours complémentaire : Alchimie poétique : réinventer le monde. Analyse linéaire 2/2 « Le Pain », Francis Ponge, Le Parti pris des choses, 1942
- Analyse linéaire Venus Anadyomène