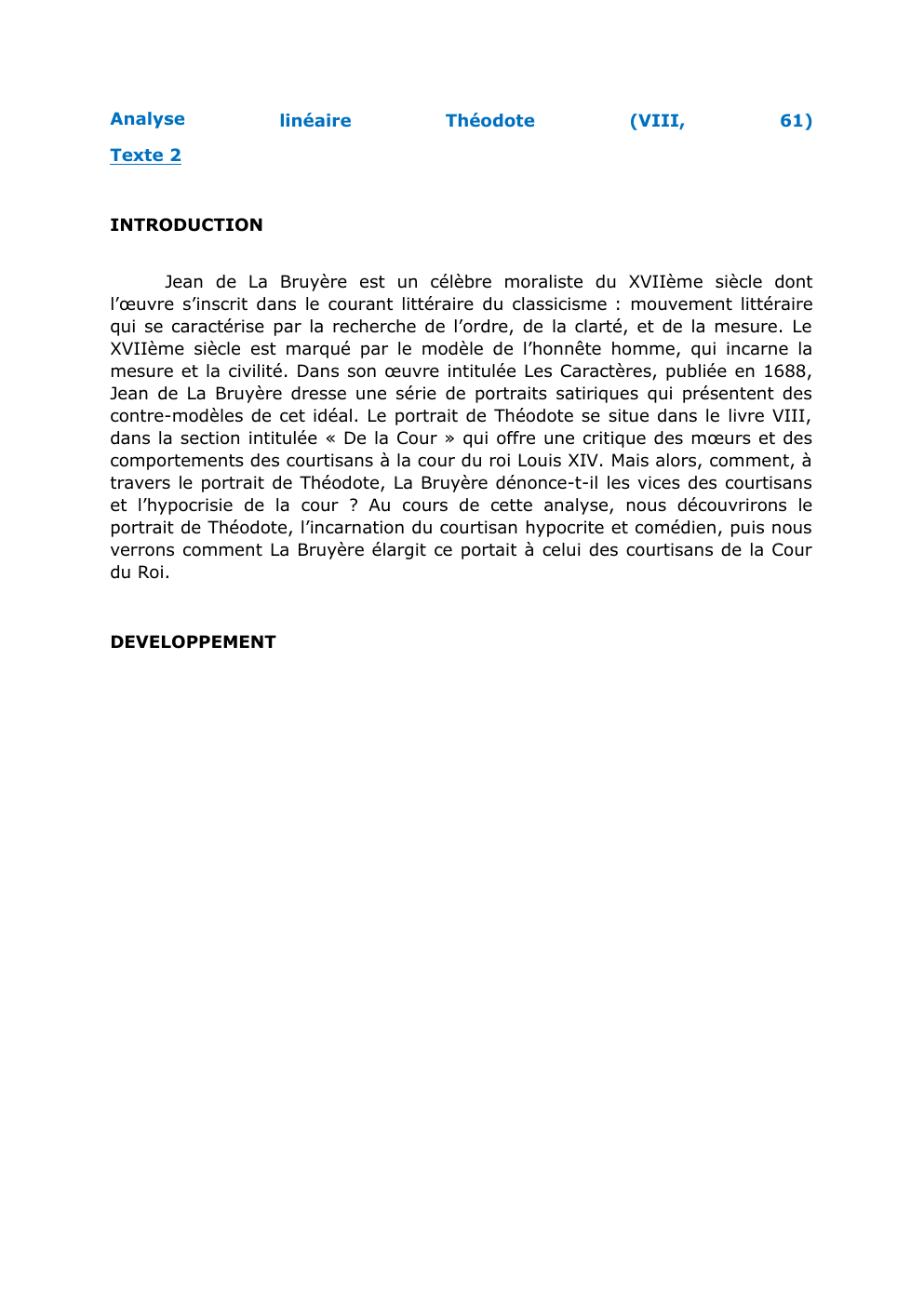Analyse linéaire Théodote, La Bruyère
Publié le 02/11/2025
Extrait du document
«
Analyse
linéaire
Théodote
(VIII,
61)
Texte 2
INTRODUCTION
Jean de La Bruyère est un célèbre moraliste du XVIIème siècle dont
l’œuvre s’inscrit dans le courant littéraire du classicisme : mouvement littéraire
qui se caractérise par la recherche de l’ordre, de la clarté, et de la mesure.
Le
XVIIème siècle est marqué par le modèle de l’honnête homme, qui incarne la
mesure et la civilité.
Dans son œuvre intitulée Les Caractères, publiée en 1688,
Jean de La Bruyère dresse une série de portraits satiriques qui présentent des
contre-modèles de cet idéal.
Le portrait de Théodote se situe dans le livre VIII,
dans la section intitulée « De la Cour » qui offre une critique des mœurs et des
comportements des courtisans à la cour du roi Louis XIV.
Mais alors, comment, à
travers le portrait de Théodote, La Bruyère dénonce-t-il les vices des courtisans
et l’hypocrisie de la cour ? Au cours de cette analyse, nous découvrirons le
portrait de Théodote, l’incarnation du courtisan hypocrite et comédien, puis nous
verrons comment La Bruyère élargit ce portait à celui des courtisans de la Cour
du Roi.
DEVELOPPEMENT
Premier mouvement : Ligne 1 à 9 : La Bruyère esquisse le portait de
Théodote, qui est l’incarnation du courtisan comédien.
On observe une antithèse à la ligne 1 : austère/comique, qui établit un
contraste entre la sévérité de l’habit et l’expression comique de son visage ; ce
qui illustre un double aspect de la personnalité de Théodote.
On observe ensuite, une entrée en scène théâtralisée : en effet, on peut relever
le champ lexical du théâtre avec les mots « comique » « scène » « voix »
« démarche » « geste » « attitude ».
L’effet de l’utilisation de ce champ lexical
est renforcé par l’emploi du présent dans la première ligne « qui entre sur la
scène », qui donne l’impression d’être une didascalie, une indication scénique.
Les didascalies portent sur les mimiques, la voix, le déplacement sur scène
comme on l’a vu avec les termes « voix » « démarche » « geste » « attitude ».
Cette théâtralisation apparaît superficielle et sur jouée.
Théodote s’invente un personnage pour donner du sens à son existence au sein
de la cour, où l’apparence est primordiale.
On peut déjà bien voir que Théodote
est un personnage au caractère théâtral.
On observe l’emploi de quatre
adjectifs qualificatifs à la suite « fin, cauteleux, doucereux, mystérieux » qui
vont nourrir l’existence du personnage et le faire prendre une place.
Le portrait
physique est complété par une description de son tempérament, ce qui vient
confirmer les zones d’ombres aperçues auparavant.
Ce personnage intrigue par
son attitude étrange, en utilisant une fausse douceur et une prudence excessive,
tout en cachant ses véritables intentions derrière des apparences trompeuses.
Ces quatre attributs du sujet présentent Théodote comme un personnage
hypocrite, rusé et fourbe.
L’assonance en « eux » traduit une forme
d’hésitation, ce qui crée un sentiment de doute et d’attente.
On est dans
l’expectative de la suite.
De plus, ces quatre adjectifs sont formés de trois
syllabes, ce qui ralentit le rythme qui devient alors ternaire du texte et crée
du suspense.
On peut même penser aux 3 coups de bâton frappés avant le début
d’une pièce qui installe le suspense.
Par la suite, La Bruyère donne la parole à Théodote, ce qui vient intensifier le
mystère qui l’entoure.
On est vite déçu au vu de l’intervention de ce dernier qui
va parler de la météo.
On voit donc bien que Théodote dramatise vainement ses
propos plein de vacuité, qui sont en réalité banals à travers l’emploi du
présentatif « voilà » qui donne un aspect emphatique et anaphorique.
On
observe un parallélisme également avec les propositions : « voilà un beau
temps, voilà un grand dégel », ce qui rend le propos redondant et répétitif.
En
effet, celui-ci est vide, mais dramatisé.
A présent, on a une vision des actions de Théodote qui confirment le double jeu
auquel il se livre.
L’antithèse entre « petites » et « grandes » manières, nous
montre qu’après tout, malgré ses simagrées, Théodote n’est qu’un petit
courtisan.
Il ne joue pas encore dans la cour des Grands, dans les deux sens du
terme.
Plus loin, il est comparé à une « jeune précieuse ».
On comprend la
sophistication extrême des manières de ce courtisan qui est très maniéré.
Par ailleurs, Théodote est infantilisé et rendu puéril.
En effet, on le compare à
un enfant qui élève un château de cartes et qui saisit des papillons.
Il joue la
comédie tout en s’amusant et en recherchant les faveurs.
Les termes « cartes »
et « papillon » renvoient une idée de légèreté, d’innocence, d’actions éphémères.
Les expressions « affaire de rien » « château de cartes » « papillons »
contrastent avec l’idée de mystère, de sérieux, et de fourberie qui entoure
Théodote et qu’on relève avec le champ lexical de l’importance, du sérieux avec
les termes « capital » « sérieusement » « application ».
Cette pointe d’ironie
vient ridiculiser Théodote, si impliqué dans sa comédie.
La Cour est un endroit où
l’on fait croire que l’on est investi et impliqué.
Deuxième mouvement : Ligne 9 à 16 : La Bruyère élargit le portrait de
Théodote à celui, plus général, de tous les courtisans qui sont follement
obsédés par l’obtention de faveurs.
On observe ici un élargissement et une généralisation du propos de La Bruyère à
tous les courtisans, qui sont obsédés par la faveur jusqu’à la folie.
Pour eux, c’est le
seul moyen d’exister sur l’échiquier social.
Tous les gestes, mots, pensées sont
soumis à ce but ultime, qui tourne à une obsession quasi-pathologique.
Le passage
s’ouvre avec à la ligne 9, du pluriel « les gens » ainsi qu’avec le pronom
personnel sujet à la 3e personne du pluriel « ils » qui englobent maintenant les
courtisans de façon générale.
Ils sont décrits comme étant fous, obsédés, aliénés « enivrés » « ensorcelés ».
Ils
ont perdu la raison et apparaissent comme des courtisans déshumanisés,
mécaniques qui agissent automatiquement, comme s’ils étaient déjà programmés.
Ils ne sont plus maîtres d’eux-mêmes et ne sont conduits que par leurs passions.
La
place au choix et à la réflexion n’existe plus.
Cette idée se justifie avec la présence
de
couples
de
propositions
antithétiques
comme
« jour/nuit »
« montent/descendent » « sortent/rentrent » « rien à lui dire/ parlent ».
Ces
propositions sont juxtaposées par des points virgules, qui reflète bien l’absence de
liens logiques entre ces actions.
L’énumération des actions vides traduisent le
caractère absurde et automatique du comportement des courtisans, suggérant leur
aliénation face à la quête incessante de faveurs.
De plus, l’espace textuel est saturé d’actions, ce qui confirme le caractère
maniaque des courtisans qui ne croient exister qu’à travers leurs actions vaines,
répétitives et dénuées de sens.
Les antithèses à la ligne 10, « jour/nuit »
« montent/descendent » montrent que cette obsession occupe toutes les dimensions
qu’elles soient temporelles ou spatiales.
La répétition des mots « parlé » et « parlent » qui constitue un polyptote, souligne
non seulement la vacuité de leurs discours, mais aussi l’inconsistance de la
communication à la cour, où parler devient une fin....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- analyse linéaire remarque 74 livre VIII La bruyère
- Analyse linéaire #1 – Giton Les Caractère – La bruyère
- Analyse linéaire #3 – Arrias Les Caractère – La bruyère
- Fiche d'analyse linéaire : Les Caractères de la Bruyère
- Analyse Linéaire : Jean de la Bruyère, Les caractères, « De la cour », 62, 1688.