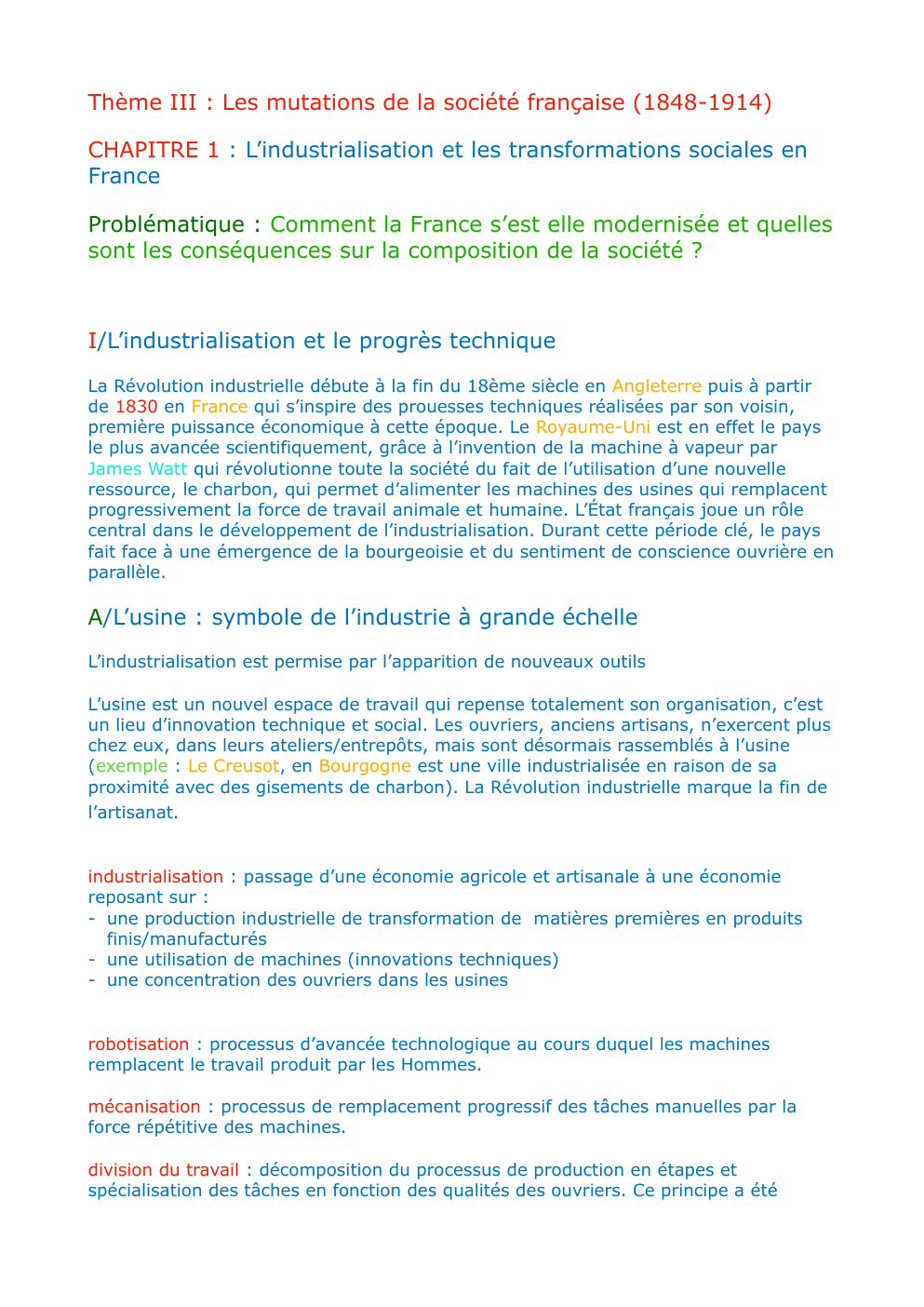Thème III : Les mutations de la société française (1848-1914) CHAPITRE 1 : L’industrialisation et les transformations sociales en France
Publié le 30/06/2025
Extrait du document
«
Thème III : Les mutations de la société française (1848-1914)
CHAPITRE 1 : L’industrialisation et les transformations sociales en
France
Problématique : Comment la France s’est elle modernisée et quelles
sont les conséquences sur la composition de la société ?
I/L’industrialisation et le progrès technique
La Révolution industrielle débute à la fin du 18ème siècle en Angleterre puis à partir
de 1830 en France qui s’inspire des prouesses techniques réalisées par son voisin,
première puissance économique à cette époque.
Le Royaume-Uni est en effet le pays
le plus avancée scientifiquement, grâce à l’invention de la machine à vapeur par
James Watt qui révolutionne toute la société du fait de l’utilisation d’une nouvelle
ressource, le charbon, qui permet d’alimenter les machines des usines qui remplacent
progressivement la force de travail animale et humaine.
L’État français joue un rôle
central dans le développement de l’industrialisation.
Durant cette période clé, le pays
fait face à une émergence de la bourgeoisie et du sentiment de conscience ouvrière en
parallèle.
A/L’usine : symbole de l’industrie à grande échelle
L’industrialisation est permise par l’apparition de nouveaux outils
L’usine est un nouvel espace de travail qui repense totalement son organisation, c’est
un lieu d’innovation technique et social.
Les ouvriers, anciens artisans, n’exercent plus
chez eux, dans leurs ateliers/entrepôts, mais sont désormais rassemblés à l’usine
(exemple : Le Creusot, en Bourgogne est une ville industrialisée en raison de sa
proximité avec des gisements de charbon).
La Révolution industrielle marque la fin de
l’artisanat.
industrialisation : passage d’une économie agricole et artisanale à une économie
reposant sur :
- une production industrielle de transformation de matières premières en produits
finis/manufacturés
- une utilisation de machines (innovations techniques)
- une concentration des ouvriers dans les usines
robotisation : processus d’avancée technologique au cours duquel les machines
remplacent le travail produit par les Hommes.
mécanisation : processus de remplacement progressif des tâches manuelles par la
force répétitive des machines.
division du travail : décomposition du processus de production en étapes et
spécialisation des tâches en fonction des qualités des ouvriers.
Ce principe a été
introduit par Henry Ford (un ingénieur/industriel américain, fondateur de la marque de
voiture Ford) auquel il a donné son nom : le fordisme (ou le taylorisme) qui permet de
produire des produits manufacturés à la chaîne, en masse et à bas coût.
usine : espace de travail où est concentré un grand nombre d’ouvriers.
Leur travail est
rationalisé : ils sont accompagnés de machines, répartis dans leurs tâches et soumis à
la discipline du patron.
usine : entrepôt généralement situé à proximité de gisements de charbon/mines dans
lequel on retrouve des machines.
Ce lieu d’innovation accueille des hommes ainsi que
des femmes voir même des enfants afin qu’ils travaillent à la chaîne, à la force de leur
bras ou en réalisant une tâche manuelle, dans le but de transformer de la matière
première en produits finis.
Les usines dont les machines fonctionnent pour la plupart au charbon, se développent
surtout au Nord et à l’Est du pays, au alentour des ressources (matières premières :
charbon, fer…) et par conséquent, proche des foyers miniers.
Les deux domaines les plus industrialisés sont le textile et la sidérurgie.
Un nouveau mode de rémunération voit le jour : les travailleurs ne sont plus payés à
la tâche mais à l’heure.
C’est le salariat.
Il y a une division genrée du travail.
Les femmes, peu diplômées/formées, occupent donc des postes/métiers qui requiert
peu ou pas de qualification.
Généralement, elles travaillent dans le secteur de
l’industrie textile (couture).
Les femmes font des tâches répétitives, peu valorisées et
moins bien rémunérées.
À l’inverse, les métiers des hommes ne sont pas manuels mais techniques et très
physiques voir même parfois dangereux (exemple : travail de métallurgie/fonderie au
contact de température extrême ou dans les mines).
En effet, les conditions de
travaille sont rudes (jusqu’aux Accords de Matignon de juin 1936) et ces derniers sont
exposés à de nombreux risques.
Les enfants, petits et minutieux travaillent également dans les usines et plus
particulièrement à la mine.
Les lois Ferry, rendant l’enseignement obligatoire et
gratuit pour tous, permettent de restreindre ce travail des enfants malgré le fait qu’il
existe toujours.
Certains émettent des critiques quant à la mécanisation car dorénavant ce sont les
machines, surnommées les « tueuses de bras », qui dominent les hommes.
B/Du « siècle du progrès » à la « Belle époque »
Les frères Émile et Isaac Pereire, sont de grands investisseurs bourgeois sous le
Second Empire.
Les innovations sur le plan technique se multiplie très largement.
Tout le progrès est au service de la guerre.
La société du 19ème siècle fait l’éloge de
la science et de l’industrie censées apporter le bonheur au monde en améliorant le
quotidien de l’Homme (exemple : les noms des différentes inventions sont renommées
de manière prestigieuse : « la fée éléctrique » pour l’électricité).
Le « positivisme »
apparait et est la « religion du progrès » selon Auguste Comte.
Aussi, se développe
tout un art/une fascination autour de l’exploration du monde à l’instar du roman de
Jules Verne : Le Tour du Monde en 80 jours.
Au travers des expositions universelles, émerge une volonté de montrer le prestige/la
gloire/la puissance culturelle/industrielle du pays et ainsi d’accroitre son rayonnement
mondial.
(exemple : la Tour Eiffel a été construite et inauguré spécialement pour cet
événement mondial auquel a participé 32 millions de personnes.
D/…et ses revers
Les ouvriers, en colère, s’engagent dans de plus en plus de grève et en abusent
parfois même.
Leur objectif, en rentrant dans un rapport de force, est de négocier
leurs conditions de travail ainsi que leur salaire.
Toutefois, ceux-ci se heurtent à une
violente répression.
Les réformes politiques ne parviennent pas à apaiser les tensions.
En 1870, au
Creusot, une grève générale de grande ampleur a lieu.
Le chaos règne à tel point que
des patrons sont assassinés.
Cette violence est illustrée par le roman de Louis Chevalier Classes laborieuses et
dangereuses.
En revanche, malgré ces mobilisations, beaucoup de grèves (1/3) sont des échecs.
Depuis 1889, le 1er mai est devenu la fête du travail, mais dans les petites cités
textiles, les ouvriers vivent encore dans la précarité, marquée par la crise économique
et le chômage.
C’est alors que le 1er mai 1891, à Fourmies, dans le Nord de la France, une fusillade
éclate lors d’une manifestation pacifique pour de meilleures conditions de travail.
Ce
jour-là, l’armée tire sur la foule : 9 personnes sont tuées.
Cet événement choque
profondément le pays et marque durablement le mouvement ouvrier.
Des penseurs
comme Paul Lafargue, auteur du Droit à la paresse, soutiennent alors les luttes
sociales.
I/La question sociale : une préoccupation sincère ?
A/Les usines de l’industrialisation
B/Le Creusot : ville industrielle au service des ouvriers
Les artistes mettent en avant les conditions des pauvres (exemple : Gustave
Caillebotte Raboteurs de parquet, 1875 ou encore Des glaneuses, 1857 de JeanFrançois Millet).
Le prolétariat est montré par les intellectuels car cette classe sociale
ne prend pas beaucoup la parole.
Certains patrons sont touchés par les conditions de vie des prolétaires et
interviennent.
La famille Scheinder a fondé le Creusot et y a rassemblé tous les ouvriers et usines.
Ils sont même devenus les dirigeants de la ville.
Les ouvriers sont logés dans par leur patron : la famille Schneider.
Au départ dans les
années 1845, ils résident dans de grands bâtiments (des casernes) dans lesquels on
retrouve beaucoup de logements identiques.
Puis, 20 ans plus tard, on constate une
amélioration : désormais les salariés de cet empire familial habitent des logements
pavillonnaires mieux équipés.
Un des avantages, est que les ouvriers vivent directement sur leur lieu de travail, ce
qui réduit fortement le coût du logement (loyer à moindre prix) et supprime les
trajets.
Cela permet un gain de temps (une optimisation) et des dépenses moindres.
Mais cette situation présente aussi plusieurs inconvénients : ils sont exposés à la
pollution que rejettent les usines, soumis à une surveillance constante, tenus
d’assister à la messe, et doivent vivre dans des conditions de promiscuité, en
Bourgogne, sans accès aux loisirs.
La famille Schneider assure les besoins de logement, de la santé, de l'instruction, de
l'alimentation et de la sécurité sociale.
Schneider est un patron qui prend en compte le bien-être de ses employés.
Il prend
en charge leur logement, veille à leur instruction, se préoccupe de leur santé, leur
permet de manger et de se loger à bas prix ainsi que la garantit d’avoir une sécurité
sociale.
Ainsi, on peut qualifier Schneider de patron paternaliste apprécié par ses salariés qui
ont édifié une statue en son honneur.
La ville du Creusot est pensée pour l’optimisation.
paternalisme : politique d’un chef d’entreprise qui accorde des avantages sociaux à
ses salariés dans le but de renforcer son autorité auprès de ces derniers.
PAPA SCHNEIDER :
-optimise la ville du Creusot pour en tirer des bénéfices
-assure les besoins de ses salariés
-surveille ses travailleurs
On voit apparaître de plus en plus d’ouvriers et de moins en....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- HISTOIRE – CHAPITRE 2 Les transformations politiques, économiques et sociales de la France de 1848 à 1870
- Permanences et mutations de la société française jusqu'en 1914
- Les transformations politiques et sociales de la France de 1848 à 1870
- Les grandes transformations économiques et sociales de la France (1850-1914)
- Comment la société française évolue-t-elle entre 1848 et 1870