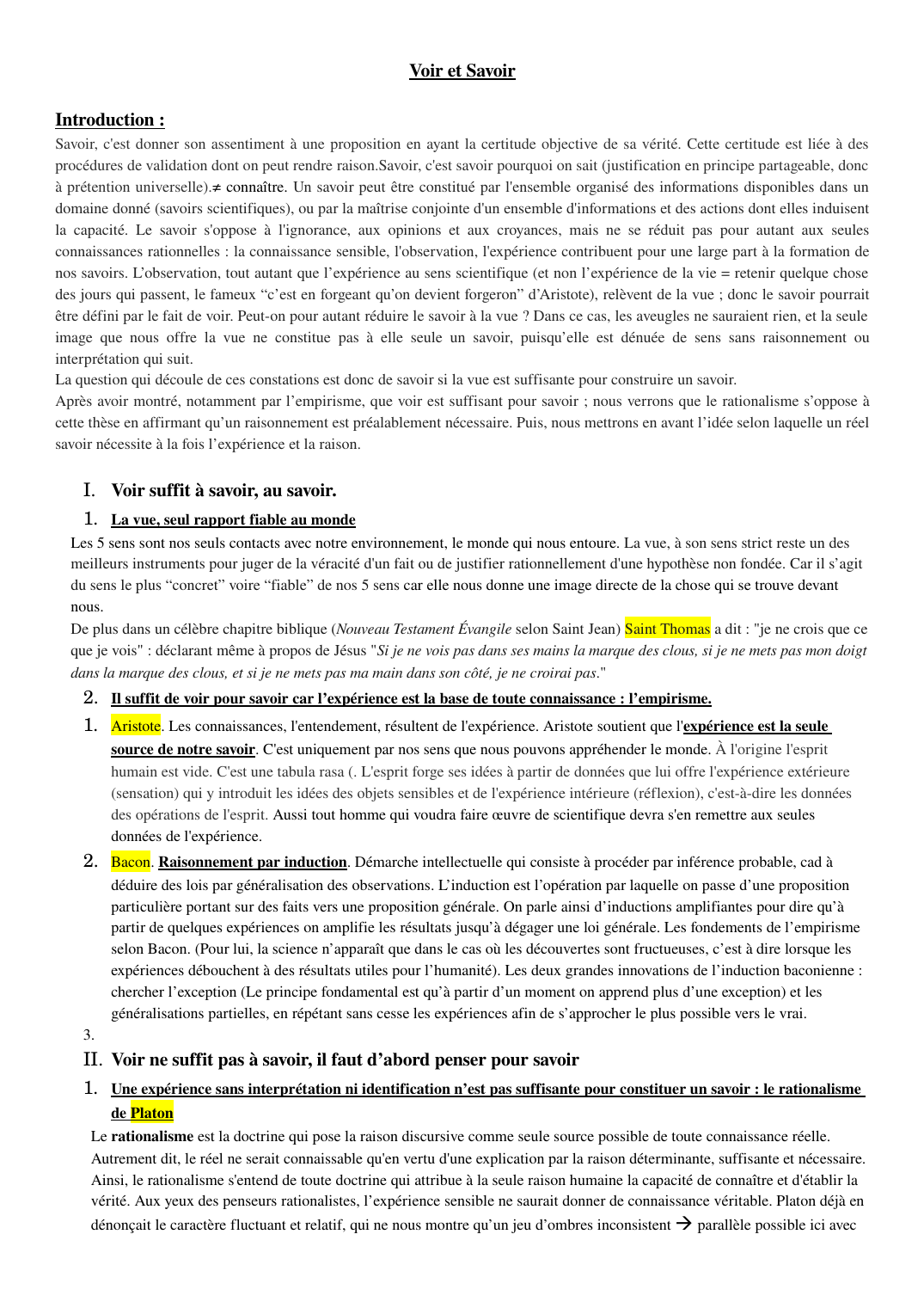theatre
Publié le 22/05/2020

Extrait du document
«
Voir et Savoir
Introduction :
Savoir, c'est donner son assentiment à une proposition en ayant la certitude objective de sa v érité. Cette certitude est li ée à des
proc
édures de validation dont on peut rendre raison.Savoir, c'est savoir pourquoi on sait (justification en principe partageable, donc
à
pr étention universelle).
≠ conna ître.
Un savoir peut être constitu é par l'ensemble organis é des informations disponibles dans un
domaine donn
é (savoirs scientifiques), ou par la ma îtrise conjointe d'un ensemble d'informations et des actions dont elles induisent
la capacit
é.
Le savoir s'oppose à l'ignorance, aux opinions et aux croyances, mais ne se r éduit pas pour autant aux seules
connaissances rationnelles : la connaissance sensible, l'observation, l'exp
érience contribuent pour une large part à la formation de
nos savoirs. L’observation, tout autant que l’exp
érience au sens scientifique (et non l’exp érience de la vie = retenir quelque chose
des jours qui passent, le fameux “c’est en forgeant qu’on devient forgeron” d’Aristote), rel
èvent de la vue ; donc le savoir pourrait
ê
tre d éfini par le fait de voir. Peuton pour autant r éduire le savoir à la vue ? Dans ce cas, les aveugles ne sauraient rien, et la seule
image que nous offre la vue ne constitue pas
à elle seule un savoir, puisqu’elle est d énuée de sens sans raisonnement ou
interpr
étation qui suit.
La question qui d
écoule de ces constations est donc de savoir si la vue est suffisante pour construire un savoir.
Apr
ès avoir montr é, notamment par l’empirisme, que voir est suffisant pour savoir ; nous verrons que le rationalisme s’oppose à
cette th
èse en affirmant qu’un raisonnement est pr éalablement n écessaire. Puis, nous mettrons en avant l’id ée selon laquelle un r éel
savoir n
écessite à la fois l’exp érience et la raison.
I.
Voir suffit
à savoir, au savoir.
1.
La vue, seul rapport fiable au monde
Les 5 sens sont nos seuls contacts avec notre environnement, le monde qui nous entoure. La vue,
à son sens strict reste un des
meilleurs instruments pour juger de la v
éracit é d'un fait ou de justifier rationnellement d'une hypoth èse non fond ée. Car il s’agit
du sens le plus “concret” voire “fiable” de nos 5 sens car elle nous donne une image directe de la chose qui se trouve devant
nous.
De plus dans un c
élèbre chapitre biblique ( Nouveau Testament Évangile selon Saint Jean) Saint Thomas a dit : "je ne crois que ce
que je vois" : d
éclarant m ême à propos de J ésus " Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt
dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son c
ôté, je ne croirai pas ."
2.
Il suffit de voir pour savoir car l’exp
érience est la base de toute connaissance : l’empirisme.
1.
Aristote . Les connaissances, l'entendement, r
ésultent de l'exp érience. Aristote soutient que l' exp érience est la seule
source de notre savoir . C'est uniquement par nos sens que nous pouvons appr
éhender le monde. À l'origine l'esprit
humain est vide. C'est une tabula rasa (. L'esprit forge ses id
ées à partir de donn ées que lui offre l'exp érience ext érieure
(sensation) qui y introduit les id
ées des objets sensibles et de l'exp érience int érieure (r éflexion), c'est àdire les donn ées
des op
érations de l'esprit. Aussi tout homme qui voudra faire œuvre de scientifique devra s'en remettre aux seules
donn
ées de l'exp érience.
2.
Bacon . Raisonnement par induction . D
émarche intellectuelle qui consiste à proc éder par inf érence probable, cad à
d
éduire des lois par g énéralisation des observations.
L’induction est l’op ération par laquelle on passe d’une proposition
particuli
ère portant sur des faits vers une proposition g énérale. On parle ainsi d’inductions amplifiantes pour dire qu’ à
partir de quelques exp
ériences on amplifie les r ésultats jusqu’ à dégager une loi g énérale. Les fondements de l’empirisme
selon Bacon. (Pour lui, la science n’appara
ît que dans le cas o ù les d écouvertes sont fructueuses, c’est à dire lorsque les
exp
ériences d ébouchent à des r ésultats utiles pour l’humanit é). Les deux grandes innovations de l’induction baconienne :
chercher l’exception (Le principe fondamental est qu’
à partir d’un moment on apprend plus d’une exception) et les
g
énéralisations partielles, en r épétant sans cesse les exp ériences afin de s’approcher le plus possible vers le vrai.
3.
II.
Voir ne suffit pas
à savoir, il faut d’abord penser pour savoir
1.
Une exp
érience sans interpr étation ni identification n’est pas suffisante pour constituer un savoir : le rationalisme
de Platon
Le rationalisme est la doctrine qui pose la raison discursive comme seule source possible de toute connaissance r
éelle.
Autrement dit, le r
éel ne serait connaissable qu'en vertu d'une explication par la raison d éterminante, suffisante et n écessaire.
Ainsi, le rationalisme s'entend de toute doctrine qui attribue
à la seule raison humaine la capacit é de conna ître et d' établir la
v
érité. Aux yeux des penseurs rationalistes, l’exp érience sensible ne saurait donner de connaissance v éritable. Platon d éjà en
d
énon çait le caract ère fluctuant et relatif, qui ne nous montre qu’un jeu d’ombres inconsistent parall èle possible ici avec .
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ELEMENTS D'HISTOIRE DU THEATRE : LE THEATRE ANTIQUE
- THEATRE & CINEMA: Les Bouffes-Parisiens (1855)
- THEATRE & CINEMA: Armande Béjart (Vers 1642-1700)
- THEATRE & CINEMA: Louis Jouvet (1887 - 1951)
- Le theatre