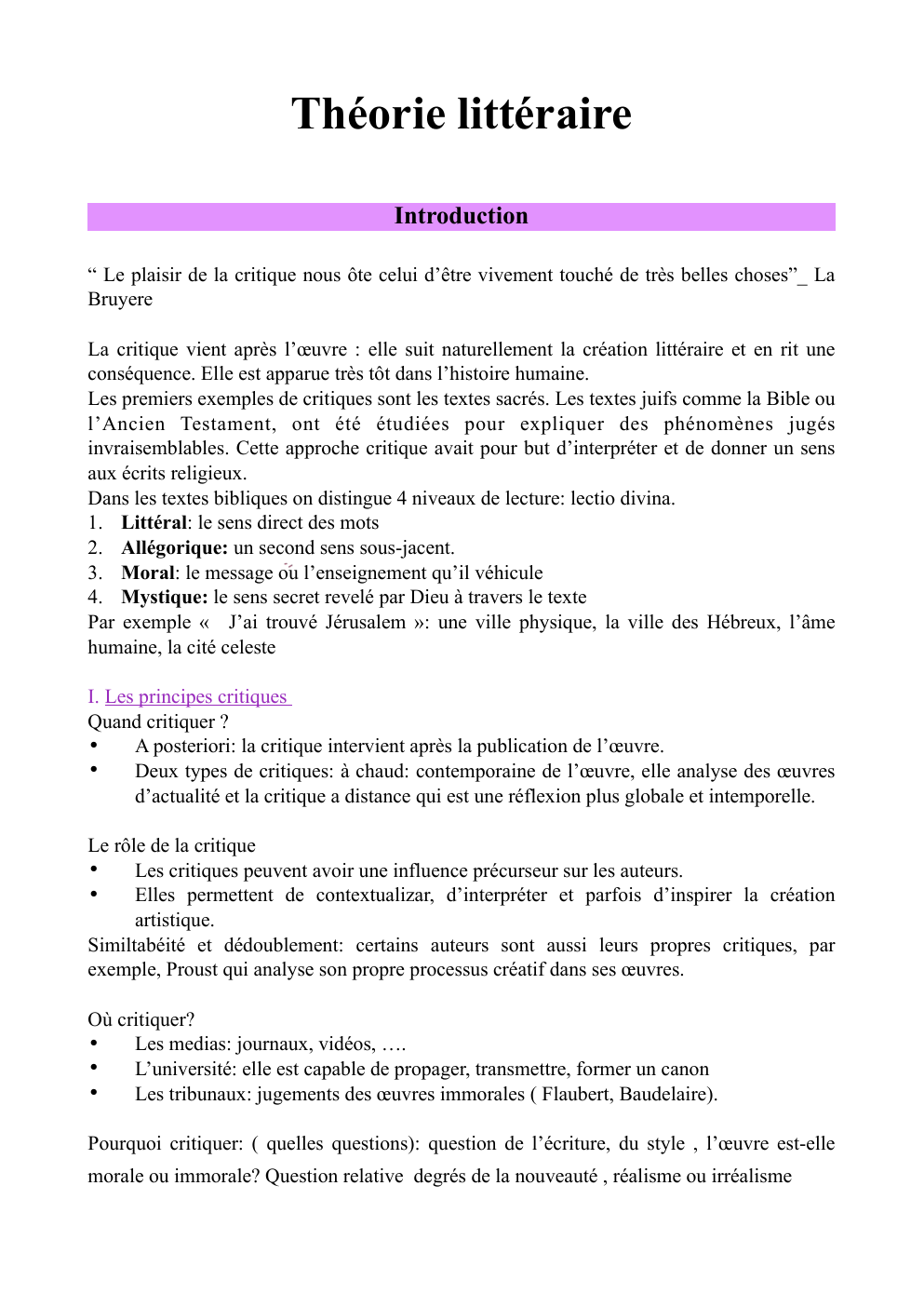stylistique - Théorie littéraire
Publié le 24/04/2025
Extrait du document
«
Théorie littéraire
Introduction
“ Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vivement touché de très belles choses”_ La
Bruyere
La critique vient après l’œuvre : elle suit naturellement la création littéraire et en rit une
conséquence.
Elle est apparue très tôt dans l’histoire humaine.
Les premiers exemples de critiques sont les textes sacrés.
Les textes juifs comme la Bible ou
l’Ancien Testament, ont été étudiées pour expliquer des phénomènes jugés
invraisemblables.
Cette approche critique avait pour but d’interpréter et de donner un sens
aux écrits religieux.
Dans les textes bibliques on distingue 4 niveaux de lecture: lectio divina.
1.
Littéral: le sens direct des mots
2.
Allégorique: un second sens sous-jacent.
3.
Moral: le message ou l’enseignement qu’il véhicule
4.
Mystique: le sens secret revelé par Dieu à travers le texte
Par exemple « J’ai trouvé Jérusalem »: une ville physique, la ville des Hébreux, l’âme
humaine, la cité celeste
I.
Les principes critiques
Quand critiquer ?
•
A posteriori: la critique intervient après la publication de l’œuvre.
•
Deux types de critiques: à chaud: contemporaine de l’œuvre, elle analyse des œuvres
d’actualité et la critique a distance qui est une réflexion plus globale et intemporelle.
Le rôle de la critique
•
Les critiques peuvent avoir une influence précurseur sur les auteurs.
•
Elles permettent de contextualizar, d’interpréter et parfois d’inspirer la création
artistique.
Similtabéité et dédoublement: certains auteurs sont aussi leurs propres critiques, par
exemple, Proust qui analyse son propre processus créatif dans ses œuvres.
Où critiquer?
•
Les medias: journaux, vidéos, ….
•
L’université: elle est capable de propager, transmettre, former un canon
•
Les tribunaux: jugements des œuvres immorales ( Flaubert, Baudelaire).
Pourquoi critiquer: ( quelles questions): question de l’écriture, du style , l’œuvre est-elle
morale ou immorale? Question relative degrés de la nouveauté , réalisme ou irréalisme
Juger une œuvre, expliquer, prescrire ( travail des journalistes)
II.
L’œuvre face à la critique
•
L’oeuvre vraie défie la critique : toute vraie création est imprévue et imprévisible et
unique on ne peut pas épuiser, qu’on ne peut pas finir d’étudier
•
Tout œuvre est autocritique: « toute forme sérieuse d’art, de musique, delittérature, est
un acte critique.
Autrement dit, un roman affirme une réflexion sur le roman ».
•
La premiere et la derniere critique de l’oeuvre est l’oeuvre elle même.
Toute œuvre
écrite est le commentaire de celle qui la précède.
Toute œuvre est une posture critique.
La critique fait évoluer m’œuvre, ele la maintient, elle contribue à la perpétuation de la
littérature
•
Œuvre? La critique est elle un genre ?
Tout auteur est un critique,
•
Les œuvres littéraires relèvent de l’art et d’un autre coté, la critique n’est pas un art, mais
une science.
« le critique, c’est un botaniste, moi, je suis un jardinier »
Le structuralisme
I.
Qu’est-ce que le structuralisme?
Le structuralisme est un courant intellectuel qui émerge au XXe siècle et qui s’applique à plusieurs
disciplines : la linguistique, l’anthropologie, la psychanalyse et bien sûr, la littérature.
L’idée principale du structuralisme est que tout texte (comme toute production humaine) repose sur
des structures sous-jacentes, qui organisent son sens.
Ces structures sont indépendantes de l’auteur
et du contexte historique : elles relèvent d’un système qui peut être étudié de manière objective.
II.
Origines et influences
Le structuralisme en littérature trouve son origine dans :
1.
La linguistique de Ferdinand de Saussure
• Il distingue la langue (système de signes partagé par une communauté) et la parole (usage
individuel du langage).
• Il montre que la signification repose sur des oppositions (ex.
: on comprend “nuit” parce qu’on
connaît “jour”).
2.
L’anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss
• Il analyse les mythes et les cultures en identifiant des structures universelles sous-jacentes.
• Exemple : tous les mythes reposent sur des oppositions fondamentales (nature/culture, vie/mort,
etc.).
3.
Le formalisme russe
• Des chercheurs comme Vladimir Propp ou Roman Jakobson ont analysé les textes littéraires en
identifiant leurs structures narratives et linguistiques.
Le structuralisme appliqué ces principes à la littérature: un texte n’est pas le fruit de la subjectivité
d’un auteur, mais le produit d’un système de règles et de structures qui organisent la narration et le
langage
III.
Les principes fondamentaux du structuralisme
1.
L’autonomie du texte
• Contrairement aux approches historiques ou biographiques, le structuralisme considère que le
texte se suffit à lui-même.
• Il faut l’analyser indépendamment de son auteur ou de son époque.
• Un roman de Balzac ne sera pas étudié pour comprendre la société du XIXe siècle, mais pour
identifier les structures qui sous-tendent son récit.
2.
L’étude des structures narratives
Le récit fonctionne selon des schémas récurrents et des règles précises.
Exemples :
• Vladimir Propp (Morphologie du conte, 1928) : il identifie 31 fonctions qui structurent les contes
(ex.
: “Le héros reçoit une mission”, “Il rencontre un adjuvant”, “Il affronte l’épreuve finale”).
• Algirdas Julien Greimas (Le carré sémiotique) : il analyse les récits à partir d’oppositions
fondamentales (ex.
: bien/mal, vie/mort).
3.
Le langage comme système
• Inspiré de Saussure, le structuralisme applique à la littérature l’idée que les mots et les phrases
n’ont de sens que dans un système de relations.
• Roland Barthes, dans S/Z, décompose une nouvelle de Balzac (Sarrasine) en unités minimales de
sens (lexies) et analyse comment elles interagissent pour produire du sens.
IV.
Les grands auteurs et leurs apports
1.
Roland Barthes (1915-1980)
Roland Barthes (1915-1980) oppose la notion d’“œuvre” à celle de “texte”.
Selon lui, l’œuvre est
un objet fini et clos, comme un livre imprimé, tandis que le texte est une structure ouverte qui
produit sans cesse du sens grâce à l’interaction avec le lecteur.
Dans S/Z, il analyse un texte en
montrant qu’il possède plusieurs niveaux de lecture et que le lecteur joue un rôle actif dans la
construction du sens.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les rêves d'Emma Bovary de Flaubert (analyse littéraire rédigée)
- James Gleick: la théorie du chaos
- Commentaire Littéraire, 14 de Jean Echenoz
- Commentaire Littéraire Rimbaud Ophélie
- Commentaire littéraire Montesquieu Esclavage de nègres