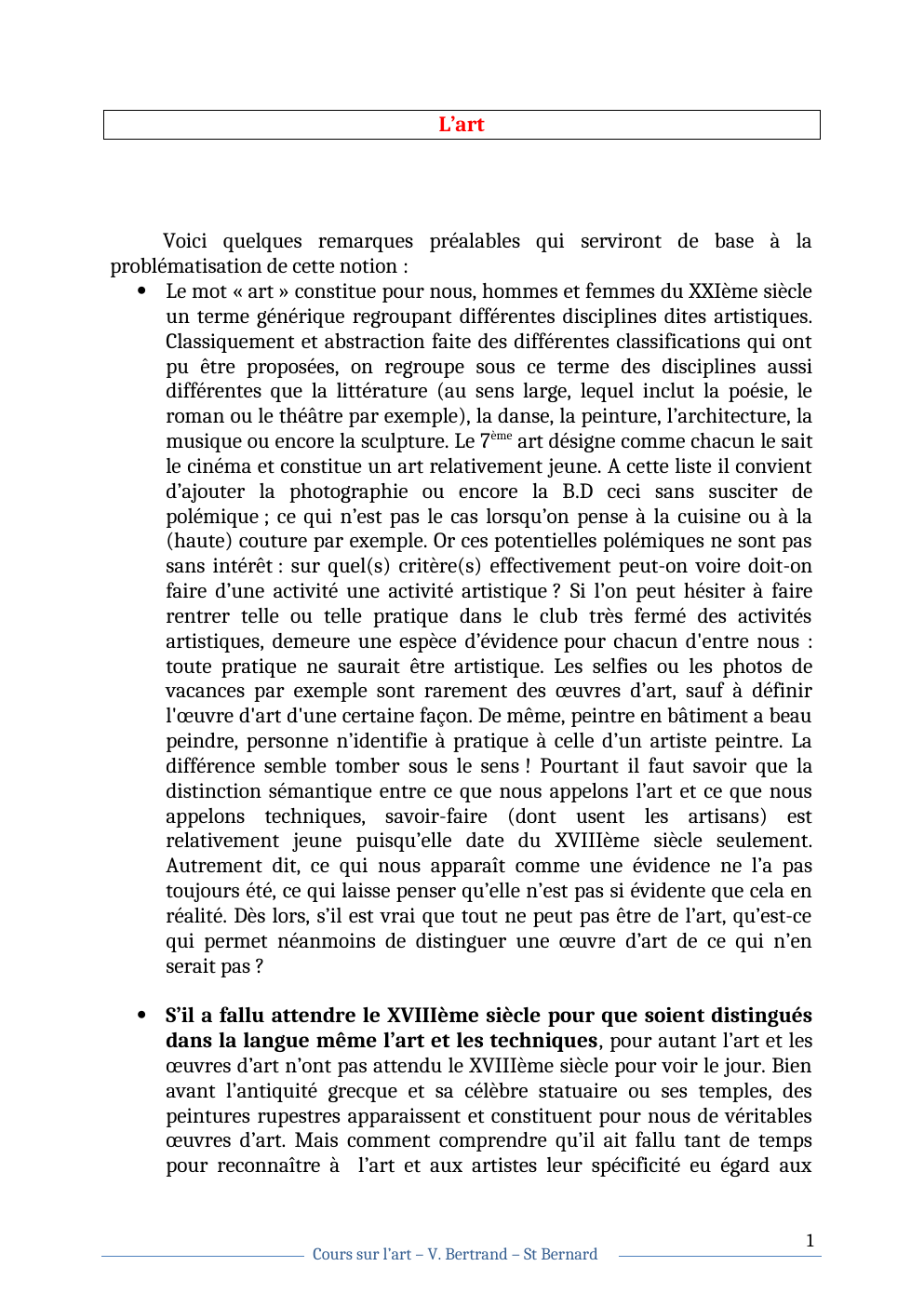philo- cours sur l'art
Publié le 20/04/2025
Extrait du document
«
L’art
Voici quelques remarques préalables qui serviront de base à la
problématisation de cette notion :
Le mot « art » constitue pour nous, hommes et femmes du XXIème siècle
un terme générique regroupant différentes disciplines dites artistiques.
Classiquement et abstraction faite des différentes classifications qui ont
pu être proposées, on regroupe sous ce terme des disciplines aussi
différentes que la littérature (au sens large, lequel inclut la poésie, le
roman ou le théâtre par exemple), la danse, la peinture, l’architecture, la
musique ou encore la sculpture.
Le 7ème art désigne comme chacun le sait
le cinéma et constitue un art relativement jeune.
A cette liste il convient
d’ajouter la photographie ou encore la B.D ceci sans susciter de
polémique ; ce qui n’est pas le cas lorsqu’on pense à la cuisine ou à la
(haute) couture par exemple.
Or ces potentielles polémiques ne sont pas
sans intérêt : sur quel(s) critère(s) effectivement peut-on voire doit-on
faire d’une activité une activité artistique ? Si l’on peut hésiter à faire
rentrer telle ou telle pratique dans le club très fermé des activités
artistiques, demeure une espèce d’évidence pour chacun d'entre nous :
toute pratique ne saurait être artistique.
Les selfies ou les photos de
vacances par exemple sont rarement des œuvres d’art, sauf à définir
l'œuvre d'art d'une certaine façon.
De même, peintre en bâtiment a beau
peindre, personne n’identifie à pratique à celle d’un artiste peintre.
La
différence semble tomber sous le sens ! Pourtant il faut savoir que la
distinction sémantique entre ce que nous appelons l’art et ce que nous
appelons techniques, savoir-faire (dont usent les artisans) est
relativement jeune puisqu’elle date du XVIIIème siècle seulement.
Autrement dit, ce qui nous apparaît comme une évidence ne l’a pas
toujours été, ce qui laisse penser qu’elle n’est pas si évidente que cela en
réalité.
Dès lors, s’il est vrai que tout ne peut pas être de l’art, qu’est-ce
qui permet néanmoins de distinguer une œuvre d’art de ce qui n’en
serait pas ?
S’il a fallu attendre le XVIIIème siècle pour que soient distingués
dans la langue même l’art et les techniques, pour autant l’art et les
œuvres d’art n’ont pas attendu le XVIIIème siècle pour voir le jour.
Bien
avant l’antiquité grecque et sa célèbre statuaire ou ses temples, des
peintures rupestres apparaissent et constituent pour nous de véritables
œuvres d’art.
Mais comment comprendre qu’il ait fallu tant de temps
pour reconnaître à l’art et aux artistes leur spécificité eu égard aux
Cours sur l’art – V.
Bertrand – St Bernard
1
techniques, aux savoir-faire des artisans ? Et qu’est-ce qui, par contre,
justifie pour nous une telle autonomie de l’art et des artistes* ? il
convient en effet de mesurer le chemin parcouru entre l’anonymat des
artistes au Moyen-Age et notre époque : de nos jours, le nom, la signature
semblent faire, seuls ou presque, la valeur des œuvres.
Or que doit être
une œuvre pour pouvoir être légitimement (et pas simplement
arbitrairement) qualifiée d’œuvre d’art ? S’il faut bien affronter la
question des critères c’est que de fait comme en droit, toute œuvre n’est
pas et ne peut pas être une œuvre d’art.
En effet, si toute œuvre de
l'art* peut être considérée comme une œuvre d’art* relativement aux
critères retenus selon les individus, alors aucune n’est à proprement
parler une œuvre d’art.
C’est le problème de tout relativisme* : rien ne
vaut objectivement.
Si nous nous accordons pour dire que toute œuvre
n’est pas, de ce fait, une œuvre d’art et qu’en outre, au sein même de ce
que nous reconnaissons comme des œuvres d’art, il existe des chefs
d’œuvres qui surplombent les autres, la question des critères se pose
effectivement au-delà des goûts des uns et des autres.
L’art contemporain
est d’autant plus intéressant à cet égard qu’il en désoriente plus d’un.
Deux anecdotes sont significatives à cet égard.
La première touche
L’oiseau dans l’espace de Brancusi.
A l’arrivée sur le sol des Etats Unis de
cette œuvre, le douanier va voir non une œuvre d’art mais un objet
utilitaire taxé à 40% de sa valeur ce qui est bien au-delà de la taxe à
laquelle sont soumises les œuvres d’art.
Ce n’est que six ans plus tard que
les tribunaux abonderont dans le sens de Brancusi et reconnaitront
officiellement à cette œuvre son statut d’œuvre d’art.
La mésaventure de
J.
de Beuys dit elle aussi le désarroi du public face à des œuvres d’art
contemporaines.
En effet, à la fin de la première journée de son
exposition à Beaubourg, une femme de ménage a consciencieusement
balayé et mis à la poubelle les déchets pourtant artistiquement déposés
sur le sol par l’artiste.
Manifestement cette dame n'avait pas vu que
c'était une œuvre d'art ! Ce désarroi n’est pas différent de celui qui
pourrait saisir la plupart d’entre nous en voyant la Fontaine de M.
Duchamp trôner au musée, en observant la Salade d’Anselmo, les Merdes
d’artiste de Manzoni ou le Piss’Christ de Serrano.
Que dire de Cloaca ?
Cette machine qui reproduit le processus de digestion et son résultat : la
production d’excrément, lequel constitue d'ailleurs l’œuvre à
proprement parler ici.
I - L’artiste artisan
1° Quelle spécificité de l’art ?
2
Cours sur l’art - V.
Bertrand - St Bernard
On peut distinguer avec Aristote trois types d’activité* (cf cours travail) :
La théoria ou la recherche et la contemplation du vrai
La praxis ou action.
Toute praxis est politique et ainsi spécifiquement
humaine dans la mesure où elle relève du bien vivre et ne saurai se
réduire à la recherche d’une fin extérieure, étrangère à l’activité ellemême.
La poiésis ou production dans laquelle la fin est extérieure à l’activité
(exple : fabriquer du pain pour le boulanger).
Elle est production de
réalités extérieures à celui qui les produit c’est-à-dire les fait exister.
Pour Aristote et pour les grecs en général puis pour les romains et pour des
siècles encore en occident en tout cas, ce que l’on appelle l’art est l’art de
l’artiste aussi bien que celui que nous appelons artisan.
En témoigne cette
phrase de Montaigne : « peintre, poète ou autre artisan ».
Le terme d’artiste, tel
qu’il est utilisé de nos jours, n’apparaît qu’en 1762.
De fait, la mot art lui-même
est un mot d’origine latine et non grecque : ars, quand le grec nous transmet le
mot techné terme qui désigne l’habileté, mot qui donnera le mot technique.
La
techné est ce qu’il s’agit de s’approprier, de maîtriser dans un art, quel qu’il soit
(art du médecin, du navigateur, du sculpteur…).
L’art est ainsi défini par
Aristote* comme disposition à produire accompagnée de règle droite.
L’art
désigne ainsi un savoir-faire au sens littéral du terme : la règle droite désignant
ce qui, contrairement au hasard ou à la chance qui peuvent permettre de
réussir quelque chose sans en maitriser la production, va permettre une
production efficace précisément parce que les règles de la production sont le
produit de la raison, faculté qui permet le savoir.
La réussite n’est pas une
affaire de chance ici mais le fait de la maitrise de son art (savoir-faire).
Cette indistinction sémantique originaire est intéressante et significative
d’une certaine conception de la nature de ce que nous appelons de nos jours
« activité artistique », « artiste » mais aussi de ce que nous concevons comme la
beauté.
Effectivement, le fait que pendant très longtemps, dans notre langue au
moins, nous n’avons pas jugé nécessaire de distinguer ce que nous appelons
l’art (de nos jours) de la technique signifie que durant tout ce temps, on a
conçu les activités de l’artisan et de l’artiste comme étant de même nature :
fondamentalement poïétiques, c’est-à-dire faisant appel à des savoir-faire, un
art (l’art étant principe d’existence distinct de la nature).
Cette
assimilation de l’artiste à l’artisan pourrait gêner un certain nombre d’entre
nous dans la mesure où il nous semble évident qu’un peintre en bâtiment ne
fait pas la même chose qu’un artiste peintre, que l’artiste peintre ne saurait se
contenter de mettre en œuvre des techniques, un savoir faire efficace à tout
coup.
Comment pourrait-il créer sinon ? Autre chose pourrait gêner : comment
considérer qu’une statue, une sonate, une tragédie sont comparables à une
baguette de pain, une maison ou une paire de chaussures même sur mesure !
Quand bien même la baguette de pain, la maison ou les chaussures pourraient
Cours sur l’art – V.
Bertrand – St Bernard
3
être l'œuvre de quelqu'un, les œuvres d'art ne semblent pas semblables aux
autres œuvres de nos mains.
Or, dans l’optique classique, il semble possible de distinguer parmi toutes les
œuvres de l’art humain, certaines œuvres que de nos jours nous appellerions
des œuvres d’art.
Comment ? Par la destination, le type de fin recherchée.
Le
mythe de Prométhée et Epiméthée écrit par Platon dans le Protagoras est
intéressant ici car il pose la destination de la technique : permettre aux
hommes de survivre.
« C'était le temps....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Cours sur l'art
- fiche révision bac philo art
- Cours de philo sur la conscience - Chapitre 1 : Que-ce qu’un sujet ?
- Cours sur l'art
- Cours sur l'art