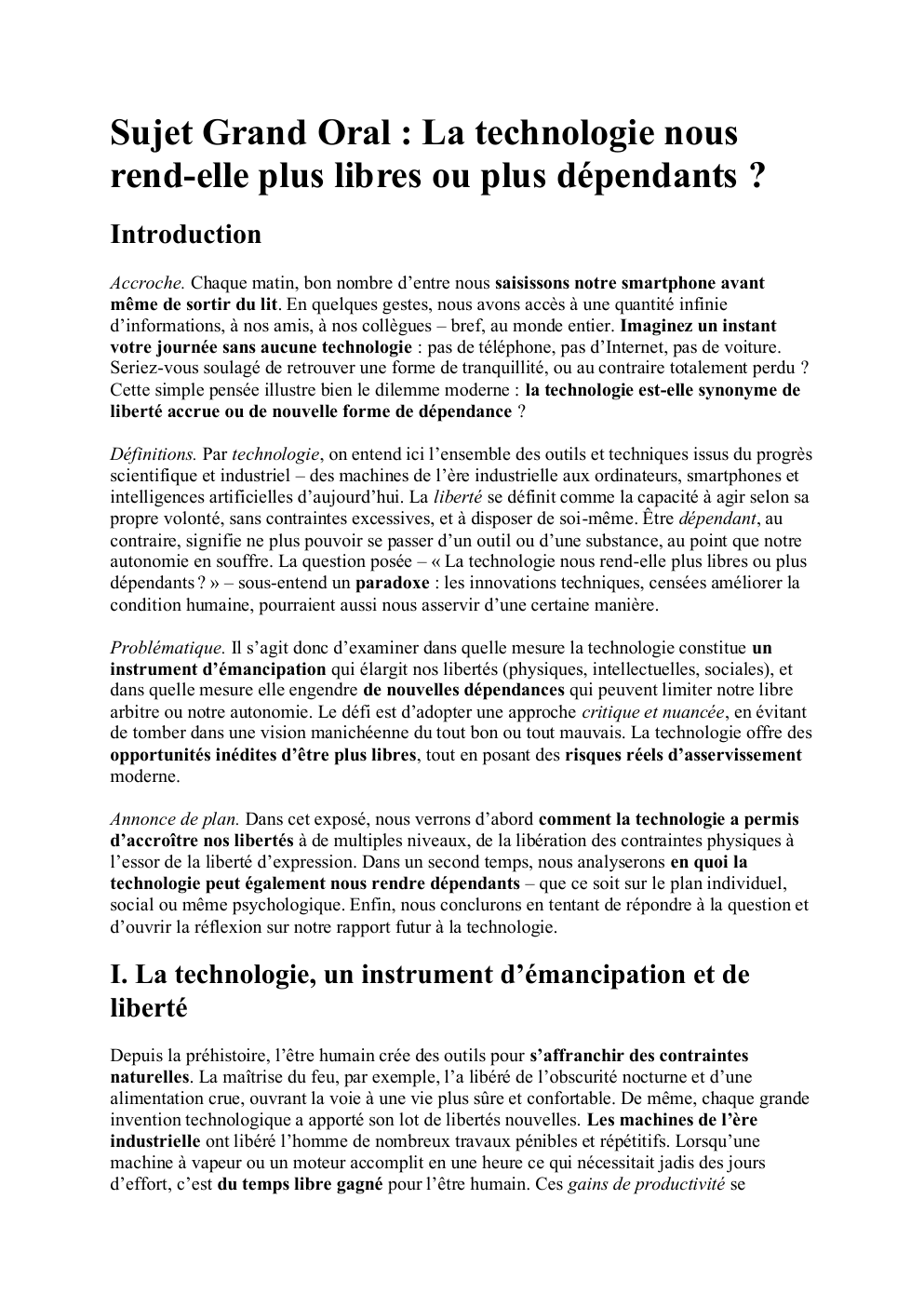Oral Bac : La technologie nous rend-elle plus libres ou plus dépendants ?
Publié le 21/04/2025
Extrait du document
«
Sujet Grand Oral : La technologie nous
rend-elle plus libres ou plus dépendants ?
Introduction
Accroche.
Chaque matin, bon nombre d’entre nous saisissons notre smartphone avant
même de sortir du lit.
En quelques gestes, nous avons accès à une quantité infinie
d’informations, à nos amis, à nos collègues – bref, au monde entier.
Imaginez un instant
votre journée sans aucune technologie : pas de téléphone, pas d’Internet, pas de voiture.
Seriez-vous soulagé de retrouver une forme de tranquillité, ou au contraire totalement perdu ?
Cette simple pensée illustre bien le dilemme moderne : la technologie est-elle synonyme de
liberté accrue ou de nouvelle forme de dépendance ?
Définitions.
Par technologie, on entend ici l’ensemble des outils et techniques issus du progrès
scientifique et industriel – des machines de l’ère industrielle aux ordinateurs, smartphones et
intelligences artificielles d’aujourd’hui.
La liberté se définit comme la capacité à agir selon sa
propre volonté, sans contraintes excessives, et à disposer de soi-même.
Être dépendant, au
contraire, signifie ne plus pouvoir se passer d’un outil ou d’une substance, au point que notre
autonomie en souffre.
La question posée – « La technologie nous rend-elle plus libres ou plus
dépendants ? » – sous-entend un paradoxe : les innovations techniques, censées améliorer la
condition humaine, pourraient aussi nous asservir d’une certaine manière.
Problématique.
Il s’agit donc d’examiner dans quelle mesure la technologie constitue un
instrument d’émancipation qui élargit nos libertés (physiques, intellectuelles, sociales), et
dans quelle mesure elle engendre de nouvelles dépendances qui peuvent limiter notre libre
arbitre ou notre autonomie.
Le défi est d’adopter une approche critique et nuancée, en évitant
de tomber dans une vision manichéenne du tout bon ou tout mauvais.
La technologie offre des
opportunités inédites d’être plus libres, tout en posant des risques réels d’asservissement
moderne.
Annonce de plan.
Dans cet exposé, nous verrons d’abord comment la technologie a permis
d’accroître nos libertés à de multiples niveaux, de la libération des contraintes physiques à
l’essor de la liberté d’expression.
Dans un second temps, nous analyserons en quoi la
technologie peut également nous rendre dépendants – que ce soit sur le plan individuel,
social ou même psychologique.
Enfin, nous conclurons en tentant de répondre à la question et
d’ouvrir la réflexion sur notre rapport futur à la technologie.
I.
La technologie, un instrument d’émancipation et de
liberté
Depuis la préhistoire, l’être humain crée des outils pour s’affranchir des contraintes
naturelles.
La maîtrise du feu, par exemple, l’a libéré de l’obscurité nocturne et d’une
alimentation crue, ouvrant la voie à une vie plus sûre et confortable.
De même, chaque grande
invention technologique a apporté son lot de libertés nouvelles.
Les machines de l’ère
industrielle ont libéré l’homme de nombreux travaux pénibles et répétitifs.
Lorsqu’une
machine à vapeur ou un moteur accomplit en une heure ce qui nécessitait jadis des jours
d’effort, c’est du temps libre gagné pour l’être humain.
Ces gains de productivité se
traduisent concrètement par du temps supplémentaire pour se former, créer, se reposer ou
s’adonner à des activités choisies.
En ce sens, la technologie élargit notre pouvoir d’agir et
notre liberté de disposer de notre temps.
Par exemple, un simple appareil comme le lavelinge a révolutionné la vie domestique au XXe siècle : il a affranchi des
générations de personnes (surtout des femmes) de la corvée longue et harassante du lavage à
la main, leur permettant de consacrer ce temps à d’autres projets.
On voit ici comment la
technologie, en automatisant certaines tâches, nous libère de besoins matériels et d’efforts
autrefois inévitables.
Un autre aspect fondamental de la liberté apportée par la technologie est l’abolition des
barrières de l’espace et du temps.
Grâce aux moyens de transport modernes – du train à
l’avion – nous pouvons nous déplacer sur de grandes distances rapidement, ce qui élargit
considérablement notre liberté de mouvement.
Là où nos ancêtres vivaient souvent toute leur
vie dans un périmètre restreint, nous avons aujourd’hui la possibilité de voyager, de migrer,
de découvrir d’autres cultures, en somme d’être moins enfermés géographiquement.
De
même, les technologies de communication nous libèrent de l’isolement : le téléphone, puis
Internet, abolissent la distance dans l’échange d’informations.
Il est désormais possible de
communiquer instantanément à l’autre bout du monde, de travailler à distance, ou de
tisser des amitiés au-delà des frontières.
Cette connectivité accrue renforce la liberté
d’entreprendre des projets internationaux, la liberté de rester en contact avec ses proches où
qu’ils soient, et même la liberté d’expression sur une échelle globale.
Par exemple, un
étudiant peut suivre depuis la France une conférence diffusée en direct depuis les États-Unis,
ou un citoyen peut dénoncer sur les réseaux sociaux une injustice locale et trouver un écho
international.
Durant le Printemps arabe de 2011, les manifestants en Tunisie ou en Égypte
ont largement utilisé Facebook et Twitter comme outils d’émancipation politique : ces
plateformes leur ont permis d’organiser des manifestations et de contourner la censure des
médias officiels, en diffusant librement images et témoignages au grand jourlemonde.fr.
Dans
ce cas, la technologie numérique a servi de vecteur à la liberté d’expression et à la démocratie,
en donnant une voix publique à des citoyens qui en étaient privés.
Au-delà de la communication, la révolution numérique a démultiplié l’accès au savoir, ce qui
est un puissant facteur de liberté individuelle.
Internet est souvent comparé à la plus grande
bibliothèque du monde, accessible à (presque) tous, à toute heure.
Jadis, savoir et éducation
étaient réservés à une élite ou à ceux qui pouvaient se payer livres et professeurs.
Aujourd’hui, n’importe qui muni d’une connexion peut apprendre des langues, se former à la
programmation, découvrir l’histoire du Japon ou les secrets de l’astrophysique, souvent
gratuitement.
Cette démocratisation du savoir donne à chacun la liberté intellectuelle de se
cultiver et de développer ses compétences à son rythme.
Par exemple, de nombreuses
personnes apprennent désormais de nouvelles compétences en suivant des tutoriels vidéos en
ligne ou des cours ouverts (MOOCs), ce qui peut élargir leurs opportunités professionnelles et
personnelles.
La technologie éducative libère ainsi des contraintes géographiques (plus
besoin d’être dans une grande université pour apprendre) et financières dans une certaine
mesure.
On peut y voir une réalisation concrète du droit à l’éducation pour tous.
Par ailleurs, la technologie a amélioré la liberté physique et sanitaire des individus.
Les
progrès médicaux et scientifiques – qui sont aussi des avancées technologiques – ont libéré
l’humanité de nombreuses limitations biologiques.
Des vaccins et antibiotiques nous ont
affranchis de maladies autrefois fatales, prolongeant notre espérance de vie et nous donnant la
liberté de vivre en meilleure santé.
De même, des innovations comme la pilule contraceptive
(mise au point dans les années 1960) ont été qualifiées de « révolution technologique et
sociale » : en permettant de contrôler les naissances, elles ont offert aux femmes une liberté
nouvelle dans la conduite de leur vie familiale et professionnelle.
C’est un exemple
frappant où une technologie médicale a directement contribué à l’émancipation d’une partie
de la population.
De plus, pour les personnes en situation de handicap, les outils
technologiques sont souvent synonymes d’autonomie retrouvée : un fauteuil roulant
électrique, une prothèse sophistiquée ou un logiciel de synthèse vocale offrent à des
individus la possibilité de se déplacer ou de communiquer alors qu’ils en seraient incapables
sans ces dispositifs.
On se souvient par exemple du scientifique Stephen Hawking, atteint de
paralysie, qui conversait grâce à un ordinateur piloté par le mouvement de ses yeux.
Ces
assistances techniques redonnent une liberté d’action et d’expression à des personnes qui,
sans elles, seraient prisonnières de leur corps.
Enfin, la technologie peut aussi libérer du cadre strict du travail traditionnel et améliorer la
qualité de vie.
Avec l’essor du numérique, le télétravail est devenu possible : on peut
désormais exercer de nombreuses professions depuis chez soi ou depuis n’importe quel lieu
connecté.
Cette flexibilité donne la liberté de s’installer loin de son bureau, à la campagne par
exemple, ou d’aménager son emploi du temps de manière plus autonome.
Durant la pandémie
de COVID-19, beaucoup ont fait l’expérience que travailler et étudier à distance, grâce aux
plateformes en ligne, permettait de concilier différemment vie personnelle et activités
professionnelles/études, et d’éviter certaines contraintes (trajets quotidiens, horaires rigides).
La technologie numérique a donc ouvert le champ à de nouvelles formes d’organisation,
potentiellement plus libres et adaptées aux besoins de chacun.
Transition.
À travers ces exemples, on constate que la technologie, lorsqu’elle est mise au
service de l’humain, peut être un formidable outil d’émancipation.
Elle libère des
contraintes de la nature, du temps et de la distance; elle élargit nos capacités physiques et
intellectuelles; elle permet d’exercer davantage nos droits fondamentaux comme l’accès au
savoir ou la liberté d’expression.
Pour résumer cette idée, on pourrait dire que la technologie
est « un bon serviteur » : elle obéit à nos besoins et accomplit pour nous ce qui nous entravait
autrefois.
Cependant, il ne faut pas oublier l’envers du décor.
Comme le dit un adage, « la
technologie est un bon serviteur, mais un mauvais maître ».
Si nous ne prenons pas garde, nos
outils peuvent inverser....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Exemple d'un sujet d'oral de bac de LLCE
- oral bac: Commentaire du texte : DIDEROT Encyclopédie article « Raison »
- Grand oral Bac : les jeux de hasard
- oral maths bac: : Comment les mathématiques nous permettent-elles de savoir si l’on a intérêt de jouer aux jeux de hasard ?
- Montaigne E.L3 ——— Français - Oral Bac ——— le colonialisme