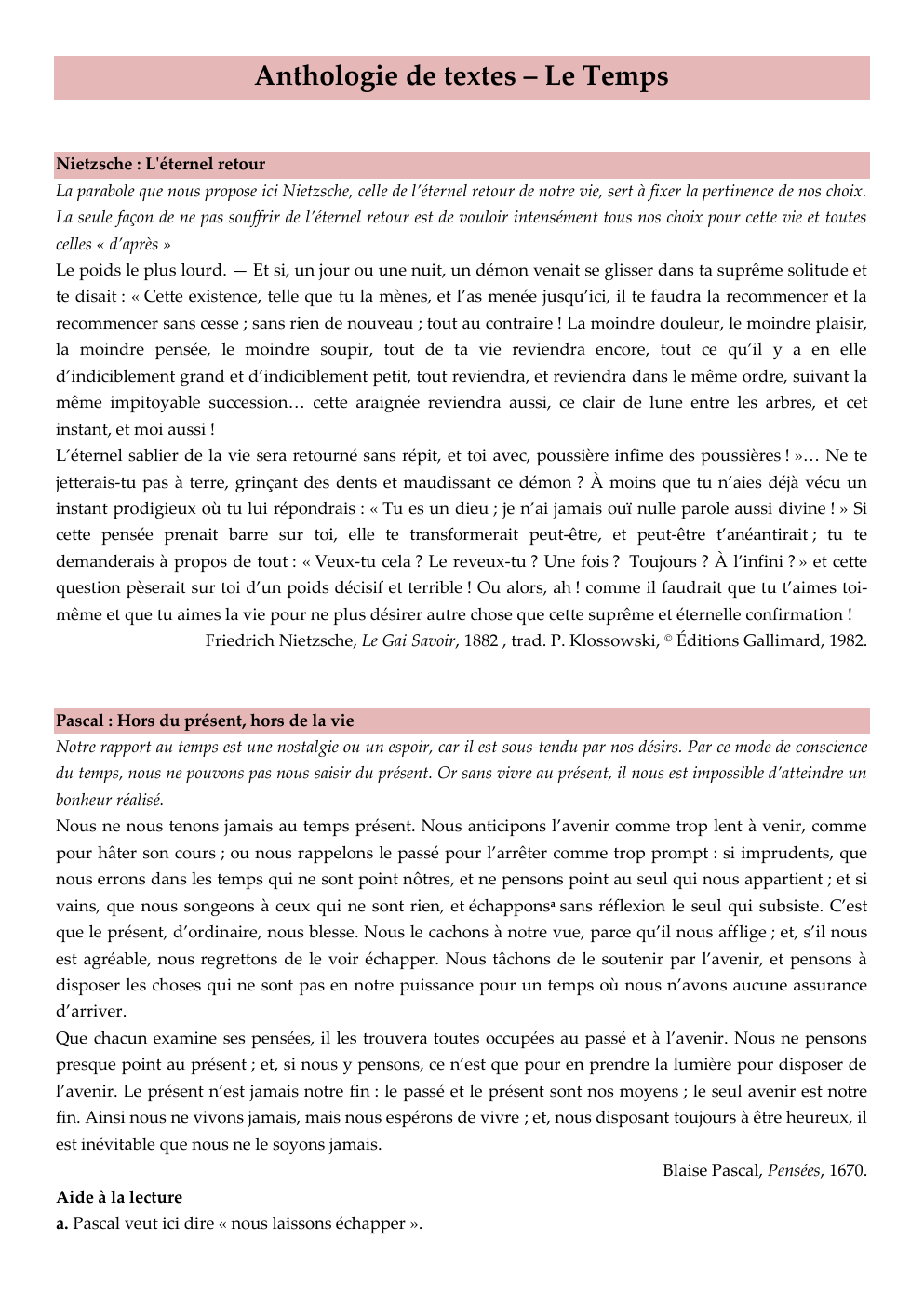Marque page
Publié le 24/11/2025
Extrait du document
«
Anthologie de textes – Le Temps
Nietzsche : L'éternel retour
La parabole que nous propose ici Nietzsche, celle de l’éternel retour de notre vie, sert à fixer la pertinence de nos choix.
La seule façon de ne pas souffrir de l’éternel retour est de vouloir intensément tous nos choix pour cette vie et toutes
celles « d’après »
Le poids le plus lourd.
— Et si, un jour ou une nuit, un démon venait se glisser dans ta suprême solitude et
te disait : « Cette existence, telle que tu la mènes, et l’as menée jusqu’ici, il te faudra la recommencer et la
recommencer sans cesse ; sans rien de nouveau ; tout au contraire ! La moindre douleur, le moindre plaisir,
la moindre pensée, le moindre soupir, tout de ta vie reviendra encore, tout ce qu’il y a en elle
d’indiciblement grand et d’indiciblement petit, tout reviendra, et reviendra dans le même ordre, suivant la
même impitoyable succession… cette araignée reviendra aussi, ce clair de lune entre les arbres, et cet
instant, et moi aussi !
L’éternel sablier de la vie sera retourné sans répit, et toi avec, poussière infime des poussières ! »… Ne te
jetterais-tu pas à terre, grinçant des dents et maudissant ce démon ? À moins que tu n’aies déjà vécu un
instant prodigieux où tu lui répondrais : « Tu es un dieu ; je n’ai jamais ouï nulle parole aussi divine ! » Si
cette pensée prenait barre sur toi, elle te transformerait peut-être, et peut-être t’anéantirait ; tu te
demanderais à propos de tout : « Veux-tu cela ? Le reveux-tu ? Une fois ? Toujours ? À l’infini ? » et cette
question pèserait sur toi d’un poids décisif et terrible ! Ou alors, ah ! comme il faudrait que tu t’aimes toimême et que tu aimes la vie pour ne plus désirer autre chose que cette suprême et éternelle confirmation !
Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir, 1882 , trad.
P.
Klossowski, © Éditions Gallimard, 1982.
Pascal : Hors du présent, hors de la vie
Notre rapport au temps est une nostalgie ou un espoir, car il est sous-tendu par nos désirs.
Par ce mode de conscience
du temps, nous ne pouvons pas nous saisir du présent.
Or sans vivre au présent, il nous est impossible d’atteindre un
bonheur réalisé.
Nous ne nous tenons jamais au temps présent.
Nous anticipons l’avenir comme trop lent à venir, comme
pour hâter son cours ; ou nous rappelons le passé pour l’arrêter comme trop prompt : si imprudents, que
nous errons dans les temps qui ne sont point nôtres, et ne pensons point au seul qui nous appartient ; et si
vains, que nous songeons à ceux qui ne sont rien, et échapponsa sans réflexion le seul qui subsiste.
C’est
que le présent, d’ordinaire, nous blesse.
Nous le cachons à notre vue, parce qu’il nous afflige ; et, s’il nous
est agréable, nous regrettons de le voir échapper.
Nous tâchons de le soutenir par l’avenir, et pensons à
disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance pour un temps où nous n’avons aucune assurance
d’arriver.
Que chacun examine ses pensées, il les trouvera toutes occupées au passé et à l’avenir.
Nous ne pensons
presque point au présent ; et, si nous y pensons, ce n’est que pour en prendre la lumière pour disposer de
l’avenir.
Le présent n’est jamais notre fin : le passé et le présent sont nos moyens ; le seul avenir est notre
fin.
Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre ; et, nous disposant toujours à être heureux, il
est inévitable que nous ne le soyons jamais.
Blaise Pascal, Pensées, 1670.
Aide à la lecture
a.
Pascal veut ici dire « nous laissons échapper ».
Bergson : La durée est créatrice
Le mystère de la création artistique peut être appréhendé à travers le rapport que l’artiste entretient avec un temps
particulier : celui de la durée.
Il ne réalise pas une œuvre dont l’image finale préexiste, chaque coup de pinceau donne à
la durée une puissance créatrice dont l’artiste est, lui-même, en partie spectateur.
Quand l’enfant s’amuse à reconstituer une image en assemblant les pièces d’un jeu de patience, il y
réussit de plus en plus vite à mesure qu’il s’exerce davantage.
La reconstitution était d’ailleurs instantanée,
l’enfant la trouvait toute faite, quand il ouvrait la boîte au sortir du magasin.
L’opération n’exige donc pas
un temps déterminé, et même, théoriquement, elle n’exige aucun temps.
C’est que le résultat en est donné.
C’est que l’image est créée déjà et que, pour l’obtenir, il suffit d’un travail de recomposition et de
réarrangement — travail qu’on peut supposer allant de plus en plus vite, et même infiniment vite au point
d’être instantané.
Mais, pour l’artiste qui crée une image en la tirant du fond de son âme, le temps n’est
plus un accessoire.
Ce n’est pas un intervalle qu’on puisse allonger ou raccourcir sans en modifier le
contenu.
La durée de son travail fait partie intégrante de son travail.
La contracter ou la dilater serait
modifier à la fois l’évolution psychologique qui la remplit et l’invention qui en est le terme.
Le temps
d’invention ne fait qu’un ici avec l’invention même.
C’est le progrès d’une pensée qui change au fur et à
mesure qu’elle prend corps.
Enfin c’est un processus vital, quelque chose comme la maturation d’une idée.
Le peintre est devant sa toile, les couleurs sont sur la palette, le modèle pose ; nous voyons tout cela,
et nous connaissons aussi la manière du peintre : prévoyons-nous ce qui apparaîtra sur la toile ? Nous
possédons les éléments du problème ; nous savons, d’une connaissance abstraite, comment il sera résolu,
car le portrait ressemblera sûrement au modèle et sûrement aussi à l’artiste ; mais la solution concrète
apporte avec elle cet imprévisible rien qui est le tout de l’œuvre d’art.
Et c’est ce rien qui prend du temps.
Henri Bergson, L’évolution créatrice, 1907.
Proust : Une minute d'éternité
Proust donne ici un exemple du temps subjectif.
Nous vivons notre rapport au temps sur le mode sentimental, ainsi
une seconde de bonheur peut durer une éternité.
C’est le souvenir du goût de la madeleine, la fameuse « madeleine de
Proust », qui permet à la conscience de l’auteur de s’affranchir du temps successif.
Me rappelant trop avec quelle indifférence relative Swann avait pu parler autrefois des jours où il
était aimé, parce que sous cette phrase il voyait autre chose qu’eux, et de la douleur subite que lui avait
causée la petite phrase de Vinteuil en lui rendant ces jours eux-mêmes tels qu’il les avait jadis sentis, je
comprenais trop que ce que la sensation des dalles inégales, la raideur de la serviette, le goût de la
madeleine avaient réveillé en moi, n’avait aucun rapport avec ce que je cherchais souvent à me rappeler de
Venise, de Balbec, de Combray, à l’aide d’une mémoire uniforme ; et je comprenais que la vie pût être jugée
médiocre, bien qu’à certains moments elle parût si belle, parce que dans le premier cas c’est sur tout autre
chose qu’elle-même, sur des images qui ne gardent rien d’elle qu’on la juge et qu’on la déprécie.
[…]
Je glissais rapidement sur tout cela, plus impérieusement sollicité que j’étais de chercher la cause de
cette félicité, du caractère de certitude avec lequel elle s’imposait, recherche ajournée autrefois.
Or, cette
cause, je la devinais en comparant entre elles ces diverses impressions bienheureuses et qui avaient entre
elles ceci de commun que je les éprouvais à la fois dans le moment actuel et dans un moment éloigné où le
bruit de la cuiller sur l’assiette, l’inégalité des dalles, le goût de la madeleine allaient jusqu’à faire empiéter
le passé sur le présent, à me faire hésiter à savoir dans lequel des deux je me trouvais ; au vrai, l’être qui
alors goûtait en moi cette impression la goûtait en ce qu’elle avait de commun dans un jour ancien et
maintenant, dans ce qu’elle avait d’extratemporel, un être qui n’apparaissait que quand, par une de ces
identités entre le présent et le passé, il pouvait se trouver dans le seul milieu où il pût vivre, jouir de
l’essence des choses, c’est-à-dire en dehors du temps.
Cela expliquait que mes inquiétudes au sujet de ma
mort eussent cessé au moment où j’avais reconnu, inconsciemment, le goût de la petite madeleine, puisqu’à
ce moment là l’être que j’avais été était un être extratemporel, par conséquent insoucieux des vicissitudes
de l’avenir.
Cet être-là n’était jamais venu à moi, ne s’était jamais manifesté qu’en dehors de l’action, de la
jouissance immédiate, chaque fois que le miracle d’une analogie m’avait fait échapper au présent.
Seul il
avait le pouvoir de me faire retrouver les jours anciens, le Temps Perdu, devant quoi les efforts de ma
mémoire et de mon intelligence échouaient toujours.
Un véritable moment du passé.
Rien qu’un moment du passé ? Beaucoup plus, peut-être ; quelque chose qui, commun....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES INTERACTIONS ENTRE L'HOMME ET LA MACHINE SUR LE WEB FORMULAIRE D’UNE PAGE WEB – PHP PREMIERE
- Le temps est-il la marque de mon impuissance
- explication princesse de clèves page 20 (de “Il parut alors une beauté à la cour” à “d’en être aimé”)
- Titre de l’œuvre Dom Juan Auteur Molière / Jean-Baptiste Pocquelin Editeur Flammarion Collection GF Date d’édition 1682 Nombre de page 222
- La rencontre - L'Amant de Marguerite Duras: En quoi cette scène de rencontre marque-t-elle un défi à la société indochinoise?