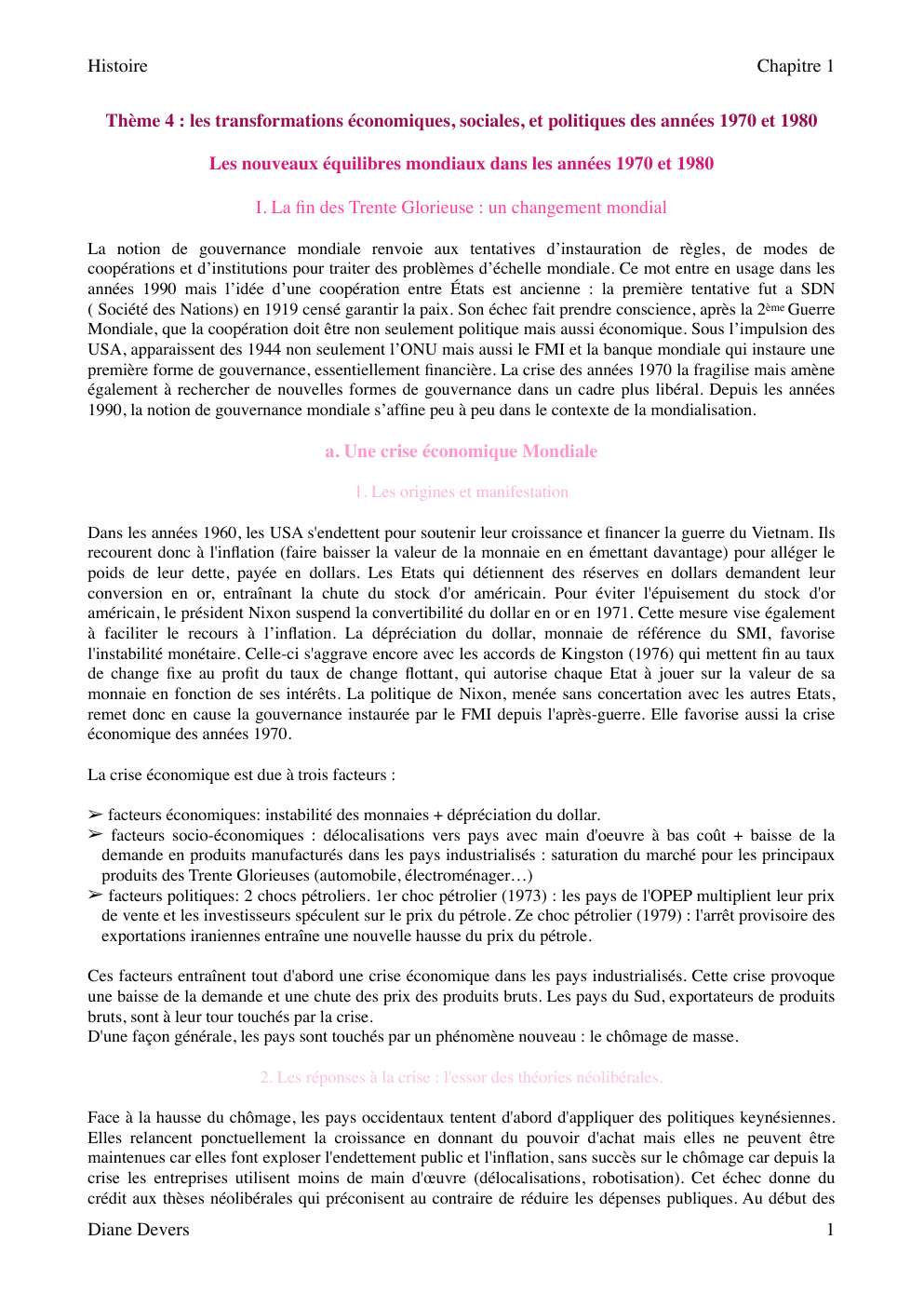Les nouveaux équilibres mondiaux dans les années 1970 et 1980
Publié le 09/04/2025
Extrait du document
«
Histoire
Chapitre 1
Thème 4 : les transformations économiques, sociales, et politiques des années 1970 et 1980
Les nouveaux équilibres mondiaux dans les années 1970 et 1980
I.
La n des Trente Glorieuse : un changement mondial
La notion de gouvernance mondiale renvoie aux tentatives d’instauration de règles, de modes de
coopérations et d’institutions pour traiter des problèmes d’échelle mondiale.
Ce mot entre en usage dans les
années 1990 mais l’idée d’une coopération entre États est ancienne : la première tentative fut a SDN
( Société des Nations) en 1919 censé garantir la paix.
Son échec fait prendre conscience, après la 2ème Guerre
Mondiale, que la coopération doit être non seulement politique mais aussi économique.
Sous l’impulsion des
USA, apparaissent des 1944 non seulement l’ONU mais aussi le FMI et la banque mondiale qui instaure une
première forme de gouvernance, essentiellement nancière.
La crise des années 1970 la fragilise mais amène
également à rechercher de nouvelles formes de gouvernance dans un cadre plus libéral.
Depuis les années
1990, la notion de gouvernance mondiale s’af ne peu à peu dans le contexte de la mondialisation.
a.
Une crise économique Mondiale
1.
Les origines et manifestation
Dans les années 1960, les USA s'endettent pour soutenir leur croissance et nancer la guerre du Vietnam.
Ils
recourent donc à l'in ation (faire baisser la valeur de la monnaie en en émettant davantage) pour alléger le
poids de leur dette, payée en dollars.
Les Etats qui détiennent des réserves en dollars demandent leur
conversion en or, entraînant la chute du stock d'or américain.
Pour éviter l'épuisement du stock d'or
américain, le président Nixon suspend la convertibilité du dollar en or en 1971.
Cette mesure vise également
à faciliter le recours à l’in ation.
La dépréciation du dollar, monnaie de référence du SMI, favorise
l'instabilité monétaire.
Celle-ci s'aggrave encore avec les accords de Kingston (1976) qui mettent n au taux
de change xe au pro t du taux de change ottant, qui autorise chaque Etat à jouer sur la valeur de sa
monnaie en fonction de ses intérêts.
La politique de Nixon, menée sans concertation avec les autres Etats,
remet donc en cause la gouvernance instaurée par le FMI depuis l'après-guerre.
Elle favorise aussi la crise
économique des années 1970.
La crise économique est due à trois facteurs :
➢ facteurs économiques: instabilité des monnaies + dépréciation du dollar.
➢ facteurs socio-économiques : délocalisations vers pays avec main d'oeuvre à bas coût + baisse de la
demande en produits manufacturés dans les pays industrialisés : saturation du marché pour les principaux
produits des Trente Glorieuses (automobile, électroménager…)
➢ facteurs politiques: 2 chocs pétroliers.
1er choc pétrolier (1973) : les pays de l'OPEP multiplient leur prix
de vente et les investisseurs spéculent sur le prix du pétrole.
Ze choc pétrolier (1979) : l'arrêt provisoire des
exportations iraniennes entraîne une nouvelle hausse du prix du pétrole.
Ces facteurs entraînent tout d'abord une crise économique dans les pays industrialisés.
Cette crise provoque
une baisse de la demande et une chute des prix des produits bruts.
Les pays du Sud, exportateurs de produits
bruts, sont à leur tour touchés par la crise.
D'une façon générale, les pays sont touchés par un phénomène nouveau : le chômage de masse.
2.
Les réponses à la crise : l'essor des théories néolibérales.
Face à la hausse du chômage, les pays occidentaux tentent d'abord d'appliquer des politiques keynésiennes.
Elles relancent ponctuellement la croissance en donnant du pouvoir d'achat mais elles ne peuvent être
maintenues car elles font exploser l'endettement public et l'in ation, sans succès sur le chômage car depuis la
crise les entreprises utilisent moins de main d'œuvre (délocalisations, robotisation).
Cet échec donne du
crédit aux thèses néolibérales qui préconisent au contraire de réduire les dépenses publiques.
Au début des
fi
fi
fl
fi
fl
fi
1
fl
fi
fl
fi
fi
Diane Devers
Histoire
Chapitre 1
années 1980, le RU de M.
Thatcher et les USA de R.
Reagan sont les premiers à appliquer des politiques
néolibérales se traduisant par un désengagement de l'État (manuel : texte Thatcher + Washington p.
195 et
page 196 197).
Au même moment, la France de Mitterrand procède au contraire à de nouvelles
nationalisations et renforce l'Etat-providence, avant de pratiquer une politique de rigueur dès 1983 et de
lancer des privatisations sous le gouvernement Chirac en 1986.
Ces mesures visant à réduire le poids de l'Etat s'accompagnent d'une dérégulation des mouvements de
capitaux et des services nanciers, à l'origine de la globalisation nancière.
Le rôle des acteurs privés dans
l'économie se trouve renforcé : FTN déployant des stratégies mondiales, banques et fonds d'investissement,
agences de notation évaluant la solvabilité des entreprises et des Etats.
Mais ce recul du rôle de l'Etat dans l'économie, de même que les réactions désordonnées des Etats face à la
crise, font prendre conscience du besoin d'une nouvelle gouvernance mondiale.
3.
La recherche d'une gouvernance libérale
En 1975, c'est une instance de concertation entre Etats qui est créée avec le G6.
(Photo Rambouillet p.
193)
Réuni à l'initiative du président Giscard d'Estaing, le premier sommet du « Groupe des six » regroupe les
principales puissances industrielles de l'époque: USA, Japon, RFA, RU, France, Italie, puis Canada en 1976.
Dans un contexte marqué par le choc pétrolier et l'explosion du chômage, il a pour objectif de rétablir la
croissance par une coordination internationale des politiques monétaires (assurer la stabilité) et commerciales
(développer le libre-échange), avec des rencontres régulières des chefs d'Etat et de gouvernement.
Le G7 souhaite notamment redonner toute son importance au FMI, dans un contexte d'endettement des pays
du Sud lié à la chute des prix des matières premières.
En 1982, le Mexique annonce qu'il est incapable de
rembourser sa dette, suivi par une trentaine de pays jusqu'en 1989.
Cette crise de la dette fait du FMI le
« gendarme » des politiques publiques des pays du Sud.
En effet, les aides du FMI et de la Banque mondiale
ne sont versées qu'à condition que le pays débiteur accepte un programme d'ajustement structurel (PAS),
c'est-à-dire un ensemble de mesures libérales devant assainir ses nances :
privatisation d'entreprises, réduction des dépenses publiques et du nombre de fonctionnaires, ouverture de
l'économie à la concurrence et aux investissements étrangers.
Mais cette gouvernance suscite de nombreuses
critiques, notamment de la part du G77, qui voit dans le FMI un « club » de pays riches, écartant les autres
pays des affaires mondiales et promouvant une mondialisation libérale au service du Nord.
Les pays du Sud
dénoncent les conséquences à court terme des PAS : explosion du chômage, dégradation des systèmes
d'éducation, de santé voire de la situation alimentaire.
De manière plus générale, la gouvernance néolibérale
montre ses limites à la n des années 1980.
Les mouvements spéculatifs de grande ampleur facilités par la
dérégulation provoquent des crises nancières (krach boursier de 1987).
La tendance au creusement des
inégalités entre pays du Nord et du Sud et à l'intérieur des pays, ainsi que la prise de conscience des menaces
qui pèsent sur l'environnement démontrent la nécessité d'une gouvernance mondiale plus conforme aux
exigences du développement durable exposées dans le rapport Brundtland en 1987.
En n, la chute du bloc
communiste ouvre la voie à une gouvernance plus globale.
B.
Le monde en évolution.
La contestation de la guerre du Vietnam, les événements de mai 1968 en
France, le printemps de Prague également en 1968, montrent une jeunesse qui conteste les ordres établis et
réclame un changement général.
Le modèle de la société de consommation, par exemple, est questionné,
notamment en raison de ses impacts écologiques: les marées noires sont médiatisées et présentées comme
des scandales (Amoco Cadiz : pétrolier US parti du Golfe Persique, ft naufrage en 1974 au large de Brest).
Des groupes de ré exion prônent la « croissance zéro » voire la « décroissance ».
En 1987, le rapport
Brundtland, rédigé pour l’ONU, dé nit la notion de développement durable.
D'une façon générale, la population mondiale commence à connaître des évolutions démographiques
parquées.
Entre 1950 et 2000, la population mondiale passe de 2,5 à 6 millions d'habitants.
Le rythme de
croissance a été à son apogée entre 1965 et 1970, avec des inégalités (chute de la pop en URSS par exemple).
La baisse de la fécondité dans tous les pays où le développement se met en marche est un phénomène
marquant, expliqué par l'accès à la contraception, l'éducation des femmes et le changement dans les rapports
à l'enfance: l'enfant coûte cher.
Des politiques malthusianistes peuvent être mises en place (enfant unique en
Chine).
Les progrès de la médecine deviennent signi catifs, malgré l'apparition de grands éaux (SIDA:
premiers cas identi és 1981, virus identi é 1984, depuis ce tps 70% des malades sont en Afrique).
fl
fi
fi
fi
fi
fi
fi
2
fi
fi
fi
fl
fi
Diane Devers
Histoire
Chapitre 1
La répartition de la population mondiale évolue également : les pays s'urbanisent.
Ds les pays industrialisés,
la population devient très largement urbaine (90% aux PB, 80% en France).
À l'échelle....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Thème 3 Les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 1970 à 1991 Chapitre 1 La modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux (1973-1991) Introduction Frise chrono p.
- La modification des grands équilibres économiques et politiques. (fin des années 1970 à 1992)
- LES GRANDS MODÈLES IDÉOLOGIQUES ET LA CONFRONTATION EST-OUEST JUSQU'AUX ANNÉES 1970
- Dans quelle mesure peut-on parler d’un monde bipolaire de 1947 jusqu’aux années 1970 ?
- La modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux 1973-1991