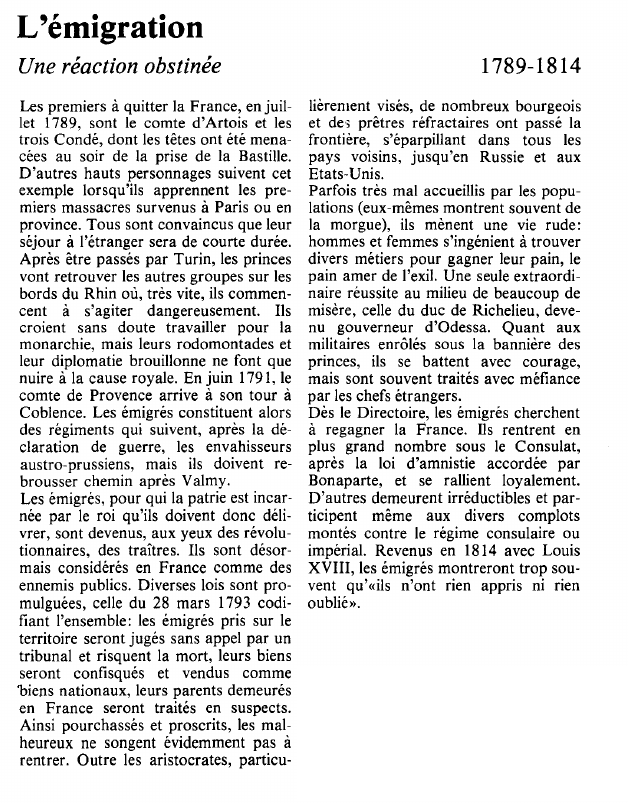L'émigrationUne réaction obstinée.
Publié le 17/05/2020

Extrait du document
«
1 / 2 L'émigration
Une réaction obstinée
Les premiers à quitter la France, en juil
let 1789, sont le comte d'Artois et les trois Condé, dont les têtes ont été mena
cées au soir de la prise de la Bastille.
D'autres hauts personnages suivent cet
exemple lorsqu'ils apprennent les pre
miers massacres survenus
à Paris ou en province.
Tous sont convaincus que leur
séjour à l'étranger sera de courte durée.
Après être passés par Turin, les princes
vont retrouver les autres groupes sur les bords du Rhin où, très vite, ils commen
cent à s'agiter dangereusement.
Ils
croient sans doute travailler pour la
monarchie, mais leurs rodomontades et
leur diplomatie brouillonne
ne font que
nuire à la cause royale.
En juin 1 791, le comte de Provence arrive à son tour à Coblence.
Les émigrés constituent alors
des régiments qui suivent, après la dé claration de guerre, les envahisseurs
austro-prussiens, mais ils doivent re brousser chemin après Valmy.
Les émigrés, pour qui la patrie est incar
née par
le roi qu'ils doivent donc déli vrer, sont devenus, aux yeux des révolu
tionnaires, des traîtres.
Ils sont désor
mais considérés
en France comme des
ennemis publics.
Diverses lois sont pro
mulguées, celle
du 28 mars 1793 codi
fiant l'ensemble: les émigrés pris sur le territoire seront jugés sans appel par un
tribunal et risquent la mort, leurs biens
seront confisqués et vendus comme
biens nationaux, leurs parents demeurés
en France seront traités en suspects.
Ainsi pourchassés et proscrits,
les mal
heureux ne songent évidemment pas à rentrer.
Outre les aristocrates, particu-
1789-1814
Iièrement visés, de nombreux bourgeois
et de; prêtres réfractaires ont passé la
frontière, s'éparpillant dans tous les pays voisins, jusqu'en Russie et aux
Etats-Unis.
Parfois très mal accueillis par
les popu
lations (eux-mêmes montrent souvent de la morgue), ils mènent une vie rude:
hommes et femmes s'ingénient à trouver
divers métiers pour gagner leur pain, le pain amer de l'exil.
Une seule extraordi
naire réussite au milieu de beaucoup de misère, celle du duc de Richelieu, deve nu gouverneur d'Odessa.
Quant aux
militaires enrôlés sous la bannière des
princes,
ils se battent avec courage,
mais sont souvent traités avec méfiance
par
les chefs étrangers.
Dès le Directoire, les émigrés cherchent à regagner la France.
Ils rentrent en
plus grand nombre sous le Consulat,
après la loi d'amnistie accordée par
Bonaparte, et se rallient loyalement.
D'autres demeurent irréductibles et par
ticipent même aux divers complots
montés contre
le régime consulaire ou
impérial.
Revenus en 1814 avec Louis
XVIII,
les émigrés montreront trop sou
vent qu'«ils n'ont rien appris ni rien oublié».
2 / 2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'émigrationUne réaction obstinée.
- grand oral maths/physique : Comment et dans quels buts les équations différentielles permettent de modéliser la vitesse d’une réaction chimique ?
- THEME 3 : Corps humain et santé / La réaction inflammatoire : un exemple de réponse innée
- chapitre de chimie de terminale spécialité physique réaction acide-base
- LA RÉACTION CONTRE LE DRAME ROMANTIQUE