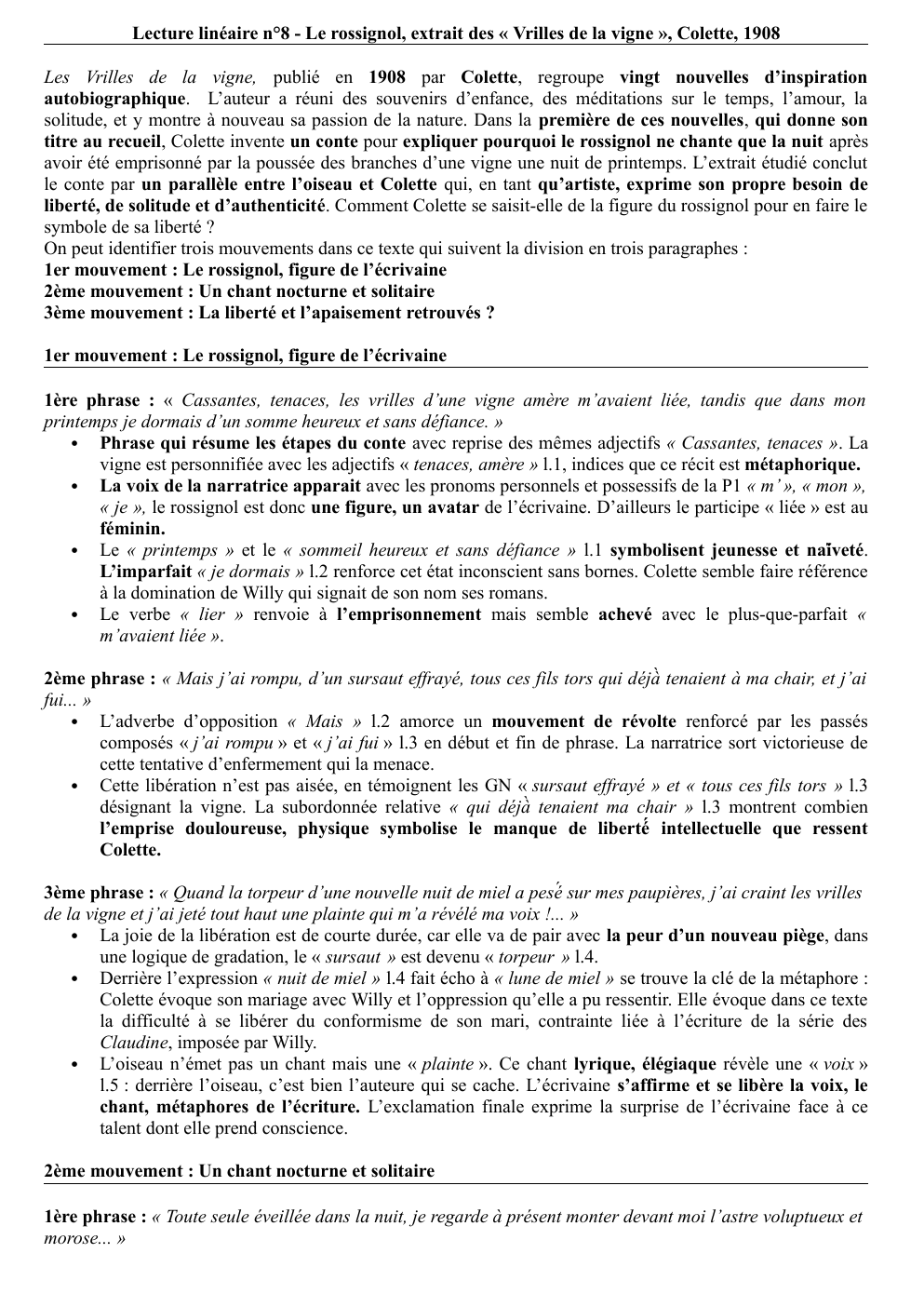Lecture linéaire n°8 - Le rossignol, extrait des « Vrilles de la vigne », Colette, 1908
Publié le 13/10/2025
Extrait du document
«
Lecture linéaire n°8 - Le rossignol, extrait des « Vrilles de la vigne », Colette, 1908
Les Vrilles de la vigne, publié en 1908 par Colette, regroupe vingt nouvelles d’inspiration
autobiographique.
L’auteur a réuni des souvenirs d’enfance, des méditations sur le temps, l’amour, la
solitude, et y montre à nouveau sa passion de la nature.
Dans la première de ces nouvelles, qui donne son
titre au recueil, Colette invente un conte pour expliquer pourquoi le rossignol ne chante que la nuit après
avoir été emprisonné par la poussée des branches d’une vigne une nuit de printemps.
L’extrait étudié conclut
le conte par un parallèle entre l’oiseau et Colette qui, en tant qu’artiste, exprime son propre besoin de
liberté, de solitude et d’authenticité.
Comment Colette se saisit-elle de la figure du rossignol pour en faire le
symbole de sa liberté ?
On peut identifier trois mouvements dans ce texte qui suivent la division en trois paragraphes :
1er mouvement : Le rossignol, figure de l’écrivaine
2ème mouvement : Un chant nocturne et solitaire
3ème mouvement : La liberté et l’apaisement retrouvés ?
1er mouvement : Le rossignol, figure de l’écrivaine
1ère phrase : « Cassantes, tenaces, les vrilles d’une vigne amère m’avaient liée, tandis que dans mon
printemps je dormais d’un somme heureux et sans défiance.
»
Phrase qui résume les étapes du conte avec reprise des mêmes adjectifs « Cassantes, tenaces ».
La
vigne est personnifiée avec les adjectifs « tenaces, amère » l.1, indices que ce récit est métaphorique.
La voix de la narratrice apparait avec les pronoms personnels et possessifs de la P1 « m’ », « mon »,
« je », le rossignol est donc une figure, un avatar de l’écrivaine.
D’ailleurs le participe « liée » est au
féminin.
Le « printemps » et le « sommeil heureux et sans défiance » l.1 symbolisent jeunesse et naïveté.
L’imparfait « je dormais » l.2 renforce cet état inconscient sans bornes.
Colette semble faire référence
à la domination de Willy qui signait de son nom ses romans.
Le verbe « lier » renvoie à l’emprisonnement mais semble achevé avec le plus-que-parfait «
m’avaient liée ».
2ème phrase : « Mais j’ai rompu, d’un sursaut effrayé, tous ces fils tors qui déjà̀ tenaient à ma chair, et j’ai
fui...
»
L’adverbe d’opposition « Mais » l.2 amorce un mouvement de révolte renforcé par les passés
composés « j’ai rompu » et « j’ai fui » l.3 en début et fin de phrase.
La narratrice sort victorieuse de
cette tentative d’enfermement qui la menace.
Cette libération n’est pas aisée, en témoignent les GN « sursaut effrayé » et « tous ces fils tors » l.3
désignant la vigne.
La subordonnée relative « qui déjà̀ tenaient ma chair » l.3 montrent combien
l’emprise douloureuse, physique symbolise le manque de liberté́ intellectuelle que ressent
Colette.
3ème phrase : « Quand la torpeur d’une nouvelle nuit de miel a pesé́ sur mes paupières, j’ai craint les vrilles
de la vigne et j’ai jeté tout haut une plainte qui m’a révélé ma voix !...
»
La joie de la libération est de courte durée, car elle va de pair avec la peur d’un nouveau piège, dans
une logique de gradation, le « sursaut » est devenu « torpeur » l.4.
Derrière l’expression « nuit de miel » l.4 fait écho à « lune de miel » se trouve la clé de la métaphore :
Colette évoque son mariage avec Willy et l’oppression qu’elle a pu ressentir.
Elle évoque dans ce texte
la difficulté à se libérer du conformisme de son mari, contrainte liée à l’écriture de la série des
Claudine, imposée par Willy.
L’oiseau n’émet pas un chant mais une « plainte ».
Ce chant lyrique, élégiaque révèle une « voix »
l.5 : derrière l’oiseau, c’est bien l’auteure qui se cache.
L’écrivaine s’affirme et se libère la voix, le
chant, métaphores de l’écriture.
L’exclamation finale exprime la surprise de l’écrivaine face à ce
talent dont elle prend conscience.
2ème mouvement : Un chant nocturne et solitaire
1ère phrase : « Toute seule éveillée dans la nuit, je regarde à présent monter devant moi l’astre voluptueux et
morose...
»
Le « chant », métaphore de l’écriture, est un acte solitaire : l’adjectif « seule » est renforcé par
l’adverbe « toute » et le pronom « moi » de forme tonique.
La narratrice ne partage ce moment
qu’avec la lune et donc la nature.
Le lever de la lune symbolise la naissance de l’indépendance avec
l’infinitif « monter ».
Cet astre voluptueux et morose » l.7 est ambivalent, à l’image de l’artiste et de
l’art, générateurs de beauté́ comme de mélancolie.
Poésie du texte avec la périphrase, atmosphère
solitaire.
2ème phrase : « Pour me défendre de retomber dans l’heureux sommeil, dans le printemps menteur où fleurit
la vigne crochue, j’écoute le son de ma voix...
»
La narratrice invente une explication poétique au chant nocturne du rossignol (conte étiologique) :
« pour me défendre de retomber dans l’heureux sommeil » l.7 (CC de but) et donc pour se maintenir
éveillée, elle chante.
Ce chant a une fonction salvatrice face aux dangers de la naïveté encore
symbolisé par le « sommeil » ou le « printemps menteur » l.8 qui forme un oxymore est signale que la
narratrice connait les dangers.
Enfin, comme le rossignol chante pour lui-même, la poétesse écrit pour elle-même comme le
suggèrent les marques redoublées de la première personne : « j’écoute le son de ma voix » l.8.
Colette
n’a plus besoin d’un....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Forêt de Crécy de Colette (1873-1954) Les Vrilles de la vigne, 1908 Hachette
- FICHE DE LECTURE: SIDO suivi de LES VRILLES DE LA VIGNE DE COLETTE
- COURS D’INTRODUCTION SUR Sido et Les Vrilles de la vigne DE COLETTE.
- O.E.2: Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle / E.O.I. Juste la fin du monde (1990) de Jean-Luc LAGARCE ORAL LECTURE LINÉAIRE n°7, extrait de la Première partie, scène 8 – LA MÈRE
- lecture linéaire/analytique d’un extrait du Discours de la servitude volontaire d’Étienne de la Boétie