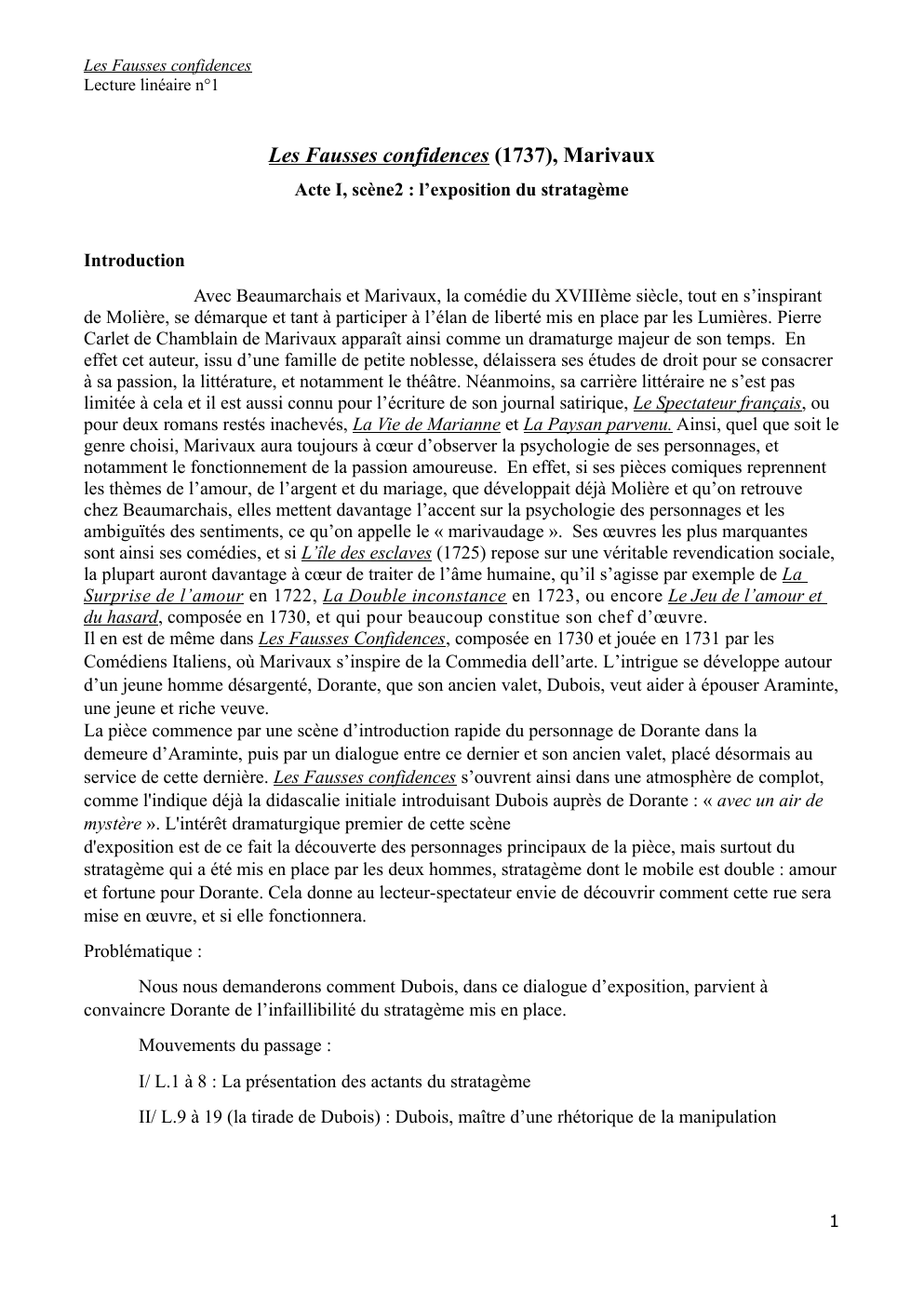Lecture linéaire n°1 Les Fausses confidences (1737), Marivaux Acte I, scène2 : l’exposition du stratagème
Publié le 27/04/2025
Extrait du document
«
Les Fausses confidences
Lecture linéaire n°1
Les Fausses confidences (1737), Marivaux
Acte I, scène2 : l’exposition du stratagème
Introduction
Avec Beaumarchais et Marivaux, la comédie du XVIIIème siècle, tout en s’inspirant
de Molière, se démarque et tant à participer à l’élan de liberté mis en place par les Lumières.
Pierre
Carlet de Chamblain de Marivaux apparaît ainsi comme un dramaturge majeur de son temps.
En
effet cet auteur, issu d’une famille de petite noblesse, délaissera ses études de droit pour se consacrer
à sa passion, la littérature, et notamment le théâtre.
Néanmoins, sa carrière littéraire ne s’est pas
limitée à cela et il est aussi connu pour l’écriture de son journal satirique, Le Spectateur français, ou
pour deux romans restés inachevés, La Vie de Marianne et La Paysan parvenu.
Ainsi, quel que soit le
genre choisi, Marivaux aura toujours à cœur d’observer la psychologie de ses personnages, et
notamment le fonctionnement de la passion amoureuse.
En effet, si ses pièces comiques reprennent
les thèmes de l’amour, de l’argent et du mariage, que développait déjà Molière et qu’on retrouve
chez Beaumarchais, elles mettent davantage l’accent sur la psychologie des personnages et les
ambiguïtés des sentiments, ce qu’on appelle le « marivaudage ».
Ses œuvres les plus marquantes
sont ainsi ses comédies, et si L’île des esclaves (1725) repose sur une véritable revendication sociale,
la plupart auront davantage à cœur de traiter de l’âme humaine, qu’il s’agisse par exemple de La
Surprise de l’amour en 1722, La Double inconstance en 1723, ou encore Le Jeu de l’amour et
du hasard, composée en 1730, et qui pour beaucoup constitue son chef d’œuvre.
Il en est de même dans Les Fausses Confidences, composée en 1730 et jouée en 1731 par les
Comédiens Italiens, où Marivaux s’inspire de la Commedia dell’arte.
L’intrigue se développe autour
d’un jeune homme désargenté, Dorante, que son ancien valet, Dubois, veut aider à épouser Araminte,
une jeune et riche veuve.
La pièce commence par une scène d’introduction rapide du personnage de Dorante dans la
demeure d’Araminte, puis par un dialogue entre ce dernier et son ancien valet, placé désormais au
service de cette dernière.
Les Fausses confidences s’ouvrent ainsi dans une atmosphère de complot,
comme l'indique déjà la didascalie initiale introduisant Dubois auprès de Dorante : « avec un air de
mystère ».
L'intérêt dramaturgique premier de cette scène
d'exposition est de ce fait la découverte des personnages principaux de la pièce, mais surtout du
stratagème qui a été mis en place par les deux hommes, stratagème dont le mobile est double : amour
et fortune pour Dorante.
Cela donne au lecteur-spectateur envie de découvrir comment cette rue sera
mise en œuvre, et si elle fonctionnera.
Problématique :
Nous nous demanderons comment Dubois, dans ce dialogue d’exposition, parvient à
convaincre Dorante de l’infaillibilité du stratagème mis en place.
Mouvements du passage :
I/ L.1 à 8 : La présentation des actants du stratagème
II/ L.9 à 19 (la tirade de Dubois) : Dubois, maître d’une rhétorique de la manipulation
1
Les Fausses confidences
Lecture linéaire n°1
I/ (lignes 1 à 8) La présentation des actants du stratagème
Un couple de maître/valet reformé : Dubois rassure Dorante et contre ses objections.
Même si Dorante n'est plus le maître de Dubois, cet échange révèle que la relation maître/valet
reste inchangée :
Le valet, conformément à son statut lui conférant le rôle de confident, tend ici à rassurer son
maître et ne cesse de contrer les objections de ce dernier.
Tandis que les objections de Dorante révèlent la vulnérabilité du personnage en même temps qu'elles
ouvrent la possibilité de l'éventuel échec du stratagème.
Cette partie du dialogue se caractérise par une accélération du rythme dans la scène, grâce à des
répliques plus courtes.
« DORANTE.
Elle a plus de cinquante mille livres de rente, Dubois.
» (l.1) :
-
« Plus de cinquante mille livres » : hyperbole traduite par l’adjectif numéral imposant,
intensifiée qui plus est par le comparatif de supériorité « plus de » =-> Richesse
indéniable d’Araminte, dont il est question ici.
-
La première objection de Dorante à leur stratagème est ainsi d'ordre financier, comme le
révèle de lexique de l’argent, avec « livres » et « rente ».
Ainsi, en rappelant à Dubois la
fortune immense de la jeune veuve, il expose une réalité sociale : il n’appartient pas au
même statut que son aimée.
Cette objection énonce donc un premier obstacle, majeur.
« DUBOIS.
Ah ! vous en avez bien soixante pour le moins.
» (l.2) :
-
« Ah ! » : interjection de Dubois qui souligne son ton moqueur.
-
En effet, face aux objections de Dorante, Dubois semble plutôt amusé : il minimise ainsi
le premier obstacle en jouant sur les nombres, opposant le « cinquante » (l.1), de la
réplique de Dorante, à « soixante » (l.2) ici.
Or 60 peut sembler supérieur à 50, si
toutefois l’on oublie le facteur 1000 qui accompagnait la numération de la rente
précédente...
Mais avec ce ton rassurant et moqueur, Dubois relativise afin d’affirmer que rien ne pourra
s’opposer à son plan
« DORANTE.
Et tu me dis qu’elle est extrêmement raisonnable ? » (l.3) :
-
« tu me dis que » : le pronom personnel sujet concerne l’interlocuteur puisqu’il est de la
deuxième personne du singulier, « tu ».
Or, il est ici associé à un verbe de savoir, à travers
le verbe de parole « dire » -> Dorante ne peut donc se fier ici qu’au jugement de son
ancien valet, Dubois.
-
« elle est extrêmement raisonnable » : hyperbole par l’adjonction de l’adverbe intensif
« extrêmement » devant l’adjectif mélioratif « raisonnable » -> Cela permet de valoriser
Araminte, tout en présageant les difficultés qu’il y aura à la faire sortir de sa pondération
pour se laisser aller à la passion qu’ils espèrent provoquer chez elle.
La deuxième objection de Dorante est donc exposée à son tour, et porte sur le caractère de
cette femme dont nous ne connaissons pas encore le nom - et qui existe avant tout ici par son
statut de jeune veuve riche.
2
Les Fausses confidences
Lecture linéaire n°1
« DUBOIS.
Tant mieux pour vous, et tant pis pour elle.
» (l.4) :
Par un parallélisme antithétique qui oppose « vous » et « elle » d’une part, et « mieux » et « pis »
d’autre part, Dubois inverse ainsi la situation, et relativise les inquiétudes de Dorante, affirmant que
l'obstacle de la raison sera finalement un atout puisqu’ils s’en serviront pour la manipuler.
« Si vous lui plaisez, elle en sera si honteuse, elle se débattra tant, elle deviendra si faible,
qu’elle ne pourra se soutenir qu’en épousant ; vous m’en direz des nouvelles.
» (l.
4 à 6) :
-
Vient ensuite la présentation d'une intrigue amoureuse sur le mode de la parodie de « Si
vous lui plaisez » (l.4) à « vous l'aimez ? » (L.7) Le lexique de la galanterie est en effet
bien présent ici, notamment par des dérivations autour des verbes « aimer » et
« épouser », avec : « plaisez » l.4, « épousant » l.6, « vous l’aimez » l.7, « je l’aime » l.8,
« avec passion » l.8, « on vous aimera » l.13, « on vous épousera » l.13, « l’amour » l.15,
et « l’Amour » l.19.
-
Multiplication des futurs prophétiques « elle en sera », « elle se débattra », « elle
deviendra », « elle ne pourra », vous m’en direz », enchaînement mis en valeur par
l’énumération des trois premiers.
– Dubois semble confiant dans son stratagème.
-
Multiplication des tournures hyperboliques, au cœur de l’énumération, avec « si
honteuse », « se débattra tant » et « si faible » qui, adjoint à un lexique péjoratif
(« honteuse » , « se débattre », « faible », « se soutenir ») illustrent à quel point Dubois
espère faire perdre pied à Araminte par ses stratagèmes, afin de parvenir à ses fins.
-
Négation restrictive « elle ne pourra se soutenir qu’en vous épousant » : semble
présenter le mariage comme la seule issue possible
Adoptant un langage à la limite de la parodie Dubois expose, sur le mode hypothétique, la
situation.
Il annonce ainsi les étapes de cette intrigue amoureuse propre à la comédie, la
résumant de façon parodique :
L'exposition de cette intrigue, à travers la tournure hypothétique « si vous lui
plaisez »
La progression de l'action, marquée par les hyperboles (« elle se débattra
tant », « elle deviendra si faible »…)
Le dénouement qu'il présente comme inévitable grâce à la négation restrictive :
« elle ne pourra se soutenir qu’en épousant ».
-
Il exploite également de façon parodique le dilemme propre à l'héroïne tragique, dilemme qui
oppose la raison au sentiment, et qui provoque dans toutes les tragédies un véritable combat
intérieur auquel il est fait ici allusion par....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lecture linéaire n° 1 Les Fausses confidences, Marivaux (1737). Acte I scène 14 (extrait)
- Étude linéaire n°2 – Les Fausses Confidences, Marivaux, 1737 – Acte II, scène 13 : le stratagème d’Araminte
- Lecture linéaire 2. Les Fausses confidences de Marivaux. Acte I, scène 14
- fiche analyse linéaire les fausses confidences Marivaux - scène 2 de l'acte I
- Etude linéaire Marivaux, Les fausses confidences - – Acte I, scène 2