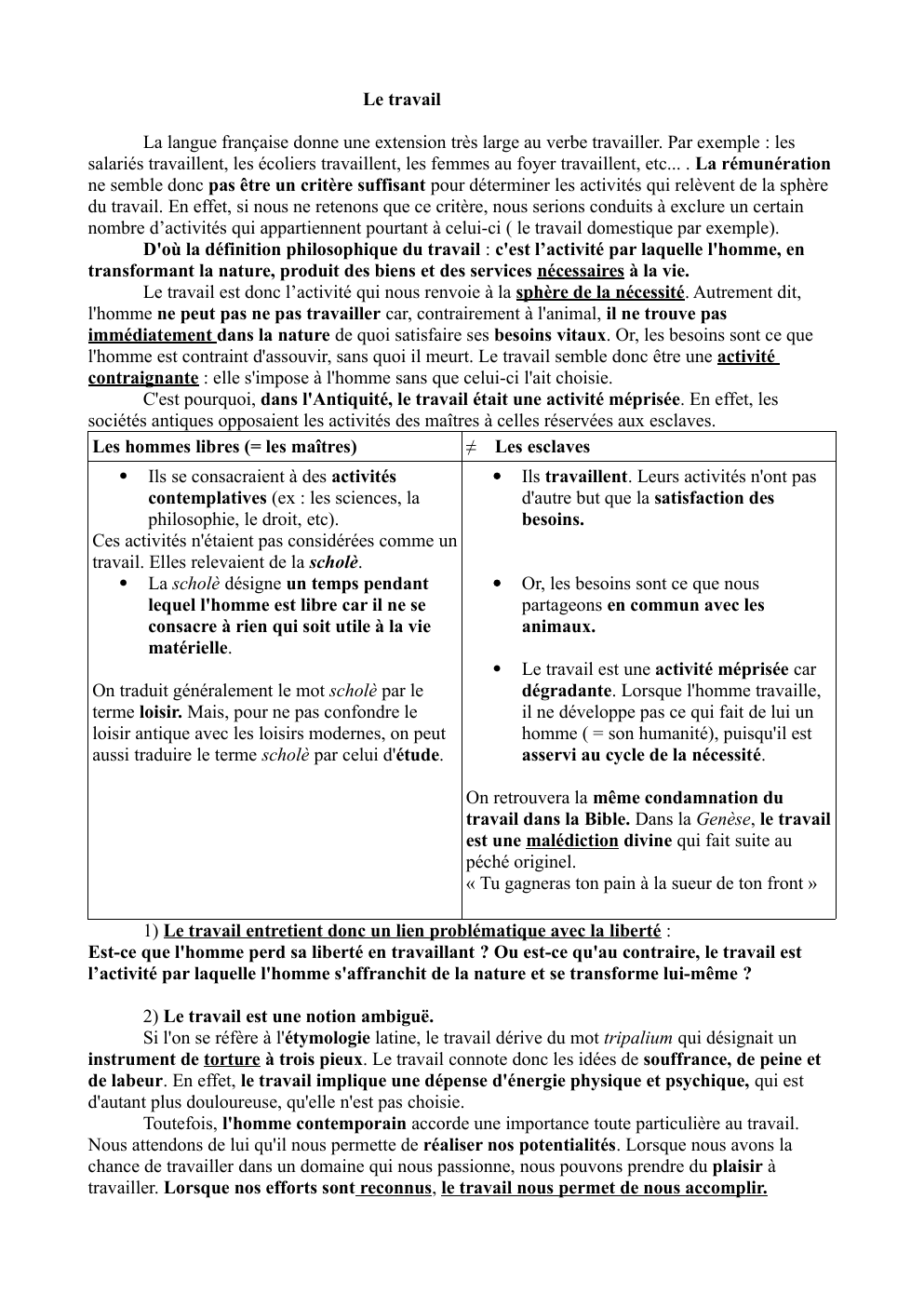Le travail
Publié le 14/05/2025
Extrait du document
«
Le travail
La langue française donne une extension très large au verbe travailler.
Par exemple : les
salariés travaillent, les écoliers travaillent, les femmes au foyer travaillent, etc...
.
La rémunération
ne semble donc pas être un critère suffisant pour déterminer les activités qui relèvent de la sphère
du travail.
En effet, si nous ne retenons que ce critère, nous serions conduits à exclure un certain
nombre d’activités qui appartiennent pourtant à celui-ci ( le travail domestique par exemple).
D'où la définition philosophique du travail : c'est l’activité par laquelle l'homme, en
transformant la nature, produit des biens et des services nécessaires à la vie.
Le travail est donc l’activité qui nous renvoie à la sphère de la nécessité.
Autrement dit,
l'homme ne peut pas ne pas travailler car, contrairement à l'animal, il ne trouve pas
immédiatement dans la nature de quoi satisfaire ses besoins vitaux.
Or, les besoins sont ce que
l'homme est contraint d'assouvir, sans quoi il meurt.
Le travail semble donc être une activité
contraignante : elle s'impose à l'homme sans que celui-ci l'ait choisie.
C'est pourquoi, dans l'Antiquité, le travail était une activité méprisée.
En effet, les
sociétés antiques opposaient les activités des maîtres à celles réservées aux esclaves.
Les hommes libres (= les maîtres)
≠ Les esclaves
Ils se consacraient à des activités
contemplatives (ex : les sciences, la
philosophie, le droit, etc).
Ces activités n'étaient pas considérées comme un
travail.
Elles relevaient de la scholè.
La scholè désigne un temps pendant
lequel l'homme est libre car il ne se
consacre à rien qui soit utile à la vie
matérielle.
On traduit généralement le mot scholè par le
terme loisir.
Mais, pour ne pas confondre le
loisir antique avec les loisirs modernes, on peut
aussi traduire le terme scholè par celui d'étude.
Ils travaillent.
Leurs activités n'ont pas
d'autre but que la satisfaction des
besoins.
Or, les besoins sont ce que nous
partageons en commun avec les
animaux.
Le travail est une activité méprisée car
dégradante.
Lorsque l'homme travaille,
il ne développe pas ce qui fait de lui un
homme ( = son humanité), puisqu'il est
asservi au cycle de la nécessité.
On retrouvera la même condamnation du
travail dans la Bible.
Dans la Genèse, le travail
est une malédiction divine qui fait suite au
péché originel.
« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front »
1) Le travail entretient donc un lien problématique avec la liberté :
Est-ce que l'homme perd sa liberté en travaillant ? Ou est-ce qu'au contraire, le travail est
l’activité par laquelle l'homme s'affranchit de la nature et se transforme lui-même ?
2) Le travail est une notion ambiguë.
Si l'on se réfère à l'étymologie latine, le travail dérive du mot tripalium qui désignait un
instrument de torture à trois pieux.
Le travail connote donc les idées de souffrance, de peine et
de labeur.
En effet, le travail implique une dépense d'énergie physique et psychique, qui est
d'autant plus douloureuse, qu'elle n'est pas choisie.
Toutefois, l'homme contemporain accorde une importance toute particulière au travail.
Nous attendons de lui qu'il nous permette de réaliser nos potentialités.
Lorsque nous avons la
chance de travailler dans un domaine qui nous passionne, nous pouvons prendre du plaisir à
travailler.
Lorsque nos efforts sont reconnus, le travail nous permet de nous accomplir.
Le travail semble donc entretenir un lien problématique avec le bonheur :
Est-ce que le travail est une activité pénible dans laquelle l'homme s'épuise ? Ou bien, peut-on
se réaliser dans son travail? Et dans l'hypothèse où il nous permettrait de nous accomplir, il faudra
se demander quelles sont les conditions que le travail doit remplir pour qu'il permette à
l'homme de se réaliser ?
I.
Le travail tel qu'il devrait être : le travail en théorie.
A.
Définition générale du travail.
Cf.Hegel, Principes de la philosophie du droit, §196
Pour Hegel, le travail est une médiation, c-a-d un intermédiaire que l'homme introduit
entre ses besoins et leur satisfaction.
Le travail est en effet un processus qui combine trois
facteurs.
a) La matière première (= l’objet naturel).
b) Les moyens de productions (= les outils, les machines ( = la technique).
c) La force de travail (= l’homme).
Conséquence : l’homme par son travail transforme la nature, il « s’objective » dans le
réel de façon à ce qu’il puisse se reconnaître en lui.
En ce sens, le travail est un fait
exclusivement humain et culturel.
1) Contrairement à l'animal dont les productions dérivent de l'instinct, le travail est une
activité consciente.
L'homme doit anticiper le but qu'il cherche à atteindre.
En ce sens, le
travail pousse l'homme à raisonner.
2) C'est par le biais du travail que l'homme humanise la nature.
Autrement dit, c'est au
moyen du travail que l'homme modifie la nature en culture.
La culture c'est le milieu
secondaire et artificiel ( = c'est la nature en tant qu' elle a été transformée par l'homme)
Le travail est l'activité qui permet de transformer la nature.
Or, en transformant la nature,
l’homme se transforme à son tour.
Pour Hegel, il y a par conséquent une double production à
l’œuvre dans le travail.
B.
« La dialectique du maître et de l'esclave ».
Cf Hegel, Phénoménologie de l'Esprit
( Analyse du titre : le terme dialectique désigne un mouvement ou une dynamique qui anime le réel
et l'esprit.
C'est un mouvement qui passe par une série d'étapes successives où chaque étape
constitue la négation de la précédente.
Ex de la dialectique appliquée au développement d'une plante.
Le bourgeon constitue l'étape
première ( c'est « l'en soi »), le bourgeon va ensuite être nié et dépassé par la fleur ( c'est le « pour
soi »); enfin, la fleur va elle-même être niée pour se transformer en fruit.
Celui-ci constitue donc la
synthèse du bourgeon et de la fleur.
Attention la dialectique du maître et de l'esclave est une métaphore ou encore une allégorie.
A.
dit,
c'est une image qui permet à Hegel de penser le rapport qu'entretiennent les consciences ou les
sujets.)
Point de départ : Pour Hegel, le rapport que chaque conscience entretient avec l'autre
n'est pas un rapport de paix ou de concorde.
Au contraire, chaque conscience veut être
reconnue par l'autre.
En ce sens, Hegel place le rapport que les sujets entretiennent entre eux sous
le signe de la conflictualité.
Dans cette « lutte pour la reconnaissance », deux consciences vont s'engager l'une contre
l'autre et se battre en duel.
Elles vont s'engager dans une « lutte à mort où chacune poursuit la
mort de l'autre ».
En effet, les deux consciences veulent être reconnues comme de véritables
sujets ( des « pour- soi ») et non pas simplement comme des objets.
C'est pourquoi, il faut que l'une
et l'autre acceptent de mettre leur vie en jeu, pour prouver à celle qui lui fait face qu'elle ne tient pas
à son être biologique (= à son corps, qui constitue l'en soi), mais qu'elle est avant tout un sujet ( =
un esprit, un pour -soi).
Dans ce duel, une des consciences va assumer le risque jusqu'au bout .
Ce sera la future
conscience du maître.
A l'inverse, l’esclave est celui qui préférera sauvegarder sa vie, plutôt
que d'aller jusqu'au bout du combat.
Étape un : au terme de cette lutte à mort, la conscience servile est celle qui travaille pour le
maître, tandis que le maître se contente de consommer les productions de l'esclave.
Étape deux (= renversement dialectique).
Or, au fur et à mesure de son travail, l'esclave
s'humanise.
En se confrontant à la nature, il se forme et se cultive.
Il développe sa raison, sa
technique et son langage, alors que le maître est tributaire du travail de ce dernier pour vivre.
D'où ( = la synthèse) : au terme de la dialectique, l'esclave devient « le maître du maître » et le
maître « l'esclave de l’esclave ».
Ccl : l'allégorie hégélienne montre que le travail permet à l'homme de s'émanciper.
En
transformant la nature, l'esclave se forme lui-même.
A l'inverse, l'oisiveté rend l'homme dépendant
du travail d'autrui.
Transition : par son travail, l'individu affirme ainsi ses pensées et son habileté physique en
les imprimant dans ses œuvres.
Il modifie son environnement immédiat à son image.
Si l'analyse
hégélienne décrit le travail tel qu'il devrait être, qu'en est-il dans les faits ? Est- ce que le travail est
toujours cette activité dans laquelle et par laquelle l'homme peut se reconnaître, ou est-ce qu'au
contraire, il peut être affecté par des pathologies....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L’augmentation des facteurs de production, travail et capital, est-elle la seule source de la croissance économique ?
- le travail permet il a l'homme de s'accomplir
- Devoir Maison philosophie: : L’homme se reconnaît-il mieux dans le travail ou dans le loisir ?
- corrigé travail de lecture le cercle des poètes disparus
- Mutation du Travail et de l'emploi SES