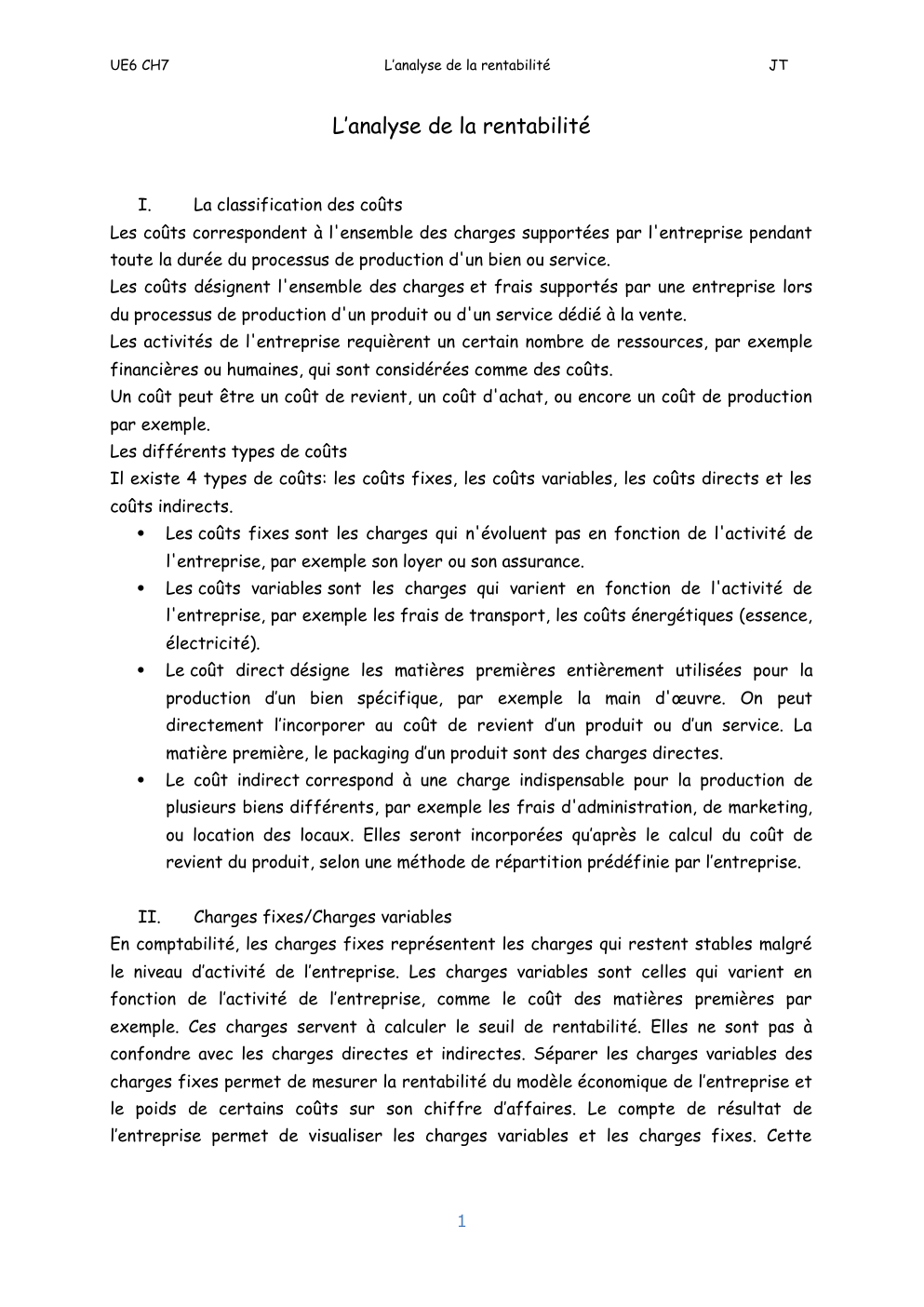L’analyse de la rentabilité I. La classification des coûts
Publié le 20/04/2025
Extrait du document
«
UE6 CH7
L’analyse de la rentabilité
JT
L’analyse de la rentabilité
I.
La classification des coûts
Les coûts correspondent à l'ensemble des charges supportées par l'entreprise pendant
toute la durée du processus de production d'un bien ou service.
Les coûts désignent l'ensemble des charges et frais supportés par une entreprise lors
du processus de production d'un produit ou d'un service dédié à la vente.
Les activités de l'entreprise requièrent un certain nombre de ressources, par exemple
financières ou humaines, qui sont considérées comme des coûts.
Un coût peut être un coût de revient, un coût d'achat, ou encore un coût de production
par exemple.
Les différents types de coûts
Il existe 4 types de coûts: les coûts fixes, les coûts variables, les coûts directs et les
coûts indirects.
Les coûts fixes sont les charges qui n'évoluent pas en fonction de l'activité de
l'entreprise, par exemple son loyer ou son assurance.
Les coûts variables sont les charges qui varient en fonction de l'activité de
l'entreprise, par exemple les frais de transport, les coûts énergétiques (essence,
électricité).
Le coût direct désigne les matières premières entièrement utilisées pour la
production d’un bien spécifique, par exemple la main d'œuvre.
On peut
directement l’incorporer au coût de revient d’un produit ou d’un service.
La
matière première, le packaging d’un produit sont des charges directes.
Le coût indirect correspond à une charge indispensable pour la production de
plusieurs biens différents, par exemple les frais d'administration, de marketing,
ou location des locaux.
Elles seront incorporées qu’après le calcul du coût de
revient du produit, selon une méthode de répartition prédéfinie par l’entreprise.
II.
Charges fixes/Charges variables
En comptabilité, les charges fixes représentent les charges qui restent stables malgré
le niveau d’activité de l’entreprise.
Les charges variables sont celles qui varient en
fonction de l’activité de l’entreprise, comme le coût des matières premières par
exemple.
Ces charges servent à calculer le seuil de rentabilité.
Elles ne sont pas à
confondre avec les charges directes et indirectes.
Séparer les charges variables des
charges fixes permet de mesurer la rentabilité du modèle économique de l’entreprise et
le poids de certains coûts sur son chiffre d’affaires.
Le compte de résultat de
l’entreprise permet de visualiser les charges variables et les charges fixes.
Cette
1
UE6 CH7
L’analyse de la rentabilité
JT
distinction aide aux prises de décision de gestion et à la réduction éventuelle des frais
relatifs à certains postes.
a.
Charges fixes et charges variables : définition
Les charges fixes appelées aussi « charges de structure » sont les postes de dépenses
de l’entreprise qui ne varient pas en fonction du volume de son activité.
Ces charges
restent stables, quel que soit le niveau de production ou de facturation.
Les charges variables appelées aussi « charges opérationnelles » sont les dépenses qui
varient en fonction du volume de l’activité de l’entreprise.
Les charges variables
augmentent lorsque la production ou le chiffre d’affaires augmente.
b.
Charges fixes et charges variables : exemples
Les charges fixes sont en général :
les loyers
l’assurance
certains honoraires d’experts
les abonnements
Les charges variables sont :
la matière première
les frais de packaging, emballage
les frais de transport de marchandises
Remarque : Attention aux charges mixtes
Certaines charges peuvent être mixtes, c’est-à-dire semi-variables et semi-fixes.
Prenons pour exemple le salaire d’un commercial qui toucherait un salaire plus des
commissions en fonction du chiffre d’affaires qu’il apporte à l’entreprise.
D’autres
charges sont dites mixtes, car on ne peut pas les classer de manière radicale dans un
poste ou dans un autre ; elles restent fixes pendant un temps puis augmentent quand
l’entreprise franchit un palier de croissance.
III.
Le compte de résultat différentiel
Le compte de résultat différentiel se présente sous la forme d’un tableau dans
lequel les charges fixes sont retranchées afin de dégager la marge sur coûts variables,
puis le résultat net.
Cet état financier est principalement utilisé par le comptable ou par
le dirigeant de l’entreprise dans le cadre du contrôle de gestion.
Plusieurs éléments apparaissent dans le compte de résultat différentiel, dont :
Le chiffre d’affaires : il s’agit de la somme des recettes réalisées par l’entreprise suite
à la vente de produits ou à des prestations de service ;
2
UE6 CH7
L’analyse de la rentabilité
JT
Les charges variables : elles correspondent aux dépenses réalisées par l’entreprise pour
assurer le bon fonctionnement de ses différents services.
Le montant des charges
variables évolue ainsi en fonction de l’activité de l’entreprise.
Il s’agit par exemple des
frais d’électricité, des primes perçues par les employés, ou encore des frais de
livraison…
La marge sur coûts variables : elle permet d’identifier les services et les produits les
plus rentables de l’entreprise ;
Les charges fixes : elles correspondent aux dépenses effectuées par l’entreprise, quel
que soit son volume d’activité.
Il s’agit par exemple des loyers, des primes d’assurance
ou encore des frais d’entretien ;
Le résultat net : il s’agit de la totalité des bénéfices générés par l’entreprise au cours
d’un exercice comptable.
Le compte de résultat différentiel est un outil utilisé dans le cadre du contrôle de
gestion.
Avec le compte de résultat prévisionnel, il permet de mesurer la performance
de l’entreprise et sa capacité à créer de la richesse.
Cet état financier est un outil
efficace pour définir si la stratégie mise en place par le chef d’entreprise permet
d’atteindre l’équilibre....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse linéaire Théodote, La Bruyère
- sensations Rimbaud analyse
- Préparation à l’oral du baccalauréat de français Analyse linéaire n°4 - Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, 1990 (épilogue)
- Objet d'étude : La poésie du XIX et du XX siècle. Parcours complémentaire : Alchimie poétique : réinventer le monde. Analyse linéaire 2/2 « Le Pain », Francis Ponge, Le Parti pris des choses, 1942
- Analyse linéaire Venus Anadyomène