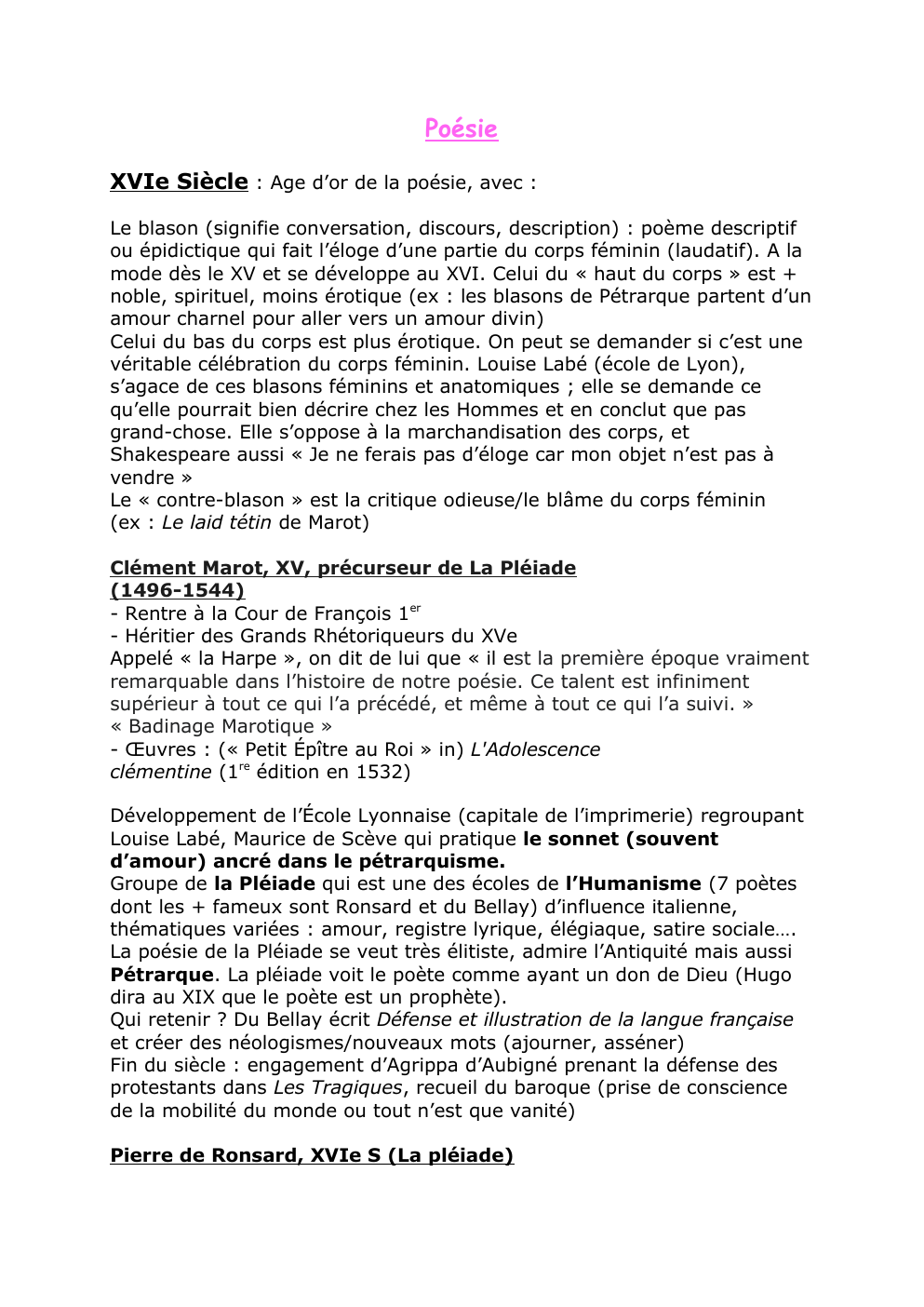La poésie
Publié le 28/02/2024
Extrait du document
«
Poésie
XVIe Siècle : Age d’or de la poésie, avec :
Le blason (signifie conversation, discours, description) : poème descriptif
ou épidictique qui fait l’éloge d’une partie du corps féminin (laudatif).
A la
mode dès le XV et se développe au XVI.
Celui du « haut du corps » est +
noble, spirituel, moins érotique (ex : les blasons de Pétrarque partent d’un
amour charnel pour aller vers un amour divin)
Celui du bas du corps est plus érotique.
On peut se demander si c’est une
véritable célébration du corps féminin.
Louise Labé (école de Lyon),
s’agace de ces blasons féminins et anatomiques ; elle se demande ce
qu’elle pourrait bien décrire chez les Hommes et en conclut que pas
grand-chose.
Elle s’oppose à la marchandisation des corps, et
Shakespeare aussi « Je ne ferais pas d’éloge car mon objet n’est pas à
vendre »
Le « contre-blason » est la critique odieuse/le blâme du corps féminin
(ex : Le laid tétin de Marot)
Clément Marot, XV, précurseur de La Pléiade
(1496-1544)
- Rentre à la Cour de François 1er
- Héritier des Grands Rhétoriqueurs du XVe
Appelé « la Harpe », on dit de lui que « il est la première époque vraiment
remarquable dans l’histoire de notre poésie.
Ce talent est infiniment
supérieur à tout ce qui l’a précédé, et même à tout ce qui l’a suivi.
»
« Badinage Marotique »
- Œuvres : (« Petit Épître au Roi » in) L'Adolescence
clémentine (1re édition en 1532)
Développement de l’École Lyonnaise (capitale de l’imprimerie) regroupant
Louise Labé, Maurice de Scève qui pratique le sonnet (souvent
d’amour) ancré dans le pétrarquisme.
Groupe de la Pléiade qui est une des écoles de l’Humanisme (7 poètes
dont les + fameux sont Ronsard et du Bellay) d’influence italienne,
thématiques variées : amour, registre lyrique, élégiaque, satire sociale….
La poésie de la Pléiade se veut très élitiste, admire l’Antiquité mais aussi
Pétrarque.
La pléiade voit le poète comme ayant un don de Dieu (Hugo
dira au XIX que le poète est un prophète).
Qui retenir ? Du Bellay écrit Défense et illustration de la langue française
et créer des néologismes/nouveaux mots (ajourner, asséner)
Fin du siècle : engagement d’Agrippa d’Aubigné prenant la défense des
protestants dans Les Tragiques, recueil du baroque (prise de conscience
de la mobilité du monde ou tout n’est que vanité)
Pierre de Ronsard, XVIe S (La pléiade)
Figure majeure de la littérature poétique de la Renaissance (1524-1585),
surnommé « prince des poètes », fonde dès 1549 La Pléiade avec ses
amis Du Bellay et Baïf.
-Aventure avec Marie Dupin dans Amour de Marie
Auteurs d’œuvres vastes : simplicité de ses odes et sonnets, de la poésie
engagée dans le contexte des guerres de religion avec Les hymnes et les
Discours, puis l’épopée et la poésie lyrique avec Les Odes, des Amours
Jehan Grisel, XVIe S (baroque)
Auteur plutôt méconnu (1567-1622), trouve sa place dans Éros baroque,
anthologie de la poésie baroque fait par Gisèle Mathieu Castellani
Publie à Rouen en 1599 ses Premières œuvres poétiques, gagne de
nombreux prix à Rouen
Écrit un blason sur les sourcils féminins
Du Bellay, XVIe S (La pléiade)
(1522-1560)
-Aspire à Platon mais surtout à la perfection de Pétrarque (Le
pétrarquisme : amours malheureux sont une souffrance pour s’élever,
style très recherché, inspiré de la philosophie de Platon : s’élever vers le
monde des idées, de l’intelligible.
Pour une créature terrestre, l’amour
permet cette élévation) + idée que le poète est « l’élu des Dieux »
-Sa rencontre avec Pierre de Ronsard fut à l'origine de la formation de
la Pléiade, groupe de poètes pour lequel du Bellay rédigea un manifeste,
la Défense et illustration de la langue française.
-Œuvre la plus célèbre : Les Regrets, (Recueil de sonnets dont l’Olive,
sonnet 1, poème hermétique)
Le XVIIe est moins inventif mais la poésie reste pratiquée.
Le baroque : véritable explosion avec l’instabilité, le mouvement, le gout
pour ce qui change, ce qui n’a pas de règle : le chaos, avec Théophile de
Viau, Tristan l’Hermite, Saint-Amant : images somptueuses et
surprenantes et une véritable angoisse devant l’existence.
Mais aussi le classicisme, ou l’écrivain est moraliste, respecte les règles
et l’équilibre, énonce des vérités universelles, avec des auteurs
classiques : François Malherbe, Boileau, La Fontaine imposent un style
épuré, de bon gout, de raison (dans le théâtre : Molière, Racine)
XVIIIe S : poésie = parent pauvre car Siècle des Lumières : ce sont
plutôt des essais, car règne de la raison, des philosophes, des penseurs.
Voltaire produit quelques textes en vers mais didactiques/philosophiques
Le + célèbre : « Poème sur le désastre de Lisbonne » (1756) Voltaire
exprime sa colère face au tremblement de terre -> engage débat
philosophique avec Rousseau, Leibnitz qui pensent que l’homme est bon
(optimistes), ce qui l’inspirera à dénoncer l’optimisme dans Candide
Moment de la révolution : lyrisme émouvant d’André Chénier (1762-1794)
Vigny raconte l’épisode de sa décapitation dans Stello
XIXe S : Le Romantisme (1789-1860) : Les Méditations poétiques de
Lamartine marque le renouveau de la poésie.
Génération frappée par le
mal du siècle, l’admiration pour napoléon Ier, la poésie = moyen
d’expression privilégié du mal-être.
Exprime la perte de repère dû aux
bouleversements de la société aux lendemains de la Révolution et de
l’Empire, le « je » « moi » devient objet du poème.
Le poète est un guide,
à une mission : il s’engage, dénonce, proteste.
« Je n’imitais plus
personne, je m’exprimais moi-même pour moi-même.
Ce n’était pas un
art, c’était un soulagement de mon propre cœur qui se berçait de ses
propres sanglots » écrit Lamartine
Gds auteurs romantiques : Chef de file Victor Hugo (contre Napoléon III
dans Les châtiments), Chateaubriand, Musset, Vigny.
Dès 1800, Mme de
Staël soulignait l’importance du lyrisme : thématiques comme l’amour, la
déploration face à la fuite du temps, vieillesse, mort, fantastique,
exotisme, nature-refuge, complice de l’état d’âme : paysages états d’âme
+ ouverture à de nouveaux sujets… Hugo dit : « Tout est sujet, tout a
droit de cité en poésie »
Alphonse de Lamartine, XIXe S, (romantisme)
(1790-1848)
-Poète, romancier, dramaturge français, historien, ainsi que personnalité
politique qui participa à la révolution de 1848 et proclama la Deuxième
République.
Il est l'une des grandes figures du romantisme en France.
-Aventure avec Julie Charles (appelé Elvire)
-Œuvres : « Le lac » (où il dérégule la forme traditionnelle) in Les
méditations poétiques, 1820
Victor Hugo, XIX, Chef de file du romantisme
(1802-1885)
« Et s’il n’en reste qu’un, je serais celui-là »
-Poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique mais
aussi personnalité politique et intellectuel engagé (contre Napoléon III),
député républicain (malgré son éducation royaliste) sous la monarchie de
juillet.
Tente de s’opposer au coup d’État du 2 décembre 1851 mais est
expulsé du territoire (pendant 19 ans) et ne revient malgré l’amnistie
qu’en 1870.
Devient sénateur de la république de Ferry en 1881.
-Époux d’Adèle Foucher avec qui il a 5 enfants (Léopold meurt à qlques
mois, Léopoldine meurt adulte), aventure avec de nombreuses
maitresses : Juliette Drouet, Léonie d’Aunet, Alice Ozy
-Œuvre : drame romantique comme Hernani, 1830, puis Ruy Blas,1839.
Poèmes lyriques comme Odes et Ballades, 1826, Les Contemplations,
1856.
Roman : Notre dame de Paris, 1831, Les misérables, 1862
Alfred de Musset, XIX, (romantisme)
(1810-1857)
« Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, Et j’en sais
d’immortels qui sont de purs sanglots » (in « La nuit de mai »)
-Poète et dramaturge français qui souffrait de dépersonnalisation,
abandonne ses études supérieures pour se consacrer à la littérature.
-Époux de Georges Sand
-Œuvres : drame romantique Lorenzaccio, 1834, pièce la + connue : On
ne badine pas avec l’amour, recueil de poésies Les Nuits, et ouvrage La
Confession d'un Enfant d'un Siècle
Guillaume Apollinaire, XXe S (romantisme)
-Considéré comme l’un des poètes français les + importants du XXe S
(1880-1918)
-Devient précepteur puis rédacteur en chef à Paris en 1903.
Imprégné de
la littérature du XIXe S/ de l’esthétisme romantique, il réinvente un
lyrisme nouveau et théorise donc les mouvements modernes : le cubisme,
le surréalisme.
-Poète novateur qui mélange tradition (dans ses thèmes : amour, fuite du
temps…) et modernité (formes poétiques nouvelles : vers libres, sans
ponctuation comme dans « Les colchiques » in Alcool)
-Aventure avec Marie Laurencin
-Recueils : Alcool, 1913 (fait référence aux expériences brulantes de la
vie, la quintessence de la vie), Poème à Lou, 1914, Calligrammes, 1916
(Puis, toujours au XIXe, le réalisme qui ne concerne pas la poésie : roman
omniscient, à la 3ème personne, on se documente…)
Vers 1850 : le romantisme laisse place au Parnasse qui n’est pas un
mouvement mais une École : c’est « l’art pour l’art » incarné par
Théophile Gautier.
La seule fonction de l’Art est esthétique : poésies
descriptives extrêmement recherchées
(Dans « L’Art » de Gautier : « L’œuvre sort plus belle/Sculpte, lime,
cisèle/Que ton rêve flottant/Se scelle/Dans le bloc résistant ! »)
Le symbolisme (1886-début XXe) s’ouvre avec le génie de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Objet d'étude : La poésie du XIX et du XX siècle. Parcours complémentaire : Alchimie poétique : réinventer le monde. Analyse linéaire 2/2 « Le Pain », Francis Ponge, Le Parti pris des choses, 1942
- La poésie a-t-elle seulement pour vocation d’exprimer les sentiments du poètes ?
- De poésie du 18e au 21e siècle : Modernité poétique ?
- Séquence poésie : Les mémoires d’une âme. Victor Hugo, Les Contemplations (1856) Explication de texte n°3 : « Demain, dès l’aube… », Livre IV, « Pauca Meae », poème XIV.
- LE PONT MIRABEAU (1912) Poésie extraite du recueil Alcool (1913) de Guillaume Apollinaire