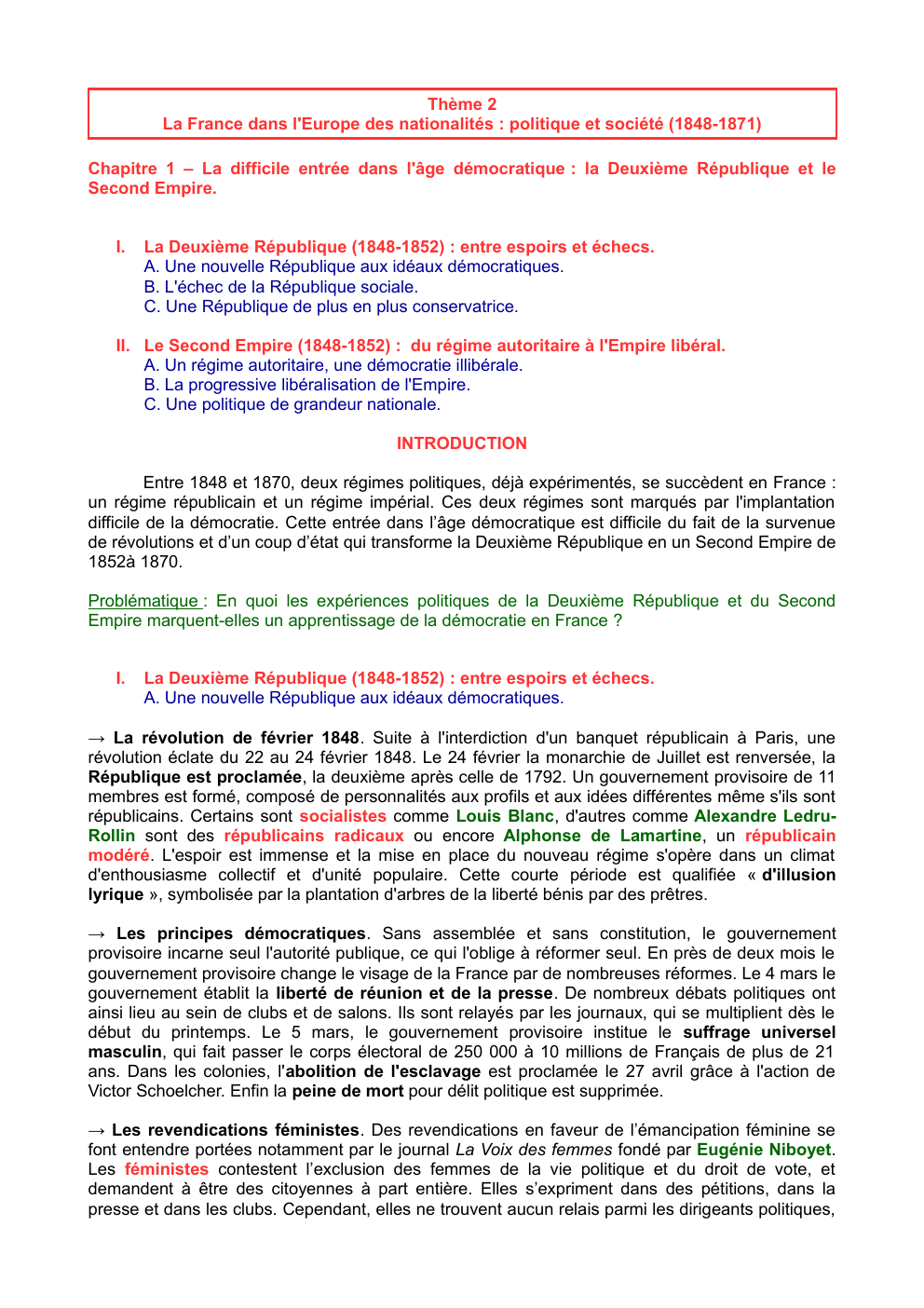La france dans l'Europe des nationalités : politique et société
Publié le 15/03/2024
Extrait du document
«
Thème 2
La France dans l'Europe des nationalités : politique et société (1848-1871)
Chapitre 1 – La difficile entrée dans l'âge démocratique : la Deuxième République et le
Second Empire.
I.
La Deuxième République (1848-1852) : entre espoirs et échecs.
A.
Une nouvelle République aux idéaux démocratiques.
B.
L'échec de la République sociale.
C.
Une République de plus en plus conservatrice.
II.
Le Second Empire (1848-1852) : du régime autoritaire à l'Empire libéral.
A.
Un régime autoritaire, une démocratie illibérale.
B.
La progressive libéralisation de l'Empire.
C.
Une politique de grandeur nationale.
INTRODUCTION
Entre 1848 et 1870, deux régimes politiques, déjà expérimentés, se succèdent en France :
un régime républicain et un régime impérial.
Ces deux régimes sont marqués par l'implantation
difficile de la démocratie.
Cette entrée dans l’âge démocratique est difficile du fait de la survenue
de révolutions et d’un coup d’état qui transforme la Deuxième République en un Second Empire de
1852à 1870.
Problématique : En quoi les expériences politiques de la Deuxième République et du Second
Empire marquent-elles un apprentissage de la démocratie en France ?
I.
La Deuxième République (1848-1852) : entre espoirs et échecs.
A.
Une nouvelle République aux idéaux démocratiques.
→ La révolution de février 1848.
Suite à l'interdiction d'un banquet républicain à Paris, une
révolution éclate du 22 au 24 février 1848.
Le 24 février la monarchie de Juillet est renversée, la
République est proclamée, la deuxième après celle de 1792.
Un gouvernement provisoire de 11
membres est formé, composé de personnalités aux profils et aux idées différentes même s'ils sont
républicains.
Certains sont socialistes comme Louis Blanc, d'autres comme Alexandre LedruRollin sont des républicains radicaux ou encore Alphonse de Lamartine, un républicain
modéré.
L'espoir est immense et la mise en place du nouveau régime s'opère dans un climat
d'enthousiasme collectif et d'unité populaire.
Cette courte période est qualifiée « d'illusion
lyrique », symbolisée par la plantation d'arbres de la liberté bénis par des prêtres.
→ Les principes démocratiques.
Sans assemblée et sans constitution, le gouvernement
provisoire incarne seul l'autorité publique, ce qui l'oblige à réformer seul.
En près de deux mois le
gouvernement provisoire change le visage de la France par de nombreuses réformes.
Le 4 mars le
gouvernement établit la liberté de réunion et de la presse.
De nombreux débats politiques ont
ainsi lieu au sein de clubs et de salons.
Ils sont relayés par les journaux, qui se multiplient dès le
début du printemps.
Le 5 mars, le gouvernement provisoire institue le suffrage universel
masculin, qui fait passer le corps électoral de 250 000 à 10 millions de Français de plus de 21
ans.
Dans les colonies, l'abolition de l'esclavage est proclamée le 27 avril grâce à l'action de
Victor Schoelcher.
Enfin la peine de mort pour délit politique est supprimée.
→ Les revendications féministes.
Des revendications en faveur de l’émancipation féminine se
font entendre portées notamment par le journal La Voix des femmes fondé par Eugénie Niboyet.
Les féministes contestent l’exclusion des femmes de la vie politique et du droit de vote, et
demandent à être des citoyennes à part entière.
Elles s’expriment dans des pétitions, dans la
presse et dans les clubs.
Cependant, elles ne trouvent aucun relais parmi les dirigeants politiques,
même progressistes.
Le Code civil, qui fait d’elles des mineures, n’est jamais remis en question.
Dès juillet 1848, l’accès aux clubs et aux réunions publiques leur est interdit.
B.
L'échec de la République sociale.
→ Les ouvriers dans le gouvernement provisoire.
En 1848, les classes populaires, en
particulier les ouvriers qui vivent difficilement avec des salaires très faibles, revendiquent une plus
grande solidarité et un partage plus équitable des richesses produites.
Le mouvement ouvrier a
joué un rôle décisif dans la révolution de février et est représenté au gouvernement provisoire,
notamment par le socialiste républicain Louis Blanc et par le représentant du mouvement ouvrier
Albert Martin.
Dès le 25 février, Louis Blanc obtient du gouvernement provisoire qu'il
reconnaissent le droit au travail, c'est-à-dire qu'il s’engage à « garantir l’existence de l’ouvrier par
le travail ».
Ainsi le gouvernement souhaite régler la question sociale.
Le temps de travail est
réduit à 10 heures à Paris et 11h en province.
La création des Ateliers nationaux répond au
chômage des ouvrier.
Cette mesure est financier par un hausse des impôts directs de 45% (les 45
centimes, pour un impôt de 1 franc versé en 1847, l'on doit cette fois verser 1,45 franc) qui
mécontente fortement l'opinion, notamment les paysans.
→ L'opposition entre modérés et socialistes.
Le premier scrutin , qui a pour but de désigner les
membres de l'Assemblée constituante, se déroule en avril 1848.
La participation est massive
(83%) et encadrée par les notables locaux.
Les Français de plus de 21 ans se rendent ensemble
sur les lieux de vote où leur suffrage se portent généralement sur le même candidat.
Le scrutin est
favorable aux républicains modérés, dont certains sont qualifiés de « républicains du
lendemain », qui remportent environ 500 sièges contre quelques 300 aux monarchistes et
seulement une soixantaine pour les radicaux et les socialistes, grands perdants de l'élection au
suffrage universel.
Après les élections d’avril 1848, le mouvement ouvrier organise des
manifestations massives pour mettre l’Assemblée sous pression, afin qu'elle maintienne les
réformes sociales.
Le 15 mai 1848, les radicaux et les socialistes envahissent l'Assemblée pour
demander, entre autre, l’intervention de la France en faveur des peuples européens en révolution
lors du Printemps des peuples.
Le prétexte est tout trouver pour faire arrêter les meneurs comme
Auguste Blanqui et mettre fin à « la menace rouge ».
→ Les journées de juin 1848.
Les députés républicains modérés et conservateurs dénoncent les
Ateliers nationaux comme inutilement coûteux et comme des foyers de subversion politique.
En
réaction, le nouveau gouvernement annonce la fermeture des Ateliers nationaux.
Du 22 au 26 juin
1848, les ouvriers des quartiers populaires de l'Est parisien et de Marseille se soulèvent : 400
barricades sont dressées dans Paris le 23 juin.
L’Assemblée charge le ministre de la Guerre,
Eugène Cavaignac, de mener une violente répression : des centaines d’insurgés sont tués sur les
barricades, des milliers exécutés sommairement, emprisonnés ou déportés.
Les principaux
dirigeants ouvriers sont arrêtés ou contraints à l’exil.
Le rêve d'une République démocratique et
sociale disparaît : la rupture entre les ouvriers et la Deuxième République est définitivement
consommée.
Question sociale : ensemble des problèmes posés par la misère et le chômage faisant l'objet d'un
débat politique.
Ateliers nationaux : chantiers de travaux publics organisés par l'État pour employer les ouvriers
au chômage.
« Républicain du lendemain » : monarchistes qui se sont ralliés, après la révolution de 1848, à la
république, certains sincèrement, d'autres par intérêts, contrairement aux « républicains de la
veille » qui étaient républicains avant 1848.
Subversion politique : activité qui vise le renversement du pouvoir en place.
C.
Une République de plus en plus conservatrice
→ La Constitution de 1848.
Les députés adoptent une Constitution démocratique fondée sur une
stricte séparation des pouvoirs.
L’Assemblée nationale et le Président de la République sont élus
au suffrage universel masculin direct.
L'Assemblée nationale est puissant puisqu'elle ne peut pas
être dissoute, vote les lois et le budget.
Le pouvoir exécutif revient au Président de la République,
élu pour 4 ans sans possibilité de renouvellement de son mandat.
En cas de conflit, aucune de ces
institutions ne peut s’imposer à l’autre.
Aucun droit politique n’est accordé aux femmes.
→ La victoire du Parti de l'Ordre.
L'élection présidentielle est prévue pour la fin de l'année 1848.
À gauche, le socialiste Raspail et le républicain Ledru-Rollin se présentent.
Lamartine, confiant en
son aura de fondateur de la République, espère un succès.
Le général Cavaignac apparaît comme
le grand favori.
Toutefois, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier se présente
également.
Un certain nombre de membres du parti de l'Ordre se range derrière sa candidature.
Des hommes comme Adolphe Thiers pensent qu'il est plus capable de rallier une partie de la
gauche que Cavaignac et qu'il sera plus facilement manipulable (il qualifie Louis-Napoléon
Bonaparte de « crétin qu'on mènera »).
Il a par ailleurs écrit un ouvrage, De l'extinction du
paupérisme, dans lequel il montre son intérêt pour la condition ouvrière et peut ainsi rallier des voix
à gauche.
Le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, seul candidat dont le nom est
connu dans les campagnes, est élu avec plus de 74% des voix.
Les élections législatives de
1849 sont remportées par les conservateurs.
Les républicains radicaux et socialistes font une
percée importante (35% des voix) tandis que les républicains modérés, en net recul, se rallient peu
à peu au parti de l’Ordre.
→ La fin de la République.
Inquiet de la montée en puissance des radicaux et des socialistes, le
parti de l’Ordre restreint les libertés, réprime les opposants politiques et renforce l'influence de
l'Église dans l'enseignement.
La loi électorale du 31 mai 1850 restreint le suffrage universel et
prive 3 millions de Français du droit de vote.
En effet, il faut désormais payer des impôts, ne
jamais avoir été condamné par la....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Histoire : La France dans l’Europe des nationalités : politique et société (1848 - 1871)
- La France dans l’Europe des nationalités : politique et société (1848-1871)
- La France dans l’Europe des nationalités : Politique et société (1848-1971)
- Quel événement ou fait de société, survenu en France, en Europe ou dans le monde, aucours de l'année écoulée, vous a plus particulièrement marqué ?
- C. E. 24 juin 1960, SOCIÉTÉ FRAMPAR ET SOCIÉTÉ FRANCE ÉDITIONS ET PUBLICATIONS, Rec. 412, concl. Heumann